La « taxe Zucman » a été adoptée le 20 février à l’Assemblée nationale avec le soutien des députés de gauche et l'abstention du Rassemblement national. Portée par les écologistes, il s’agit d’un impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches. Un impôt qui risque toutefois de passer sous les fourches caudines du Sénat, majoritairement à droite. Le camp présidentiel est vent debout contre cette taxe et les députés macronistes se sont peu mobilisés le jour du vote, rejoignant l’avis de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, pour qui la proposition de loi est « confiscatoire et inefficace ». Pourtant, une étude de la Direction générale des Finances publiques aurait dû les convaincre de voter pour. L’organisme, qui dépend du ministère de l'Économie, rapporte une richesse démultipliée ces vingt dernières années pour les plus aisés.

Les richesses se concentrent au fil des ans entre les mains d’un nombre restreint de ménages. Ce mouvement creuse des inégalités que la fiscalité parvient de moins en moins à corriger. Avec des impôts qui ont d’un côté augmenté pour la majorité des Français, et diminué de plus de 10 % de l’autre, pour le 0,1 % des plus riches… Sans compter que la croissance des revenus de ces « happy few » n'est pas le fruit de progrès techniques ou d’une meilleure qualification de ces derniers, mais plutôt de dispositions législatives favorables à leur égard.
Les ultra-riches disposent en effet de nombreuses possibilités de réduire leur base fiscale et échappent à la progressivité de l’impôt. En 2016, le taux d’imposition culminait à 46 % pour les 0,1 % les plus riches, mais il redescendait à 26 % pour les 80 foyers les plus riches des plus riches. Un effet régressif de l'impôt – plus on gagne moins on paye – que les largesses fiscales de l’ère Macron sont venues renforcer.
Les revenus et le patrimoine des ultra-riches s’envolent
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui regroupe les directions des impôts et de la comptabilité publique, a passé au crible les déclarations de revenus et de patrimoine depuis 2003 des foyers fiscaux les plus aisés résidant en France. Le premier constat est que les ménages à « très hauts revenus » (THR) – le 0,1 % des ménages aux plus hauts revenus – et ceux à « très hauts patrimoines » (THP) – le 0,1 % aux plus hauts patrimoines – sont deux groupes totalement distincts. Dans les deux cas, plus de 40 000 foyers sont identifiés, mais moins de 7 000 font partie des deux groupes. Il y a donc, selon la DGFiP, près de 75 000 ménages qui peuvent être qualifiés de très aisés en France.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
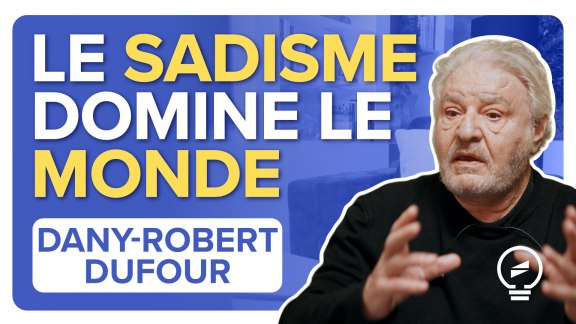
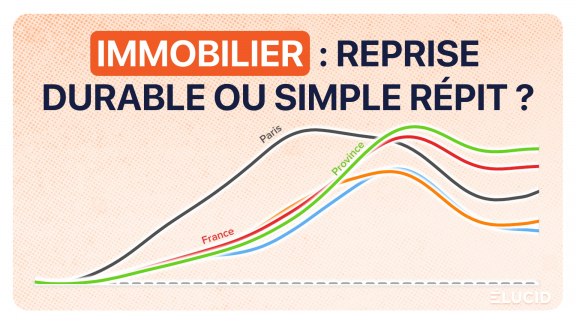
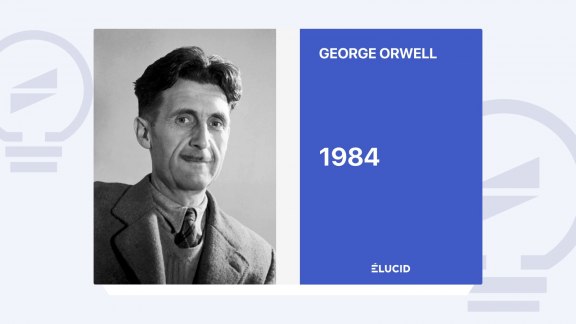





3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner