Avoir toujours raison est aisé : il suffit de manier plus habilement que son adversaire les ficelles du discours.

Podcast La synthèse audio
Dans L’Art d’avoir toujours raison (1831), Schopenhauer ne se contente pas de recenser les différents stratagèmes rhétoriques auxquels nous pouvons faire face ou recourir. Il démontre comment vérité et victoire ne sont pas toujours synonymes, comment avoir raison et paraître avoir raison sont deux choses très différentes. Quoique cette idée semble banale et ne soit pas représentative de la pensée de Schopenhauer, elle nous permet de porter un regard lucide sur la nature de l’homme et sa tendance à se laisser convaincre par les apparences plutôt que par la vérité.
Ce qu’il faut retenir :
L’homme est par nature sûr de lui. Ainsi, il lui importe plus de paraître avoir raison, par vanité ou mauvaise foi, que de voir triompher la vérité.
Par conséquent, la rationalité et la logique ne sont que peu utiles pour convaincre son adversaire ou son auditoire. En revanche, savoir employer à bon escient et se défendre contre les différents stratagèmes et astuces de la dialectique éristique constitue l’unique moyen de vaincre son adversaire.
Biographie de l’auteur
Arthur Schopenhauer (1788-1860) est un philosophe allemand, souvent présenté comme l’hériter et le continuateur d’Emmanuel Kant. Cependant, sa pensée, rattachée au courant pessimiste, se distingue incontestablement de celle de son prédécesseur. L’impératif catégorique kantien, celui d’une action juste, gratuite et désintéressée, n’est guère en adéquation avec le contenu cynique et pragmatique de la pensée de Schopenhauer.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

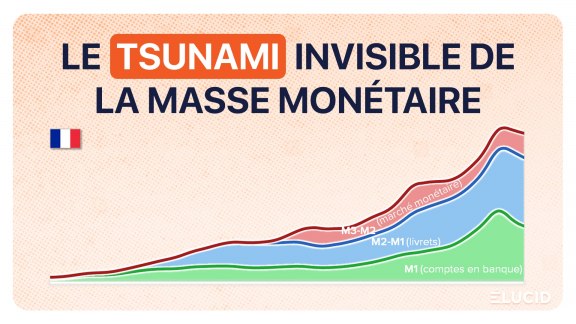
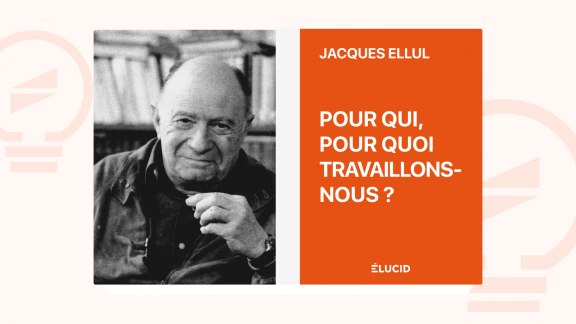

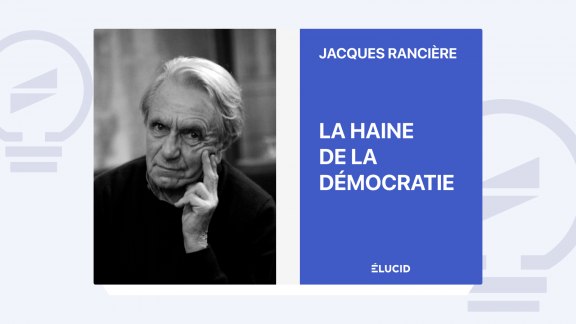
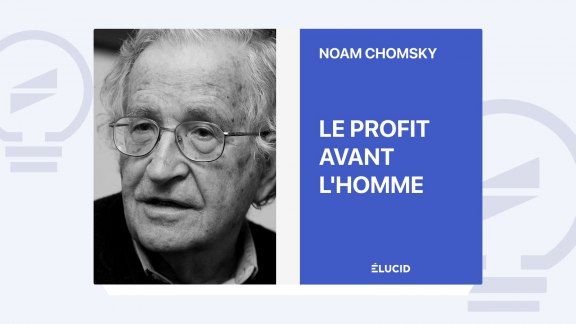
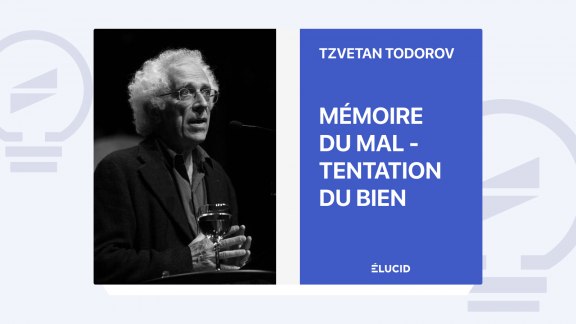
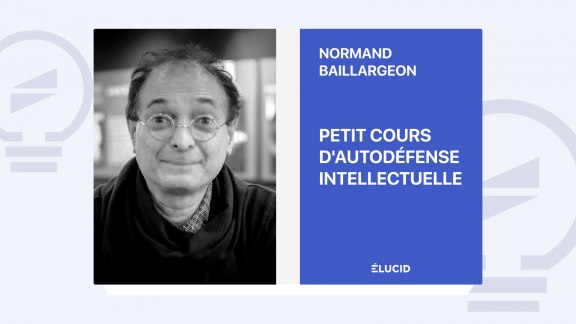
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner