La critique des « séries » vaut aujourd'hui vite une condamnation morale. Dans Vide à la demande (L’Echappée), Bertrand Cochard, agrégé et docteur en philosophie, auteur d’une thèse sur Guy Debord et membre de l’association Lève les yeux qui lutte contre l’addiction aux écrans, démontre à quel point la forme-série dit beaucoup sur ce que nous sommes et sur notre rapport à l’histoire. La fonction principale de ces séries est de faire passer le temps non consacré par les gens au travail, pour le plus grand profit de ceux qui captent nos données. Entretien.

Laurent Ottavi (Élucid) : Pourquoi avoir écrit un livre sur les séries alors que de nombreux sujets auraient pu servir de supports à une critique de la numérisation du monde ? Est-ce parce que vous avez constaté qu’elles sont, comme vous l’écrivez dans le livre « l’époque par l’alambic » ?
Bertrand Cochard : Il y a plusieurs origines à ce projet. Les éditions L’Échappée cherchaient depuis 6 ans quelqu’un pour écrire une critique des séries. Elles avaient refusé des manuscrits envoyés par des personnes qui n’en regardaient pas, ce qui n’est pas mon cas. Il se trouve aussi que les séries rejoignaient mes préoccupations qui portaient alors sur le temps libre, la fiction, la narration et la critique du développement personnel.
La question des séries se situe au carrefour de nombreuses problématiques cruciales : la surexposition aux écrans, le rapport au temps (pas seulement au temps libre, mais aussi au temps historique), le rapport à la fiction. J’ai aussi découvert plus tard, en travaillant sur les séries, qu’il existait tout un pan de la recherche universitaire en France qui légitime excessivement à mes yeux les produits des industries culturelles. Elle laisse de côté la critique sociale et l’indispensable critique de la marchandise.
Élucid : Le rapport entre séries et temps libre ressort effectivement beaucoup de votre livre. Pouvez-vous, dans un premier temps, dire ce qu’est le temps libre et en quoi son sens a-t-il changé au cours de l’Histoire ?
Bertrand Cochard : Le temps libre est une « idée neuve » en Europe pour paraphraser la formule de Saint-Just. C’était encore, au XIXe siècle, le privilège d’une classe de rentiers, de cette classe que Veblen appelait la classe de loisir, caractérisée par la consommation ostentatoire de son temps. Pour le travailleur décrit par Marx, le temps libre, si on entend par là le temps hors travail, n’était pas vraiment libre puisqu’il servait à reconstituer sa force de travail.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


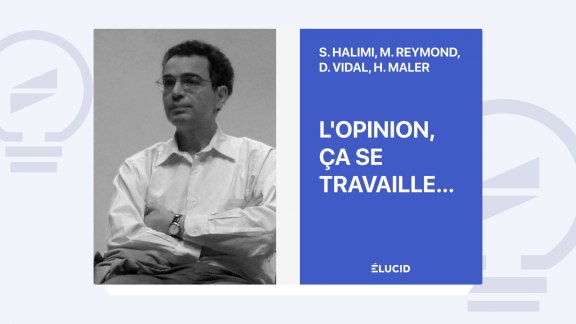

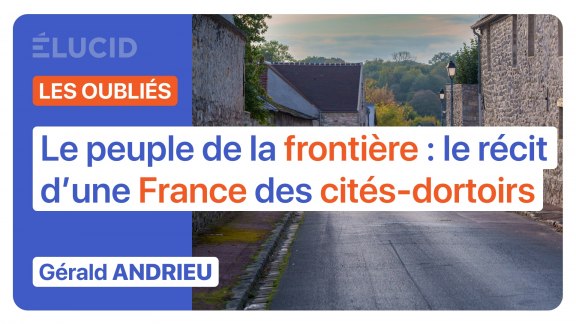

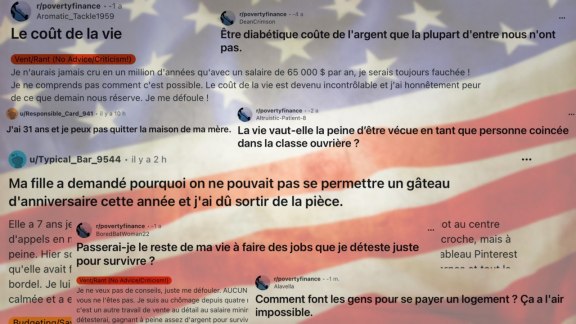

2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner