Les politiques de compétitivité n’ont pas tenu leurs promesses de prospérité et ont pris de plus en plus la forme d’un impératif d’adaptation aux contraintes de la mondialisation. Benjamin Brice, docteur en sciences politiques, en dresse le bilan dans son livre L’impasse de la compétitivité (Les Liens qui libèrent) et réfléchit à une alternative plus bénéfique économiquement, plus juste socialement et à la hauteur des enjeux écologiques.

Laurent Ottavi (Élucid) : Vous attribuez notre incapacité à faire face aux défis actuels davantage à un refus d’agir qu’à une impuissance, dans la mesure où il existe des leviers d’actions. Celui-ci tiendrait à un blocage intellectuel que vous nommez l’impératif de la compétitivité. Quand ce terme est-il devenu prépondérant, que recouvre-t-il et de quelles promesses est-il paré ?
Benjamin Brice : La notion de compétitivité a commencé à s’imposer dans le débat public à la fin des années 1970 et au début des années 1980 en Europe et aux États-Unis. Le contexte était alors celui de la pression commerciale du Japon qui menaçait les industries occidentales. Depuis, le terme a toujours occupé une place centrale dans le débat politique. Cela tient au fait que la mondialisation a continué de s’intensifier avec une hausse de l’ouverture commerciale, un accroissement de la part des profits des multinationales faits à l’étranger et l’ascension de la Chine dans le commerce international. Le taux d’ouverture commerciale de la France, c’est-à-dire la part des exportations et des importations dans le PIB de la France, a plus ou moins triplé entre les années 1960 et aujourd’hui.
Sous son aspect positif, la compétitivité est une promesse de prospérité pour un pays, grâce à la stimulation de l’innovation et de la productivité. Une meilleure compétitivité de la France et de ses entreprises devrait permettre aux produits français de gagner des parts de marché à l’international, ce qui a plusieurs avantages : une balance extérieure positive, des moyens pour financer notre modèle social et nos services publics, le plein-emploi et du pouvoir d’achat pour consommer plus.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous




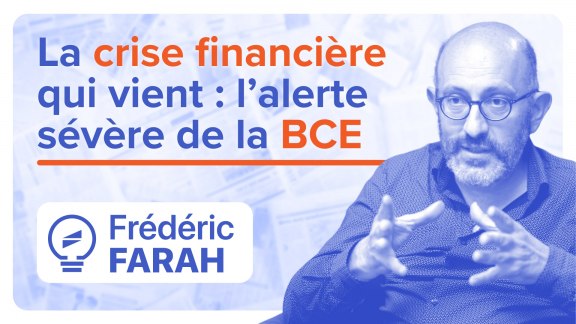

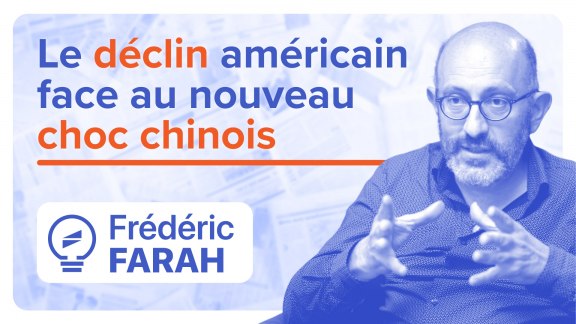

2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner