L'expérience de Milgram cherchait à faire prendre conscience du poids de l'autorité dans les décisions des individus. L’auteur nous met ainsi en garde contre les abus de l’autorité et incite tout individu à rester fidèle à ses valeurs et à sa conscience.



Abonnement Élucid
Podcast La synthèse audio
Soumission à l’autorité (1974) est le compte rendu de la fameuse expérience de Milgram. Souvent simplifiée à l’extrême, cette expérience se compose en réalité de dix-huit expériences. Le chercheur s'efforce de démontrer la propension de l’Homme à se soumettre aveuglément à l’autorité, au point de commettre des atrocités moralement inacceptables. Chacune des variantes proposées lui permet d’affiner la compréhension des sources de l’autorité et les mécanismes psychiques qui sont à l’œuvre lorsque l’individu entre en état de subordination.
Ce qu’il faut retenir :
Selon les conditions d’une situation d’autorité où il existe un conflit intense entre sa propre conscience et l’ordre donné, les taux d’obéissance peuvent varier de 10 % à 92,5 %.
En situation d’autorité, les individus se trouvent en effet, plus ou moins complètement, dans un état « agentique ». Ils abandonnent leur libre arbitre et perdent le sens des responsabilités, pour se mettre au service de l’autorité.
Différents facteurs influent positivement ou négativement la décision finale de l’individu entre « obéir » ou « résister » :
- La proximité (spatiale et/ou temporelle) de l’acte avec ses conséquences et de l’autorité elle-même
- La légitimité de l’autorité,
- La présence ou non d’éléments contradictoires à cette autorité,
- La position du groupe,
- Le nombre d’intermédiaires (personnes ou instruments).
- L’idéologie dominante
Sans même mesurer la puissance dissuasive de mesures coercitives en cas de résistance (du fait du cadre universitaire de l’expérience), Milgram montre ainsi que toute personne, organisation ou institution, en mesure d’organiser un conditionnement adéquat, en contrôlant ou régulant une part de ces six leviers (voire tous, pour le cas d’un État disposant de solides organes de propagande) est capable de faire commettre n’importe quelle action aux individus sous sa sphère d’influence.
Biographie de l’auteur
Stanley Milgram (1933-1984) est un chercheur américain, spécialisé en psychologie sociale. Après avoir étudié les sciences politiques au Queens College de New York, il entreprit un doctorat en psychologie sociale à l’université de Harvard (1954-1960). Ses recherches portant sur le conformisme, il fut supervisé par le Professeur Solomon Asch, dont la fameuse expérience éponyme avait mis en lumière, quelques années auparavant, l’influence prépondérante du groupe sur la personnalité d'un individu.
En tant que professeur assistant à l’université de Yale (1960-1963), le docteur Stanley Milgram apporta sa première contribution d’envergure à la discipline concernant la soumission à l’autorité. Les conclusions embarrassantes et inattendues de ses expériences en la matière lui valurent de nombreuses critiques en particulier concernant l’éthique de la méthode utilisée.
Avertissement : Ce document est une synthèse de l’ouvrage de référence susvisé, réalisé par les équipes d’Élucid ; il a vocation à retranscrire les grandes idées de cet ouvrage et n’a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l’ouvrage de référence chez votre libraire. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l’ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur.
Plan de l’ouvrage
I. Le dilemme de l’obéissance
II. Méthode d’investigation
III. Prévisions de comportement
IV. Proximité de la victime
V. Les individus face à l’autorité (1)
VI. Autres variantes et contrôles
VII. Les individus face à l’autorité (2)
VIII. Permutation des rôles
IX. Les effets du groupe
X. Pourquoi obéir ?
XI. Les processus de l’obéissance
XII. Tension et désobéissance
XIII. Une autre théorie
XIV. Objections à la méthode
Synthèse de l’ouvrage
Préface
En certaines occasions, un ordre émis par une autorité extérieure peut entrer en conflit avec la conscience d’un individu. Le phénomène est généralement assimilé à la situation des soldats nazis chargés de l’Holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais, ce type de situation réapparaît continuellement sous de nouvelles configurations au cours de l’histoire, à l’instar du suicide collectif de Jonestown mené par le révérend Jim Jones en 1978.
Les soldats nazis comme les fidèles de Jonestown ne présentaient aucun trouble psychiatrique particulier. Si quelques rares personnalités, également saines d’esprit, ont une forte capacité de résistance, le choix entre une réaction d’obéissance ou de résistance dépend principalement du contexte de la situation d’autorité.
Les expériences présentées dans l’ouvrage ont eu pour objectif de mettre en lumière les différentes réactions comportementales face à une situation d’autorité particulière. La variation des conditions de chacune des dix-huit expériences a conduit à des positionnements psychologiques très différents. Les résultats furent, par conséquent, variables selon le degré de pression impliqué par la situation spécifique.
Chapitre I. Le dilemme de l’obéissance
L’obéissance à l’autorité est un phénomène structurant et un élément de cohésion d’une société. Deux visions s’opposent quant au degré d’obéissance souhaitable. Pour les conservateurs, l’obéissance à l’autorité doit toujours être privilégiée à la résistance, car elle assure la pérennité de l’édifice social. L’autorité, et non l’exécutant, est responsable. Pour les humanistes, l’Homme est responsable et sa conscience personnelle doit primer sur l’autorité.
Afin de déterminer vers laquelle de ces deux philosophies l’individu est porté, une première expérience fut réalisée, qui servit de base aux suivantes. Au sein d’un laboratoire de psychologie prestigieux, un « expérimentateur » accueillait deux individus volontaires pour participer à une expérience sur l’effet de la punition sur l’apprentissage. Après un tirage au sort truqué, l’un des deux individus, un acteur complice, devenait « l’élève ». Le second, le véritable « sujet », devenait alors le moniteur. Celui-ci devait d’abord lire à l’élève une liste de couples de mots. Puis, le sujet citait un mot et l’élève devait choisir la réponse parmi quatre propositions pour former le couple de mots exacts de la liste initiale. Pour chaque erreur, l’élève devait être sanctionné par le sujet, au moyen d'une décharge électrique au voltage croissant. Le sujet disposait d’un boîtier de trente manettes graduées tous les 15 volts, de 15V à 450 V. Elles étaient accompagnées des indications suivantes, par groupe de quatre manettes : choc léger – choc modéré – choc fort – choc très fort – choc intense – choc extrêmement intense – Attention : Choc dangereux – puis à partir de 435V, seul XXX était inscrit.
L’élève, sanglé cérémonieusement dans une pièce adjacente, ne percevait en réalité aucun choc, mais simulait une réaction aux décharges électriques selon un protocole établi à l’avance : pas de réaction jusqu’à 75V, puis il émettait des gémissements puis des plaintes ; à partir de 150V, il suppliait d’être libéré avec une insistance progressive au fur et à mesure de l’augmentation des chocs, jusqu’à refuser de répondre aux questions ; finalement après un dernier hurlement d’agonie, il ne donnait plus signe de vie lors des dernières décharges.
L’expérimentateur qui supervisait l’action du sujet tout en simulant une prise de note sur les réponses de l’élève, disposait lui aussi d’un protocole de quatre répliques à opposer au sujet en cas de refus de continuer : « Continuez s’il vous plaît. », « L’expérience exige que vous continuiez. », « Il est absolument nécessaire que vous continuiez. », « Vous n’avez pas le choix, vous devez continuer ! ». D’autres incitations particulières pouvaient également être énoncées selon la situation, notamment pour assurer du caractère inoffensif des chocs, simplement douloureux.
L’objectif était d’observer quand et comment la rupture du sujet avec l’autorité s’opérerait. Les observations furent inattendues. Malgré l’explication des modalités de l’expérience et la manifestation d’une appréhension de la part de l’élève, tous les sujets furent désireux de commencer. De plus, malgré l’absence de risque de répercussions en cas de refus d’obtempérer, 65 % des 40 sujets testés administrèrent le choc le plus élevé, et ce plusieurs fois de suite, avant que l’expérience prenne fin.
Les sujets n’étant pas des individus déséquilibrés, seule la pression des circonstances pesait sur leur décision. Pour neutraliser la tension psychologique, l’expérimentateur pouvait recourir à plusieurs ressources morales : la politesse, la parole donnée, l’embarras consécutif à un potentiel refus, et la décharge de responsabilité.
Dans cette situation d’autorité, les individus ont semblé refuser leur responsabilité en tant qu’adultes. Dans la majorité des cas, ils rendirent coupable l’expérimentateur, voire l’élève. Leur préoccupation première était de bien « faire leur devoir ». Malgré l’expression de leur totale désapprobation, très peu d’entre eux transformèrent leurs idéaux en acte par la rupture effective de la relation d’autorité avec l’expérimentateur.
Chapitre II. Méthode d’investigation
Le recrutement des participants s’est opéré par le biais d’une annonce parue dans le journal local de New Haven et d’un démarchage aléatoire sur l’annuaire de New Haven. Il était proposé de participer à une étude sur la mémoire et l’apprentissage à travers une expérience d’une heure, rémunérée 4,50 dollars. Le groupe de participants final était caractérisé par une certaine hétérogénéité concernant l’âge (au-dessus de 20 ans), la profession et le milieu social.
Selon les variantes de l’expérience, différents locaux furent utilisés : un laboratoire « luxueux » de l’université de Yale, un laboratoire plus modeste et un local totalement coupé de l’université, en dehors de la ville.
Le personnel mobilisé était constitué d’un professeur de biologie en tant qu’expérimentateur, à l’allure impassible et à l’expression sévère, ainsi qu’un comptable de 47 ans, amateur de théâtre, en tant qu’élève.
Pour assurer la crédibilité de l’expérience, elle était précédée d’une explication préliminaire sérieuse et documentée portant sur les bienfaits de la punition sur l’apprentissage. Un choc témoin était administré au sujet afin d’assurer ce dernier de leur existence.
L’expérience était suivie d’une interview post-expérimentale durant laquelle étaient révélées au sujet la supercherie et la nature réelle de l’expérience.
Chapitre III. Prévisions de comportement
Au cours d’une conférence sur l’obéissance, des questionnaires furent distribués aux auditeurs. Sans leur communiquer les résultats de l’expérience, il leur était demandé d’estimer ce résultat pour eux-mêmes et pour les autres. Tous les auditeurs ont jugé que tout individu, y compris eux-mêmes, se rebellerait un moment ou un autre. Le niveau moyen de désobéissance était estimé à environ 120-135V.
Il était en effet crucial de déterminer si cette différence relevait d’une simple ignorance de la nature humaine ou bien si elle jouait un rôle dans la société.
Chapitre IV. Proximité de la victime
Lors de la première expérience, l’élève n’était ni vu ni entendu du sujet (seuls des coups portés à la cloison étaient audibles de 300V à 315V). 26 sujets sur 40 administrèrent les chocs les plus élevés. Face à ces résultats et au calme apparent de certains sujets, il fut question de rapprocher progressivement l’élève afin de déterminer si ce taux d’obéissance n’était pas dû à une « inconscience » de la cruauté de l’acte et de la souffrance de l’élève.
L’expérience 2 introduisit le paramètre du feedback vocal. L’élève hors de vue était désormais entendu. Dans l’expérience 3, l’élève et le sujet se trouvaient dans la même pièce. Pour l’expérience 4, le sujet devait forcer physiquement l’élève à poser sa main sur la plaque transmettant la décharge électrique. Les résultats montrèrent que le taux d’obéissance diminuait à mesure qu’augmentait le rapprochement du sujet avec sa victime, passant de 26/40 (expérience 1) à 25/40 (expérience 2), 21/40 (expérience 3) et 18/40 (expérience 4).
Ce résultat s’explique par l’apparition d’un sentiment d’empathie vis-à-vis des souffrances de l’élève, mais aussi d’embarras face au regard porté par la « victime » sur son « bourreau », en particulier lorsque le facteur de soumission par la force est impliqué. Lorsque le sujet et l’élève sont dans la même pièce, on constate l’apparition d’un sentiment de solidarité entre les deux, contre l’expérimentateur. Le rapprochement peut également mobiliser des réflexes comportementaux acquis durant la vie du sujet, selon lesquels une infraction a plus de conséquences si elle est commise sur place que si elle est commise à distance.
Néanmoins, ces taux d’obéissance demeuraient supérieurs aux attentes. En effet, en raison de l’absence de toute mesure de coercition en cas de refus, « rien » en pratique n'entravait le libre arbitre des sujets. Pourtant, les sujets obéissants semblaient empêchés par une force inhibitrice irrépressible, de se rebeller.
Chapitre V. Les individus face à l’autorité (premier groupe)
Différents types de comportements furent observés au cours des quatre expériences précédentes. Parmi les sujets obéissants, un soudeur à l’air plutôt simple d’esprit et agressif, mais s’exprimant avec une grande déférence vis-à-vis de l’expérimentateur, s’exécuta avec application malgré une hésitation à 150 V. Au terme de l’expérience, il avait le sentiment du travail bien fait, sans autre ressenti que celui d’avoir mérité son salaire. Il en est de même pour un autre participant, un fraiseur, qui s’exécuta à une cadence lente et régulière (expérience 2). L’un comme l’autre a considéré que l’expérimentateur était responsable de la souffrance de l’élève, la décision de mettre fin à l’expérience lui appartenant. Un phénomène de dévalorisation de l’élève par les sujets fut également observé (son entêtement, son manque de coopération, sa stupidité…), à l’instar des nazis vis-à-vis des juifs. Aux yeux de ces deux sujets, l’élève était en partie responsable de ce qui lui était arrivé. Ces derniers n’avaient fait qu’exécuter les ordres.
Parmi les sujets résistants, un professeur de théologie invoqua l’éthique de l’expérience. Il craignait que l’expérimentateur n’ait pas mesuré l’impact médical, psychologique et affectif de la souffrance de l’élève. Il opposa son « droit à la désobéissance » dès 150 V. Un second sujet, un jeune ingénieur, continua les décharges avec un malaise croissant de 150 V à 220 V avant de cesser définitivement. Honteux d’avoir continué aussi loin, il estimait être entièrement responsable des souffrances infligées.
Chapitre VI. Autres variantes et contrôles - Expérience 5 : nouvel environnement
Une nouvelle série d’expériences fut menée pour déterminer les caractéristiques et l’influence de l’autorité. À cette fin, l’expérience 5 fut délocalisée dans un laboratoire moins luxueux, au sous-sol de l’université, afin de mesurer l’effet de l’environnement sur l’obéissance. En plus du feedback vocal introduit à l’expérience 2, il était indiqué au sujet, avant puis au cours de l’expérience, que l’élève avait des problèmes cardiaques, cela dans le but d’amplifier le conflit de conscience des sujets. Les résultats révélèrent l’impact réduit de ce paramètre, 26 sujets sur 40 administrèrent le choc le plus fort (contre 25/40 pour l’expérience 2).
L’expérience suivante cherchait à déterminer l’influence de la personnalité de l’expérimentateur sur le taux d’obéissance. À l’inverse des précédentes, l’expérience 6 fit appel à un expérimentateur à l’air doux et pacifique, tandis que l’élève semblait sévère et brutal. Le taux d’obéissance baissa légèrement, mais pas significativement, de 65 % à 50 %.
Pendant l’expérience 7, l’expérimentateur devait quitter la salle, afin de mesurer l’effet de sa présence sur le taux d’obéissance. Le résultat fut sans équivoque : seulement 9 sujets sur 40 continuèrent jusqu’au bout, tandis que certains d’entre eux trichaient et n’administraient que les chocs les moins élevés.
L’expérience 8 se concentrait sur les sujets féminins, traditionnellement considérés plus dociles, mais aussi plus sensibles et empathiques. Aucune différence avec les sujets masculins ne fut observée : 65 % de ces femmes administrèrent 450V.
Pour l’expérience 9, avant de signer la décharge de responsabilité de l’université, l’élève précisait clairement qu’en raison de fragilités cardiaques, il exigeait que l’expérience cesse à sa demande, s’il en ressentait le besoin. Le taux d’obéissance diminua de manière notable (40 %), mais la force de l’expérimentateur demeurait cependant significative.
Outre la force de l’expérimentateur, l’expérience 10 a montré que le soutien institutionnel jouait un rôle important dans la tendance à l’obéissance. Dès lors que l’étude perdait la garantie scientifique et morale de l’université de Yale, n’étant affiliée qu’à un simple « Comité de Recherches » inconnu, officiant dans un local hors de New Haven, le taux d’obéissance chutait (48 % seulement).
Dans l’expérience 11, pour mesurer la force du sadisme et de l’agressivité naturelle des individus, et comparer la situation à celle où ils sont soumis à une autorité, les sujets furent autorisés à administrer le choc du voltage de leur choix. Une première moitié des individus testés ne dépassa pas les premières plaintes émises par l’élève à 75V et la majorité du reste ne dépassa pas les 150 V (manifestation par l’élève de son désir d’arrêter). Seuls deux sujets administrèrent les voltages les plus élevés.
Chapitre VII. Les individus face à l’autorité (deuxième groupe)
Au cours de la série d’expériences suivantes, il s’agissait d’observer le comportement du sujet. Parmi les sujets obéissants, la plupart manifestaient une grande nervosité. Une inquiétude fréquemment invoquée était liée à la question de la responsabilité du sujet. Cependant, dès lors que l’individu était assuré que l’expérimentateur supportait l’entièreté de la responsabilité de l’expérience, il continuait.
Dans d’autres cas, un réel décalage entre l’action et le discours du sujet était constaté : s’il manifestait une forte désapprobation, il était incapable d’agir en conformité avec sa conscience en rompant effectivement la relation d’autorité avec l’expérimentateur.
À l’inverse, les sujets rebelles manifestaient une nervosité moindre, jusqu’à parfois, apparaître parfaitement insensible et ne manifester aucun embarras à refuser de poursuivre.
Chapitre VIII. Permutation des rôles
Les expériences qui suivirent cherchaient à déterminer la source de l’autorité : provenait-elle de l’ordre donné, du statut, de la personnalité ou de l’action ?
Dans l’expérience 12, après 150V, l’élève manifestait avec ferveur son désir de poursuivre l’expérience, tandis que l’expérimentateur recommandait l’arrêt. Aucun sujet ne continua l’expérience.
Dans l’expérience 13, le rôle de supervision tenu par l’expérimentateur était tenu par un individu « ordinaire », prétendument candidat à l’expérience, mais en réalité complice. Après les instructions, l’expérimentateur quittait la salle et laissait le sujet avec l’individu ordinaire devenu superviseur. Ce dernier devait suggérer l’augmentation de 15V à chaque erreur. Seulement 25 % des sujets obéirent jusqu’à 450 V. Dans une variante, l’individu ordinaire proposait aux sujets récalcitrants de les remplacer. Tous protestèrent fermement, cinq usèrent de la force physique pour l’en empêcher. Sans l’expérimentateur, les sujets étaient donc plus propices à agir de manière pacifique, voire héroïque.
L’expérience 14 ajoutait un élément supplémentaire : lorsque l’élève refusait de poursuivre l’expérience, il était remplacé par l’expérimentateur qui cédait son rôle de superviseur à l’individu ordinaire complice. Lorsque l’expérimentateur commençait à demander de cesser l’expérience, tous les sujets obéirent malgré les imprécations de l’individu ordinaire qui exigeait de continuer. Ainsi, l’ordre donné ne détermine pas l’autorité.
L’expérience 15 faisait intervenir deux expérimentateurs qui devaient être en désaccord quant à l’arrêt ou la poursuite de l’expérience à partir de 150 V. Pour résoudre ce dilemme, certains sujets tentèrent de déterminer l’ordre hiérarchique entre les deux autorités. Toutefois, la quasi-totalité mit fin à l’expérience.
Dans une variante de cette expérience (expérience 16), l’un des deux expérimentateurs devait tenir le rôle de l’élève. Malgré les plaintes de ce dernier et ses demandes de suspension de l’expérience à partir de 150V, le second expérimentateur ordonnait au sujet de continuer. En dépit de cette double autorité, le taux d’obéissance à l’expérimentateur-superviseur fut de 65 %, l’autre étant considéré comme un individu ordinaire.
Cette série d’expériences de double autorité démontre le besoin de cohérence des sujets en proie à l’incertitude. Le sujet recherche l’autorité la plus élevée et utilise pour cela tous les indicateurs en sa possession. En se plaçant dans le rôle de l’élève, l’expérimentateur de l’expérience 16 perdait vis-à-vis de son confrère, une partie de son autorité. Les sujets se portèrent donc instinctivement à suivre les ordres de l’expérimentateur dont la position ne faisait aucun doute. Ainsi, l’autorité procède non seulement du statut, mais aussi de l’exercice de cette autorité en un lieu dédié, selon un positionnement dans la société.
Chapitre IX. Les effets du groupe
L’expérience d'Asch avait déjà mis en évidence l’influence prépondérante du groupe sur le conformisme. Il s’agit ici de démontrer son influence sur la capacité à résister à l’autorité et la propension à obéir.
À cette fin, l’expérience 17 faisait intervenir trois sujets, dont deux complices. À partir de 150V, le premier moniteur se rebellait et refusait de poursuivre. À partir de 210V, le second moniteur l’imitait et cessait de participer. 36 sujets sur 40 désobéirent à un moment de l’expérience. Peu d’entre eux estimèrent que la réaction de leurs pairs avait influencé la leur. Pourtant, la pression du groupe agit nécessairement en montrant que l’idée de refuser est possible, en opérant une légitimation sociale de la désapprobation éprouvée par le sujet et en confirmant l’absence de répercussions. Les sujets estimaient cependant que la responsabilité était partagée.
L’expérience 18 fait également intervenir plusieurs sujets (deux), mais répartit les tâches entre eux : l’un est chargé de lire les mots et l’autre, d’administrer les décharges électriques. 37 sujets sur 40, continuèrent à lire les mots jusqu’à ce que l’élève ait subi les 450 V. En somme, la division des tâches est ainsi le moyen le plus efficace de faire accomplir aux individus des politiques iniques.
Chapitre X. Pourquoi obéir ? Analyse des causes de l’obéissance
Historiquement, la hiérarchie a toujours été perçue comme ayant des effets positifs sur la stabilité, la cohésion et la coordination au sein d’une société – tant sur le plan militaire, politique, social ou culturel. L’Homme présente ainsi une propension innée à l’obéissance qui est ensuite développée par l’éducation, issue de cet héritage historique.
L’intégration de cet instinct naturel aux structures sociales semble s’expliquer par l’existence d’une force inhibitrice naturelle, la conscience, qui régule les pulsions destructrices de l’individu (contrôle local). Cela permet, par la suite, d’initier le mécanisme de collaboration entre les individus par l’établissement d’un organe coordinateur externe, disposant d’un pouvoir de contrainte supérieur à celui de la conscience de l’individu.
Abandonnant en partie le contrôle local pour agir selon les ordres de l’agent coordinateur, l’individu quitte son état autonome pour se placer dans un « état agentique ».
Chapitre XI. Les processus de l’obéissance : application de l’analyse à l’expérience
La capacité de passer d’un état autonome à un état agentique procède d’un apprentissage. Dès l’enfance, l’individu apprend à accepter l’autorité hiérarchique familiale. Cet apprentissage se poursuit au sein d’un cadre institutionnel (l’école, l’organisation étatique) puis professionnel. L’individu apprend ainsi que la déférence et la soumission à l’autorité sont valorisées. Ce système hiérarchique assure son renouvellement et sa survie grâce à la récompense de ce type de comportement.
Au préalable, différentes conditions doivent être réunies. L’autorité doit être clairement identifiée soit verbalement, soit par ses attributs (un lieu spécifique, des signes distinctifs, l’absence d’éléments contradictoires). Une situation doit créer l’entrée (volontaire si possible) dans le système d’autorité (par exemple une lettre de conscription ou la participation à une expérience scientifique). Les ordres émis par l’autorité doivent être en lien avec sa sphère de compétences. Selon son domaine d’exercice, l’autorité peut être soutenue et facilitée par l’idéologie dominante (Sciences, Armée…). L’exercice de cette autorité est alors reconnu comme légitime.
À l’état agentique, l’individu se trouve dans une disposition mentale particulière. Il est plus réceptif aux instructions émises par l’autorité qu’à tout autre signal, notamment celui de sa propre conscience. L’individu cherche alors à faire preuve de compétence en exécutant sa tâche. Abandonnant son libre arbitre, il perd le sens de sa responsabilité et cherche auprès de l’autorité la reconnaissance d’une image positive de lui-même.
La pérennité de cet état agentique est favorisée par des mécanismes de maintenance. Parmi eux, on compte par exemple les conventions sociales faisant l’objet d’un consensus. Dans cette perspective, désobéir, c’est-à-dire refuser à l’autorité la déférence qu’elle s’attend à recevoir du fait de son statut, équivaut à rompre ce consensus social et provoque un sentiment de honte et d’embarras chez l’individu.
Chapitre XII. Tension et désobéissance
Dans les expériences effectuées, l’obéissance, favorisée par les mécanismes de maintenance, est source de tension. Cette tension traduit le fait que la conversion du sujet à l’état agentique est partielle. Elle est provoquée par la crainte des répercussions légales et la désapprobation de l’action par le sujet. L’éloignement de la victime et l’utilisation d’instruments intermédiaires minimisent cette tension.
L’individu tente d’éliminer cette tension par des mécanismes de résolution : des manifestations psychosomatiques (rires nerveux, transpiration, tremblements…), l’expression verbale de sa désapprobation, des actions de dérobade (détournement de la tête…) et des subterfuges (accentuation de la réponse, décharges électriques moins élevées…). Ces mécanismes visent à éviter la confrontation avec l’autorité par le refus. La désobéissance est l’effort psychique le plus éprouvant parmi les situations psychologiques mises en place par ces expériences.
Chapitre XIII. Une autre théorie : l’agression est-elle la clé ?
Certains, voyant les résultats de ces expériences, considérèrent qu’elles révélaient, chez l’Homme, une agressivité naturelle, sans cesse contenue. Cependant, certaines des expériences, notamment la 11 et la 13, infirment cette théorie.
Individuellement, le sujet aura tendance à manifester un caractère plutôt pacifique, voire héroïque, n’administrant que les chocs lui semblant inoffensifs ou défendant instinctivement le faible. À l’inverse, intégré dans une structure d’autorité, l’individu devient particulièrement dangereux, car il est alors capable de perdre toute faculté d’autolimitation et la responsabilité de ses actes.
Chapitre XIV. Objections à la méthode
Plusieurs critiques furent adressées aux expériences menées. D’abord, certains ont considéré qu’elle n’était pas représentative. Pourtant, elles furent testées sur un échantillon constitué de toutes catégories sociales, professionnelles, d’âge, de sexe et prélevé dans une ville de 300 000 habitants. En outre, elles furent également réalisées dans d’autres villes d’Amérique et d’Europe avec des résultats équivalents, voire supérieurs, tandis que d’autres méthodes d’échantillonnage avaient été pratiquées.
Une deuxième objection consistait à mettre en doute la crédulité des participants dans l’administration de réelles décharges électriques. Or, les interviews post-expérimentales et les questionnaires envoyés quelques mois plus tard confirment que les participants étaient presque tous persuadés de la véracité de la mise en scène (hormis quelques sceptiques).
D’autres ont dénoncé le manque de réalisme de l’expérience, qui ne correspondrait pas à une situation réelle. Au contraire, l’expérience mettait en scène les principaux éléments d’une situation de subordination, voire rendait la désobéissance plus aisée en prévoyant l’absence de mesures coercitives en cas de refus.
Chapitre XV. Épilogue
Le dilemme entre agir selon sa conscience et obéir est inhérent à la société, l’autorité étant à la base de toute construction sociale. Si ce dilemme est communément appliqué au nazisme et à la figure d’Adolf Eichmann, aucune période ni aucun individu n’est immunisé à ce phénomène.
Par exemple, les soldats américains au Vietnam ont commis des actes de barbarie qu’aucun n’aurait acceptés s’il avait dû en juger en toute indépendance. Mais, le soldat américain fait l’objet d’un processus d’intégration long et minutieux dans le système d’autorité de l’armée américaine. L’apprentissage du soldat, première étape du processus, lui apprend l’importance de la discipline et de l’obéissance, plus que les techniques de guerre. Il intériorise alors l’acceptation de l’autorité militaire. Le discours politique mettant en avant les valeurs démocratiques et de liberté défendues par l’Amérique au Vietnam a encore approfondi cette intériorisation. Ensuite, sur place, les questions de survie n’offrent plus la possibilité de remettre en cause les ordres reçus. Tuer sur ordre peut ainsi soudainement devenir un acte juste, récompensé, sans conséquence légale, une preuve de vertu morale (patriotisme, loyauté, devoir, discipline…).
*
Vous avez aimé cette synthèse ? Vous adorerez l’ouvrage ! Achetez-le chez un libraire !
Et pour découvrir nos autres synthèses d'ouvrage, cliquez ICI
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous




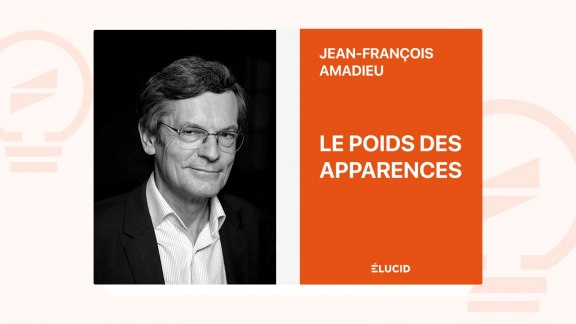
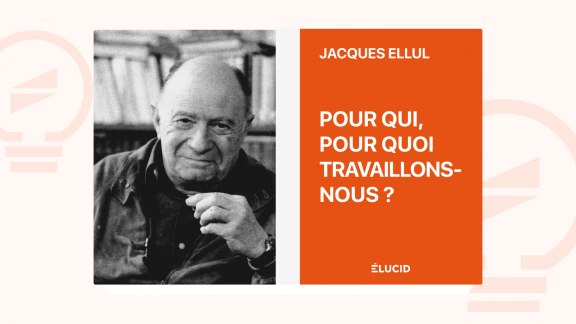

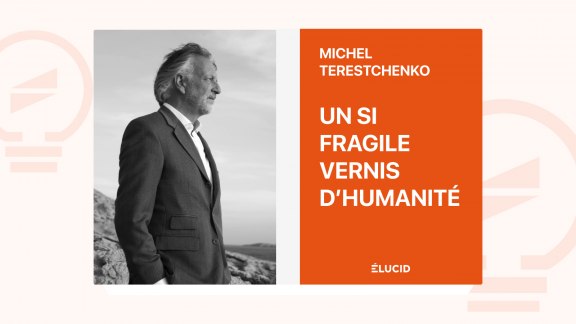
9 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner