Du prix Nobel d’Économie Joseph Stiglitz jusqu’à l’ancien président de la Réserve fédérale Alan Greenspan, nombreux ont été les analystes à estimer que la crise que nous traversons toujours pourrait être, finalement, pire que celle de 1929. Dans un entretien à visée historique inédit réalisé par Olivier Berruyer en 2012, Michel Rocard explorait un des aspects de cette crise : la dérégulation.



Abonnement Élucid
Michel Rocard (1930-2016), homme politique français, était diplômé de Science Po et de l’ENA. Inspecteur des Finances de profession, il fut Ministre du Plan et de l’Aménagement du territoire (1981-1983), Ministre de l’Agriculture (1983-1985), Premier ministre (1988-1991) et Député européen (1994-2009).
Olivier Berruyer (Élucid) : M. Rocard, quel regard portez-vous sur la crise actuelle ?
Michel Rocard : Il faut tout d’abord souligner que ce mot de « crise » est malcommode : il nous vient du vocabulaire médical, il décrit la phase forte de la maladie, et il laisse penser qu’à la fin de la maladie on retrouvera la santé, c’est-à-dire la situation normale. Et employer le mot crise laisse supposer que nous traverserions un moment difficile après lequel les choses reviendront comme avant, alors que ce n’est pas vrai ; ce qui se passe est complètement différent, c’est une mutation, c’est un changement progressif au bout duquel rien ne sera plus du tout comme avant… L’urgence est de construire un nouveau modèle de développement.
Il faut donc rappeler que l’humanité fait face à beaucoup de « crises » à la fois. L’une est écologique, une autre est économique — avec comme syndrome particulier, le chômage — et une troisième est diplomatique, avec de plus en plus de lieux de frictions. Au Moyen-Orient émergent des tensions extrêmement dangereuses ; le danger de guerre réapparaît. Face à cela, la crise financière n’est peut-être pas la plus grave, mais certainement la plus urgente, et la plus actuelle.
Comment en est-on arrivé là ? Tout commence en août 1971, lorsque le président Nixon décroche le dollar de l’or, donnant une volatilité nouvelle à tous les prix : non seulement des taux de change, mais aussi des matières premières, des produits, des taux d’intérêt, etc. Tous les fabricants d’articles lourds, tous ceux dont l’acte de production est long, et tous les commerçants de ce genre de produits cherchent alors à limiter la dangerosité de cette volatilité, et à s’assurer contre les hausses de prix — quand elles sont assurables.
Les ajustements par les taux de change des différences de croissance de la productivité, eux, ne sont pas assurables. C’est fatal, mais c’est régulier, lent et prévisible : on peut donc les anticiper. Les coups de sang des marchés, quand il y a une insuffisance momentanée de l’offre, sont en revanche assurables. Les exemples sont nombreux. Le plus frappant est celui du prix du cuivre au moment de la guerre de Corée, ou encore celui des denrées alimentaires en Afrique : lorsqu’un marché manque d’offre, et qu’il comporte une demande solvable, les prix peuvent s’enflammer, s’envoler, se multiplier rapidement par deux ou trois.
Pour s’assurer contre cela, la science financière a inventé les produits dérivés, c’est-à-dire des contrats d’assurance sur les prix annexés aux contrats principaux, lesquels touchaient les quantités ou les définitions de matières. Puis, progressivement, les marchés ont ajouté une deuxième invention, en déconnectant des contrats de base les assurances sur les prix.
Cela a donc permis de s’assurer contre les fluctuations de prix même sans disposer des matières concernées. Cela a été assez lent au début, mais en un demi-siècle, on a vu émerger des marchés virtuels de titres financiers, déconnectés de toute économie réelle. Soit des marchés qui n’ont pas de limites physiques en volume, que la production de liquidité financière suffit à faire fonctionner.
En parallèle, dans la logique intellectuelle du monétarisme, on a finalement à peu près abouti à interdire aux Banques Centrales de financer la monnaie — de la fabriquer, de la créer —, pour empêcher que les États fassent trop tourner « la planche à billets », et lutter contre l’inflation. En conséquence, les banques privées se sont approprié la création de monnaie et de liquidités. Bien entendu, elles s’y sont livrées principalement pour alimenter les marchés virtuels, et de moins en moins pour financer l’investissement et l’économie réelle.
Or, l’idée selon laquelle l’inflation serait liée à la quantité de monnaie pure me semble erronée : l’influence du facteur de la vitesse de circulation est infiniment plus grande. Mais comme on ne sait pas le gérer, on s’en prend donc à la quantité de monnaie, dans des conditions déraisonnables. Aujourd’hui, nous sommes dans ce « déraisonnable ».
O. Berruyer : Quelle est votre vision sur la dérégulation qui a eu lieu à cette époque ?
Michel Rocard : C’est le produit d’un système de pensée, le monétarisme, qui repose sur plusieurs postulats erronés.
Le premier est l’affirmation que le marché est globalement autoéquilibrant — dont la crise a montré l’inexactitude— et le second est que chaque équilibre de marché est optimal. Cela ne veut pas dire parfait. Cela signifie qu’il fait le meilleur partage possible entre tous les ayants droit sur ce marché, qu’ils soient des consommateurs, des salariés, des travailleurs, des investisseurs, des actionnaires, etc.
Par ailleurs, elle repose aussi sur une veille hypothèse du XIXe siècle : « Les ressources naturelles sont illimitées », qui a donné une seconde « La nature est indifférente à l’activité des hommes, elle est autoréparatrice. » Pour illustrer, il n’y a qu’à se rappeler de la phrase terrible de Nicolas Sarkozy disant « l’environnement, ça commence à bien faire ! » — alors que c’est le grand défi du XXIe siècle…
Mais pour en revenir à la crise, nous n’avons pas su interpréter les signaux avertisseurs de la crise, comme la faillite de LTCM ou d’Enron. Ensuite, nous avons subi la crise de 2008, qui a fait disparaître plusieurs centaines de — petites ou grandes — banques d’investissement, notamment les quatre plus grosses américaines. La crise s’est propagée aux banques générales, la plus grosse faillite ayant été celle de Lehman Brothers. Et nous n’avons pas été capables, depuis, de nous accorder à l’échelle mondiale sur des techniques de prévention contre ces phénomènes.
Aujourd’hui, les conditions de nouvelles bulles sont réunies. Premièrement parce que l’essentiel des liquidités disponibles n’obéit à aucune canalisation, aucune sollicitation fiscale, la moitié étant dans des paradis fiscaux. Deuxièmement, à cause de la masse : entre 20 et 100-150 trillions de dollars (milliers de milliards de dollars), selon les estimations, sont en attente de spéculation dissuasive là-dessus. Or depuis l’affaire des « subprimes », l’immobilier américain n’est plus une bulle unique : il a été régionalisé, a beaucoup changé de structure. Le risque d’une explosion est limité parce que ce marché a été un peu repris en main
O. Berruyer : Mais il y a d’autres bulles dans l’économie réelle, la plus grosse disponible actuellement étant l’immobilier chinois. Fin 2011, le ministre Chinois du logement a dit qu’il fallait s’attendre en 2012 à une baisse du prix de l’immobilier en Chine de l’ordre de la moitié. Combien cela fait de dizaines de millions de gens au chômage ? Combien cela fait de centaines de milliers de faillites ? On ne sait pas, mais cela sera terrifiant. Et cette crise a déjà commencé.
La majeure partie de la dérégulation financière a eu lieu dans les années 80, dans la plupart des pays, quelle que fût leur couleur politique — en France, le plus gros a été fait entre 1984 et 1986. Sur ce sujet, vous êtes aujourd’hui un des rares hommes politiques qui disent « Je me suis trompé »...
Oui, mais en la matière, la vraie question n’est pas de savoir si nous nous sommes trompés ou pas. Ce n’est pas non plus une affaire de précipitation. En réalité, nous n’avions surtout pas la culture, l’instrument intellectuel d’analyse et de compréhension. Personnellement, j’ai eu ma part dans ce mouvement en 1989-90, sous une double pression : celle de mon ministre des Finances, Pierre Bérégovoy — qui était plus « dérégulateur » que moi — et celle, énorme, de l’Allemagne. Pourquoi l’Allemagne ? Parce que la dérégulation était à ses yeux une condition pour arriver à l’Euro.
De mon côté, j’essayais de la bloquer car cela ne m’inspirait guère confiance. Pierre Bérégovoy sentait ma réticence, et — fait extraordinaire — j’ai appris la libération totale des mouvements de capitaux, mesure qu’il a mise en œuvre, par la presse ! J’avais beau être le Premier ministre, je n’avais pas l’armement intellectuel pour rester régulateur. Je ne pouvais que soutenir l’option de négocier avec l’Allemagne contre une promesse plus formelle d’aller vers le haut, que nous n’avions pas à ce moment-là. Ceci agaçait Pierre Bérégovoy, et, François Mitterrand lui donnant raison, le Premier ministre a été court-circuité.
« L’appareil mathématique « Milton-Friedmanien » était d’une extrême élégance. Les axiomes sont fabuleux : s’ils étaient vrais, ce serait formidable ! »
On a l’impression que les Inspecteurs Généraux des Finances au pouvoir à l’époque avaient tous cette idée de libéralisation à outrance, et que le monétarisme, en tout cas son programme de libéralisation financière, a été mis en place en France par la gauche. Comment une telle emprise intellectuelle a-t-elle été possible ?
La première réponse, c’est que je n’en sais rien ! Deuxièmement, ce n’est pas vrai pour tout le monde : il restait des keynésiens et des régulateurs. Fitoussi n’a jamais dérapé. La troisième réponse touche la manière de travailler des mathématiciens. Je ne suis pas du tout mathématicien — ce qui m’a valu un ostracisme de mon père, étant du coup taxé d’insuffisance intellectuelle…
J’avais appris un peu de mathématiques en faisant le Centre d’Étude des Programmes Économiques et j’étais très sensible à ce que les mathématiciens appellent l’élégance ou la beauté d’une démonstration. L’appareil mathématique « Milton-Friedmanien » était d’une extrême élégance. Les axiomes sont fabuleux : s’ils étaient vrais, ce serait formidable !
Or l’idée s’est diffusée qu’au fond tout cela était assez vrai. Et il est vrai aussi que cette génération avait encore le souvenir de l’économie de guerre, du rationnement, d’un excès de protectionnisme — dont nous ne sommes en fait sortis qu’avec le Traité de Rome. Nous avions en tête les inconvénients et les dysfonctionnements d’un excès de régulation mal faite, pas vraiment marchande. Nous n’avions pas encore, comme nous devrions le faire aujourd’hui, inventé la régulation d’une économie complètement marchande. Cela nous a rendus plastiques quant à la rationalisation de l’optimalité de ce vers quoi on s’acheminait.
« Gauche ou droite n’a plus grand sens de nos jours. Le vrai clivage, c’est régulateur ou non régulateur. Réguler l’économie n’est pas seulement une affaire de doctrine, c’est d’abord et avant tout une question de courage. »
L’Histoire du capitalisme montre qu’entre 1900 et 1930, il n’y avait pas, ou très peu, de régulation. La crise de 1929 a suscité une régulation très forte, qui a entrainé une période de prospérité très longue, sans grande ni petite crise. On a fini par déréguler de nouveau… et en moins de quinze ans, tout se casse la figure. C’est désespérant…
La conclusion logique serait : « Il faut re-réguler d’urgence, au moins un peu », mais rien ne se passe. Le Glass Steagall Act, par exemple — donc la séparation des activités bancaires — semble une mesure de bon sens, qui n’est pas spécialement de gauche ou de droite…
Gauche ou droite n’a plus grand sens de nos jours. Le vrai clivage, c’est régulateur ou non régulateur. Et il reste une force de la pensée dérégulatrice, que la crise n’a pas fait complètement disparaître, voire qui gagne toujours. Mais c’est une vieille affaire, dans l’humanité, de savoir que les idées évoluent beaucoup moins vite que les faits. Cela n’est pas nouveau, et ce n’est pas propre à l’économie, même si nous en avons là un exemple très précis. Je suis d’ailleurs complètement favorable à la séparation des activités bancaires.
D’abord, parce que l’histoire parle : soixante ans sans crise, c’est quand même fabuleux. Et aussi parce que cela me paraît être un moyen de préserver l’économie réelle, en cas d’explosion, de crash dans l’économie financière. Si les capitaux des dépôts — leurs volumes —, ceux des entreprises dans l’économie réelle, comme ceux des ménages, sont embarqués aussi, l’économie réelle est immédiatement en drame. Les protéger est quand même laisser une espèce de sphère arbitraire où s’expliquera la crise, où les actionnaires perdront leur chemise, mais sans trop toucher l’économie réelle. Et là, il peut rester un petit aspect local : je suis partisan de l’unilatéralisme pour commencer.
« Nous sommes dans un domaine où le moteur du courage est l’intelligence, la compréhension complète. Or, je suis très frappé […] du silence des vrais grands économistes. »
Vous avez une phrase très forte : « Réguler l’économie n’est pas seulement une affaire de doctrine, c’est d’abord et avant tout une question de courage ». Comment fait-on aujourd’hui pour qu’il y ait plus de courage ?
Nous sommes dans un domaine où le moteur du courage est l’intelligence, la compréhension complète. Or je suis très frappé, dans la période où nous sommes, du silence des vrais grands économistes. Les meilleurs ont bien compris que les paradigmes de Milton Friedman étaient démentis par les faits. Mais ils n’osent pas en prendre acte, et ils n’osent pas explorer les voies alternatives parce que le consensus n’est pas encore là, et que les positions mandarinales seraient menacées en cas de crise trop grave. Par conséquent, l’alimentation du courage politique par une conviction scientifique est encore insuffisante.
Propos recueillis par Olivier Berruyer le 15 mars 2012
Découvrez la suite de cet entretien en cliquant ICI
Photo d'ouverture : Michel Rocard, 7 janvier 1982, Paris - Michel Clément - @AFP
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

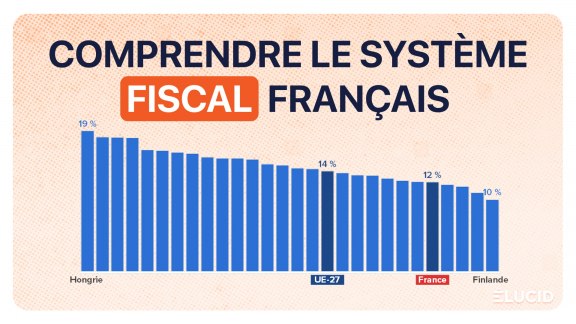






2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner