Afin de pallier les difficultés de recrutement de saisonniers, la FNSEA a développé un service baptisé « Mes saisonniers agricoles » en partenariat avec les ministères et les « partenaires emploi » de la Tunisie et du Maroc.

Confinement printanier, 2020. Le 24 mars, en dépit des mesures de confinement, le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume appelle les « inactifs » ou les personnes assignées au chômage partiel à « travailler dans les champs ». Cette déclaration est révélatrice : l’essentiel de l’agriculture nationale repose sur des emplois saisonniers habituellement pourvus par des dizaines de milliers de ressortissants venus de Roumanie, de Pologne ou du Maroc.
La crise du coronavirus confirme, une fois de plus, la formidable proximité du gouvernement avec la FNSEA, syndicat agricole majoritaire. En effet, le jour même de la déclaration de M. Guillaume, la FNSEA met en ligne une plateforme permettant la mise en relation entre agriculteurs et « volontaires », avec l’appui de Pôle emploi et de l’Anefa (Association nationale pour l’emploi et la formation des agriculteurs). Une semaine plus tard, plus de 200 000 personnes auront répondu à l’appel soviétisant « Des bras pour ton assiette », conformément à l’objectif annoncé par le syndicat.
Il faut dire que la FNSEA a le don des prophéties autoréalisatrices. Après avoir investi dans la banque, l’assurance, les oléoprotéagineux ou le biodiesel, le paquebot dirigé par Stéphane Rousseau vient de lancer un service destiné à fournir des saisonniers aux agriculteurs français. Ce « service de recrutement » de la FNSEA, intitulé « Mes saisonniers agricoles » repose sur « un partenariat avec les ministères et les partenaires emploi de la Tunisie et du Maroc », et ne proposera que des saisonniers recrutés hors Union européenne.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

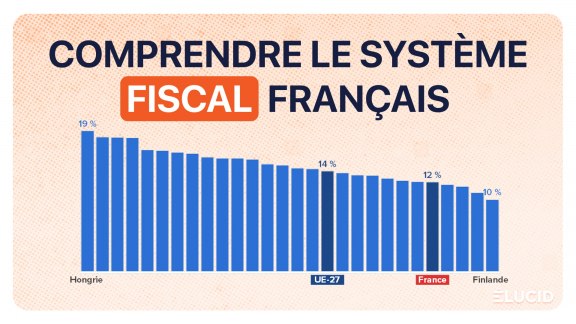
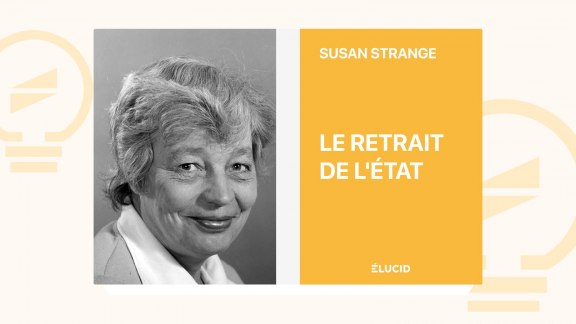





3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner