Loin d’avoir disparu au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les idéologies continuent de composer notre imaginaire politique. Karim Piriou les explore, en prenant soin de les resituer dans leur contexte historique et social, dans son premier livre paru aux éditions Nouveau Monde, qui porte le même titre que sa chaîne YouTube de vulgarisation politique et philosophique : Politikon.



Abonnement Élucid
Laurent Ottavi (Élucid) : Faut-il déduire du thème de votre livre que la fin des grands récits de la modernité et des idéologies, qui avait été annoncée lors de la seconde moitié du XXe siècle, ne s’est en réalité jamais produite ?
Karim Piriou (Politikon) : Vous faites sans doute référence à deux types d’approches à propos de la modernité et de ses idéologies, mais qui se ressemblent d’une certaine manière. D’une part, on aurait ce que le sociologue américain Daniel Bell appelait déjà en 1960 la fin des idéologies, ou ce que Francis Fukuyama thématisait à la fin des années 1980 sous l’expression de « Fin de l’Histoire ». Pour aller vite, l’idée est que rien de neuf en termes d’idéologies ne peut plus être inventé et que le progrès politique le plus abouti se trouve du côté de la démocratie libérale. On aurait donc atteint un point final dans le processus historique du développement de la modernité.
D’autre part, on serait arrivé à une époque marquée par la fin des grands récits, ou des méta-récits qui englobent nos manières de voir le monde. C’est la thèse que l’on retient le plus souvent du livre de Jean-François Lyotard, La condition post-moderne. La modernité comme, en quelque sorte, ère des idéologies totalisantes serait dépassée et l’on vivrait une époque dans laquelle on ne croit plus à de grands récits idéologiques notamment marqués par l’idée d’un progrès humain universel, où nous ne voyons le monde qu’à travers des imaginaires sociaux dispersés, parcellisés, souvent désabusés. Mais en un sens, on peut concevoir cette postmodernité qui a fait couler parfois trop d'encres comme une continuité d'une modernité qui a toujours été équivoque.
Du côté de la thèse de la fin de l’Histoire, on retrouve la célèbre phrase attribuée à Margaret Thatcher : « il n’y a pas d’alternative ». Le capitalisme et la logique du marché seraient donc indépassables. Qui plus est, à gauche, on fait souvent depuis de nombreuses années un constat d’impuissance. Tout se passe comme si le socle idéologique des socialismes avait perdu de son aura et qu’il avait perdu de son pouvoir mobilisateur.
Il y a donc toujours des idéologies, mais celles-ci semblent entrer dans un état de stagnation, dans lequel l’idéologie dominante est en crise et où les alternatives émancipatrices ne parviennent à s’engouffrer dans une brèche qui permettrait de changer les choses.
Mais cela ne signifie pas que les idéologies soient mortes. Nous sommes toujours immergés dans un bain idéologique minimal qui nous fait représenter la société à travers un imaginaire social, des valeurs, des normes, tous produits par une histoire sociale commune qui procède, en partie, de constructions intellectuelles ou institutionnelles. Nous n’avons ainsi pas de point de vue de nulle part qui nous permettrait d’avoir une représentation désincarnée du monde et de la société sans avoir une volonté de la voir changer ou non.
« Les idéologies procèdent toujours d’un contexte particulier. Elles ne sont pas de simples objets de débats théoriques déconnectés de l’histoire et du social. »
Élucid : Vous soulignez dans votre livre la forme plurielle que prennent les idéologies, leurs tensions, leur interpénétration avec d’autres. Quelle acception des idéologies avez-vous retenue dans votre livre et quelle méthode cela vous a-t-il conduit à choisir pour mieux les appréhender ?
Karim Piriou : Dans l’introduction, je repars de l’acceptation marxiste de l’idéologie comme un système de représentation qui nous fait voir la réalité à l’envers, de manière illusoire. Je reviens ensuite sur des conceptions moins négatives de l’idéologie pour montrer qu’elle peut avoir une fonction constitutive, qui permet la consolidation d’un groupe social plus ou moins large autour de deux choses : une manière de voir le monde et d’interpréter des valeurs telles que la liberté ou l’égalité d’une part, une volonté de le changer ou de le préserver d’autre part.
À partir de là se dégagent des blocs idéologiques comme le libéralisme ou le socialisme. Ces blocs s’insèrent d’une certaine manière dans un ensemble plus vaste constitué par un système de représentation qui, à grands traits, pourrait caractériser une modernité occidentale définie, entre autres, par l’importance accordée à l’individu et une conception du temps reposant sur l’idée de progrès. Ces ensembles idéologiques sont traversés eux-mêmes par des idéologies et des imaginaires sociaux aux effets bien concrets, qui structurent profondément les représentations et les manières de vivre : on peut parler du racisme ou du sexisme par exemple.
Évidemment, cette manière de voir les choses peut paraître un peu trop grossière, c’est pourquoi, malgré l’ambition synthétique du livre, je m’attache à préciser que ce qu’on appelle « idéologie » procède toujours d’un contexte historique et social particulier. J’utilise ainsi souvent des sources qui rappellent ces contextes pour éviter le biais qui nous ferait voir les idées politiques comme de simples objets de débats théoriques déconnectés de l’histoire et du social.
Pouvez-vous présenter en quelques lignes les principales idéologies de la modernité, d’une part, et les idéologies qui ont fait obstacle à la justice et à l’égalité dont la modernité était porteuse, d'autre part ?
En prenant soin de préciser que le nom et le contenu que l’on donne aux idéologies sont bien souvent des constructions postérieures à leur contexte d’apparition et que, chaque idéologie est porteuse d’une multitude de nuances et d’idées qui peuvent se recouper avec d’autres pensées, la modernité politique s’ouvre avec une nouvelle conception de l’État et de l’individu. La postérité intellectuelle retient l’émergence du libéralisme comme véritable première grande idéologie moderne. Celui-ci affirme la liberté individuelle face à l'arbitraire de l’État et consacre la prévalence de l’économie par rapport au tout social.
« Le clivage gauche-droite n'est pas obsolète : il permet de se définir selon notre attachement à l'égalité ou à la hiérarchie, et il est aussi un outil politique de repérage et de lutte contre des adversaires. »
Par la suite, en réaction aux changements intellectuels et institutionnels, un mouvement qu’on appellera conservateur se fait jour. Il lutte soit pour un retour en arrière ou contre des changements opérés de manière trop brusque. Au XIXe siècle, c’est le socialisme qui apparaît dans le contexte de la révolution industrielle et des nombreux bouleversements qu’elle produit. Il s’agit de lutter pour des progrès qui s’appuient sur une vision collective de la liberté et de l’égalité. À la même époque naissent les nationalismes, des pensées ambivalentes et souvent transversales à d’autres socles idéologiques.
Enfin, c’est au XXe siècle que s’affirment plus particulièrement des idéologies qui visent l’émancipation de certaines catégories dominées de la population : le féminisme ou les antiracismes, parmi bien d’autres. Entre-temps, des doctrines autoritaires qui se pensent comme des modernités alternatives sont nées, à l’instar du fascisme qui repose, pour aller vite, sur une volonté de régénération nationale et une exaltation de la force.
Votre livre est structuré autour du clivage gauche-droite. Pourquoi, lui non plus, n’est pas obsolète selon vous ? Pouvez-vous situer sur cette grille les principales idéologies de la modernité ?
Le clivage gauche-droite n’est pas obsolète, car il est toujours dans les têtes si l’on peut dire. Il sert encore, de par sa simplicité et malgré les nombreux appels à le dépasser, à structurer nos représentations du champ politique et des différentes manières de penser ce qui doit être fait ou pas dans la société. Dans le livre, je rappelle qu’il possède, d’une part, une définition plutôt philosophique à travers laquelle on peut caractériser la gauche et la droite à partir de critères bien particuliers comme l’attachement à l’égalité ou à la hiérarchie, et d’autre part, une dimension sociohistorique qui permet de voir que le clivage est aussi un outil politique de repérage et de lutte contre des adversaires.
J’essaie de mêler les deux approches, car bien qu’il soit toujours pris dans un contexte social et historique particulier, le clivage gauche-droite, pensé comme un résultat de la modernité occidentale, permet de se représenter les doctrines politiques qui ont pris leur essor en son sein. Celui-ci évolue, mais se structure toujours à peu près autour d’une interprétation de valeurs telles que la liberté ou l’égalité, que ce soit dans les discours et les déclarations politiques que dans les actes.
En omettant de nombreux recoupements et nuances, on pourrait placer à gauche des pensées qui cherchent à rendre concrète la liberté et l’égalité pour toutes et tous, qui pensent que le monde tel qu’il est comporte des injustices qu’il faut corriger. Des formes de libéralisme attachées à l’égalité politique ou l’égalité des chances peuvent se placer à gauche, avec les différents socialismes bien sûr, mais aussi les différentes pensées de l’émancipation comme les féminismes, les antiracismes ou certaines formes émancipatrices d’écologies politiques. On pourrait distinguer la gauche et l’extrême gauche par les stratégies à promouvoir, mais aussi par une volonté plus ou moins tenace d’abolition de toutes les formes d’exploitation et d’oppressions.
« Derrière les usages polémiques des mots propres aux batailles militantes, on peut dégager des critères qui permettent de distinguer le plus clairement possible des idéaux et des pratiques politiques. »
À droite, on aurait un attachement plus marqué pour la hiérarchie, que celle-ci soit pensée comme naturelle ou comme dérivant du fonctionnement de la société, à partir de l’idée de mérite ou de talents par exemple. On pourrait y placer un libéralisme plus enclin à laisser le marché seul distribuer les ressources produites. Le conservatisme y a également toute sa place. L’extrême droite peut se penser enfin comme le pôle de ce continuum politique le plus à même de produire ou de faire perdurer des hiérarchies fondées essentiellement sur des conceptions ethno-nationalistes et un ancrage autoritaire. On y trouve le fascisme par exemple, mais aussi les doctrines et pratiques autoritaires qui, malgré les discours, peuvent se révéler hostiles à la liberté et à l’égalité de manière concrète. Le stalinisme peut se concevoir dans cette perspective comme une idéologie reposant sur une doctrine d’extrême gauche qui, dans la pratique, se révèle aussi inégalitaire et oppressive que les doctrines d’extrême droite.
Je tiens à préciser ici que mon usage du clivage et du placement des idéologies sur son échelle pourra être jugé lui-même comme étant idéologique. Mais défaire la confusion, prendre du recul, implique dans la perspective du livre d’utiliser les sources les plus pertinentes issues de recherches récentes en histoire et en théorie politique et, de chercher à la fois la nuance et la cohérence la plus grande possible entre le socle théorique de chaque doctrine, ses valeurs clés, et les tentatives historiques de mise en pratique, leur concrétisation effective ou non.
Il s’agit donc de voir comment derrière les usages polémiques des mots propres aux batailles militantes, on peut dégager des critères qui permettent de distinguer le plus clairement possible des idéaux et des pratiques politiques. Ces critères doivent être toujours contextualisés historiquement pour comprendre comment ce qui peut être conçu à gauche hier peut être pensé comme étant à droite aujourd’hui. L’interprétation libérale de la liberté comme reposant sur des droits formels a pu être classée d’abord à gauche avant d’être déplacée vers la droite quand les socialismes ont cherché à défendre une liberté plus concrète couplée à une exigence d’égalité sociale.
Le néolibéralisme fait partie des idéologies les plus difficiles à cerner. Quel lien a-t-il avec le « libéralisme » et pouvez-vous expliquer en quoi il peut être autoritaire ?
Comme beaucoup de mots en politique, le terme « néolibéralisme » peut servir tout autant à qualifier un mouvement qu’à disqualifier un adversaire, ce qui fait qu’on peut facilement se perdre parmi toutes les acceptions utilisées. Malgré tout, les recherches historiques et philosophiques sur le sujet parviennent à dégager son assise doctrinale. Il est un courant de pensée qui a émergé sous ce nom dans les années 1930 pour renouveler un libéralisme qui présentait à ce moment deux visages : le premier était celui du libéralisme qu’on pourrait dire de l’école de Manchester, reposant sur le laissez-faire total, le second se faisait plus social et construisait les prémices de l’État-providence.
« Le néolibéralisme est un interventionnisme qui s'oppose à la fois au laissez-faire et, à l'inverse, aux demandes de justice sociale et aux mécanismes de redistribution. »
Au moment de ce qui pourrait être son acte de naissance, à savoir le colloque Lippman de 1938, le néolibéralisme s’est donc pensé comme ouvrant la voie à une troisième voie du libéralisme, une voie qui se servirait de l’État pour donner un cadre juridique solide, permettant à l’économie de se déployer sans obstacles sociaux et populaires. Le néolibéralisme est bien un interventionnisme, il s’oppose à la fois au laissez-faire et, à l’inverse, aux demandes de justice sociale et aux mécanismes de redistribution. Il peut donc se faire autoritaire quand il évacue les principes démocratiques ou les libertés politiques pour favoriser des règles qui servent un fonctionnement jugé optimal du marché au détriment des autres dimensions du social.
Le populisme, un mot très énigmatique lui aussi, constitue-t-il une idéologie à lui seul ?
À partir des travaux de Federico Tarragoni ou d'Enzo Traverso notamment, je distingue dans le livre un discours populiste qui oppose le peuple à des élites libérales et une doctrine populiste à part entière. Le discours populiste est transversal dans le clivage gauche/droite et repose sur une forme particulière de démagogie. Il peut se déployer pour donner une légitimité populaire à des mesures parfois très peu démocratiques, on parle dès lors de populisme de droite. Au contraire, le populisme comme idéologie propre cherche à rappeler la promesse démocratique du pouvoir par et pour le peuple.
Le populisme cherche donc à concrétiser l’égalité politique au sein du dispositif de la démocratie représentative, qu’on peut concevoir comme une construction politique émanant du libéralisme et des différentes luttes sociales du XIXe siècle. Il s’agit notamment d’aller à l'encontre d’une confiscation du pouvoir par les élites économiques et politiques. Pour Tarragoni, le populisme émerge particulièrement dans un contexte de crise démocratique ou de crise de la représentation.
Il peut se concevoir comme une idéologie particulière, qui se concentre sur un aspect du politique, mais qui, par rapport à des systèmes idéologiques plus massifs, n’offre pas de vision globale du monde tel qu’il est et tel qu’il devrait être. C’est pourquoi, en tant que discours seul qui ne cherche pas à proprement parler un véritable pouvoir du peuple, il peut être si aisément mobilisable par des acteurs politiques de tout horizon.
Le terme est encore une fois ambivalent, car il est fortement utilisé dans les discours médiatiques ou intellectuels pour disqualifier des positions sociales ou politiques, en pratiquant par exemple un déshonneur par association en amalgamant sous le vocable de « populiste » les demandes de changements démocratiques qui proviennent de la gauche et les appels au peuple qui proviennent de la droite la plus radicale. Plutôt que décrire une doctrine politique à part entière, le mot sert ainsi souvent dans les discours à délégitimer l’exigence d’une démocratie plus concrète.
« Nous sommes aujourd'hui dans un régime d’historicité où le passé n’est plus qu’à remémorer, où le futur est incertain, et où il ne reste donc qu’un présent dans lequel seul le court terme a du sens. »
Puisque vous rappelez que la modernité aurait pu prendre un autre visage que celui du libéralisme, pensez-vous possible que la modernité se transfigure à l’épreuve des défis d’aujourd’hui ?
Certains historiens des idées comme Quentin Skinner ont avancé l’idée que le libéralisme n’était pas le premier « courant » à avoir repensé la liberté à l’époque moderne. Un courant dit républicaniste, inspiré notamment de l’Antiquité, a ainsi émergé pendant la Renaissance italienne et a inspiré les révolutionnaires européens et américains. La conception républicaniste repose davantage sur une conception civique et collective de la liberté que celle qui a été mise en avant par le libéralisme, qui se présente comme plus individualiste et détaché de l’État. On peut donc imaginer que si cette version avait prévalu, la modernité aurait peut-être présenté un visage différent. Selon les hasards techniques ou intellectuels, les réussites et les échecs de différents camps politiques, on peut envisager des déterminations différentes, des modernités alternatives, des sortes d’uchronies idéologiques.
En ce qui concerne l’état actuel de la modernité, il peut sembler difficile de dresser un constat net sur ses transformations actuelles. Ce qui semble certain, c’est que le changement climatique va opérer une transformation majeure dans nos manières de vivre et de nous représenter le monde social. Pour le moment, les choses semblent encore stagner, notamment à travers ce que l’historien François Hartog appelle le présentisme. On est ici dans un rapport au temps – un régime d’historicité pour le dire comme Hartog – où le passé n’est plus qu’à remémorer, où le futur est incertain, et où il ne reste donc qu’un présent dans lequel seul le court terme a du sens.
À travers tout ça, on peut se demander : quelles seront les analyses futures des historiens et sociologues sur notre époque ? Sera-t-elle décrite comme toujours moderne ? Post-moderne finalement ? Ou à partir d’un terme qui n’a pas encore été inventé ?
Propos recueillis par Laurent Ottavi.
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


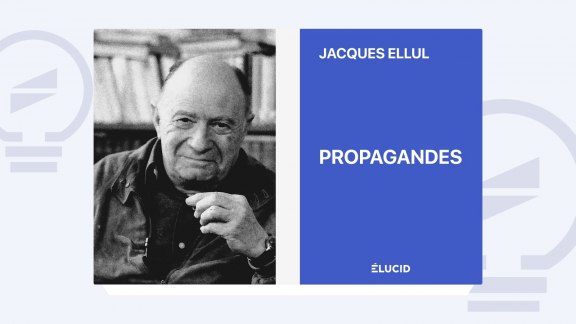





0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner