Plus d’un quart de la population mondiale n’a pas accès à une eau potable, avec d’inévitables conséquences sur la santé. Et la moitié des lits d’hôpitaux dans le monde sont occupés par des personnes atteintes d’une maladie liée à l’eau. Pendant ce temps, les gros acteurs industriels et agricoles se la coulent douce. Ils accaparent les ressources en eau et prélèvent des quantités supérieures à la capacité de renouvellement des nappes phréatiques. Le tout dans une quasi-indifférence politique, puisque le droit à l'eau, bien que reconnu par les Nations Unies, mais limité à un usage personnel et domestique, ne permet pas de contrôler les secteurs les plus prédateurs que sont l'agriculture industrielle et les industries extractives.



Abonnement Élucid
Pendant l'été, Élucid vous propose de (re)découvrir certaines de nos analyses graphiques fondamentales sur différents sujets essentiels et toujours d'actualité (date de publication originale : 24 décembre 2024).
Les rapports s'enchaînent sur le changement climatique et ses effets délétères sur la quantité et la qualité des ressources en eau. Parmi les plus récents, celui de l'ONG Oxfam tire la sonnette d’alarme : plus d’un quart de la population mondiale n’a pas accès à une eau potable, avec d’inévitables conséquences sur la santé.
Le changement climatique s’accompagne d’une augmentation des sécheresses, des inondations et des événements climatiques extrêmes qui affectent simultanément la quantité et la qualité de l'eau douce. Un phénomène qui se développe dans un contexte où déjà plus de deux milliards d’individus dans le monde n'ont pas accès à une eau potable salubre et abordable. Si on ajoute les personnes qui subissent des restrictions temporaires d'accès à une eau saine, c'est presque la moitié de la population mondiale qui est concernée dès aujourd’hui. Et d’ici 2050, un milliard et demi de personnes supplémentaires seront privées d'un accès à l’eau douce du fait du changement climatique.
Une crise de l'eau aggravée par le changement climatique
Le rapport du groupe II du GIEC sur l’eau est clair, c’est tout l'équilibre du cycle de l'eau à l'échelle planétaire qui est bouleversé. Le réchauffement climatique provoque une augmentation des températures moyennes qui accentue l'évaporation de l'eau des sols et des plans d'eau avec des conséquences sur la circulation atmosphérique et donc les régimes locaux de précipitations. Certaines régions du monde connaissent ainsi des pluies plus intenses et plus fréquentes et avec elles des risques accrus d'inondations. À l’inverse, d'autres régions font face à des périodes de sécheresse plus longues et plus sévères. Les régions arides et semi-arides, déjà confrontées à un stress hydrique important, sont particulièrement vulnérables.
Autre répercussion du changement climatique, la fonte des glaciers et du manteau neigeux, avec des effets majeurs sur les ressources en eau douce et les populations qui en dépendent pour leur approvisionnement. Dernier point, la fonte des calottes glaciaires et la dilatation thermique de l'eau de mer contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Avec pour conséquences directes des risques d'infiltration d'eau salée dans les aquifères côtiers et une vulnérabilité accrue de ces zones aux risques d'inondations.
Comme le note le rapport, les effets délétères du réchauffement climatique sur les ressources en eau frappent les populations de façon inégale. Les plus pauvres, à la fois dépendantes de l'agriculture pluviale et disposant d’un accès limité à l’eau et à l’assainissement, sont les plus exposées aux pénuries et aux maladies hydriques.
Les inégalités de genre, en particulier chez les plus démunis, sont aussi renforcées par les difficultés d’approvisionnement en eau douce. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans sept ménages sans eau courante sur dix, ce sont les femmes et les filles qui sont responsables de la collecte de l'eau pour les besoins domestiques. L'aggravation des pénuries d'eau alourdit leur charge de travail et limite leur accès à l'éducation et aux opportunités économiques.


Un accès à l'eau douce entravé met aussi en péril la santé des populations avec des risques sanitaires (choléra, diarrhée, typhoïde) qui touchent particulièrement les enfants et les personnes âgées. En 2020, le GIEC rapportait déjà « 2 milliards de personnes qui n’ont pas accès à de l'eau non contaminée et 771 millions qui ne disposent pas de services d'assainissement de base, principalement en Afrique subsaharienne et dans les zones rurales ». Et la moitié des lits d’hôpitaux dans le monde sont occupés par des personnes atteintes d’une maladie liée à l’eau.
Même les pays riches ne sont pas épargnés, le traitement de l'eau potable peut être compromis par la dégradation de la qualité des sources d'eau et les événements météorologiques extrêmes comme les sécheresses, les tempêtes, etc. La modification du cycle de l’eau participe de plus à une baisse des rendements agricoles qui va de pair avec une insécurité alimentaire croissante. Entre 1961 et 2006, la perte de rendement agricole s’élevait à 25 % du fait des sécheresses, des tempêtes, des inondations directement liées au changement climatique.
Entre 1983 et 2009, les trois quarts des superficies mondiales exploitées ont connu des pertes de rendement liées à la sécheresse, avec des pertes de production évaluées à 170 milliards de dollars. Le manque d’eau accroît de plus le risque de compétition entre les différents secteurs (agriculture, industrie, domestique) et les besoins (urbains, ruraux) avec des pressions supplémentaires sur la gestion de bassins déjà soumis à des contraintes, tels que le Nil, l'Indus, le Colorado, l'Océan Indien ou encore la Méditerranée.
Les habitations et infrastructures sont aussi menacées de destruction par les inondations et les glissements de terrain du fait de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des fortes précipitations. Comme le précise le rapport :
« Les précipitations moyennes annuelles augmentent dans de nombreuses régions du monde […]. Près d'un demi-milliard de personnes vivent dans des zones subissant des conditions de précipitations historiquement peu familières […]. Plus de 700 millions de personnes subissent de fortes précipitations, nettement plus intenses que dans les années 1950. »
En 2019, ce sont plus de 6 millions de personnes du sud de la Chine qui ont été touchées par de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain, avec un bilan terrible d’une centaine de morts, 100 000 maisons détruites ou endommagées, plus de 400 000 ha de cultures sinistrées, et une perte économique évaluée à 3 milliards de dollars.
Accaparement de l'eau : quand le profit prime sur le bien commun
Les effets du réchauffement climatique se cumulent à la pression sans précédent sur les ressources en eau douce qu’exercent la croissance démographique et l'essor des activités industrielles et agricoles. Depuis 1900, la demande en eau douce a été multipliée par huit quand, dans le même temps, la population mondiale a augmenté d’un facteur cinq. Si cette tendance se prolonge, la demande mondiale en eau devrait croître de 20 % à 30 % d’ici 2050.
Gourmandes en eau, l'agriculture et l’irrigation comptent pour 60 % à 70 % des prélèvements mondiaux d'eau douce selon les données du GIEC. L'irrigation, souvent pratiquée de manière excessive et peu efficiente, contribue largement à l'épuisement des nappes phréatiques et à la dégradation des écosystèmes. À l’échelle de la planète, « 10 % des bassins les plus touchés par le stress hydrique représentent 35 % de la production mondiale de calories irriguées, et la production alimentaire est menacée dans ces bassins et dans le monde entier en raison de l'évolution des composantes hydrologiques du changement climatique ».
En 2021, selon l’ONG Oxfam, plus de 500 milliards de dollars de subventions publiques accordées dans le monde ont été considérés comme nuisibles à l’environnement, notamment car destinés à des systèmes d’irrigation qui provoquent l’épuisement des aquifères.


À cela, il faut ajouter l’essor des activités industrielles, notamment dans les pays émergents, qui engendre une demande croissante en eau pour la production d'énergie, la fabrication de biens de consommation et l'extraction des ressources naturelles. Au final, agriculture et industrie comptent pour 90 % des prélèvements mondiaux d'eau douce.

Et la tendance n’est pas à l’accalmie du côté de la demande en eau. Avec la progression des niveaux de vie, les régimes alimentaires évoluent vers une consommation accrue de viande et de produits laitiers, tandis que l'engouement pour les produits manufacturés s’intensifie ; ensemble ils contribuent à l'augmentation de « l'empreinte eau » mondiale.


C’est dans ce contexte qu'Oxfam relève que des acteurs majeurs industriels et agricoles, mus par la recherche du profit, s'approprient les ressources en eau au détriment des populations locales et de l'environnement. Cet « accaparement » de l'eau se traduit par une privatisation de sources d'eau auparavant publiques, par l'obtention de permis d'exploitation exclusifs ou par la construction d'infrastructures (barrages, pipelines) qui modifient le cours naturel de l'eau.
Conséquence, ces entreprises « prédatrices » d'eau prélèvent des quantités excessives qui dépassent la capacité de renouvellement des nappes phréatiques. Elles mettent en péril la disponibilité de l'eau pour les usages essentiels des populations locales. Leurs activités polluent les eaux de surface et souterraines, menaçant la santé des écosystèmes et des populations.
Dans ce jeu de dupes, les processus décisionnels liés à la gestion de l'eau excluent les populations locales qui en supportent pourtant les conséquences. Il faut dire que cet accaparement de l'eau s'inscrit dans un contexte de mondialisation économique et de relations inégales entre pays du Nord et pays du Sud. Les 200 millions d’habitants de la Corne de l’Afrique connaissent, à cause d'une sécheresse qui sévit depuis 2017, l’une des pires crises alimentaires mondiales depuis 1945. Pourtant, 1 000 milliards de litres d’eau ont été prélevés par l’industrie dans cette région en 2020...
Le concept d’« empreinte eau » permet de mieux comprendre ce phénomène en quantifiant la quantité d'eau nécessaire à la production de biens et services. Les pays riches externalisent ainsi leur « empreinte eau » en important massivement des produits agricoles et manufacturés provenant de pays où l'eau est moins chère et les réglementations environnementales plus laxistes. Cet accaparement de l'eau est souvent lié à l'accaparement des terres, avec les entreprises étrangères qui investissent dans de vastes plantations agricoles dans les pays du Sud pour produire pour les pays du Nord, au détriment des petits agriculteurs et des communautés locales.
Les États-Unis et l’Europe importent ainsi des fleurs produites dans des zones vulnérables du Kenya qui affectent profondément la quantité et la qualité des sources d’eau pour les communautés locales. En 2021 et 2022, l'Éthiopie a pour sa part exporté pour plus de 4 milliards de dollars de biens tels que du café, des huiles, des légumes, de la viande ou des fleurs. Des marchandises très consommatrices d'eau dont la moitié était destinée à l’Europe et aux États-Unis.
Les industries extractives, le business de l’eau en bouteille et l’agro-industrie : les premiers à se servir
Les industries extractives, comme l'exploitation minière, pétrolière et gazière, sont de grandes consommatrices d'eau. Ces activités sont souvent localisées dans des régions déjà soumises au stress hydrique où la recharge naturelle des nappes phréatiques est limitée et où la dépendance en eau est forte : l’Arabie Saoudite, le Texas aux États-Unis, le Mexique, le Niger ou l’Afrique du Sud. L’extraction s’accompagne souvent du rejet des eaux usées contaminées par des métaux lourds, des produits chimiques et des hydrocarbures, ce qui pollue les sources d'eau locales et menace la santé des populations et des écosystèmes.
Même des pays historiquement épargnés par le manque d’eau sont aujourd’hui concernés. En Colombie, par exemple, la compagnie pétrolière Perenco utilise neuf barils d'eau douce pour produire un seul baril de pétrole. Ce pays, traditionnellement peu concerné par les restrictions d’eau douce, a pourtant subi de plein fouet les conséquences de la sécheresse de l’Amazonie. L’été dernier, la capitale Bogotá et sa banlieue, soit 12 millions d'habitants, ont fait face durant plusieurs mois à des coupures d’eau par secteur pendant 24 heures tous les neuf jours – des conditions hydriques nouvelles qui mettent en compétition les usages industriels et communautaires de la ressource d’eau douce.
Évidemment, les communautés locales n’ont généralement pas voix au chapitre. Les entreprises extractives opèrent sans les consulter et violent leurs droits à l'eau, à la santé et à un environnement sain. C'est le cas au Niger où l'exploitation de l'uranium par Orano (ex-Areva) a contaminé la nappe phréatique d'Arlit pendant des décennies, menaçant l'approvisionnement en eau potable de plus de 100 000 personnes. Autre exemple : l’installation d’une usine de transformation de phosphate en Tunisie a contribué au déclin des oasis locales ; les agriculteurs se battent aujourd’hui pour survivre à cause du manque d’eau.
Lueur d’espoir, de plus en plus de communautés expriment leurs inquiétudes concernant l'épuisement des réserves d'eau locales en raison de l'accaparement par l'industrie. C’est le cas par exemple en Argentine, où des communautés patagoniennes se sont opposées à l’exploitation de gisements de gaz de schiste pour préserver à la fois leur agriculture et leurs ressources en eau.
Symbole fort de la problématique d’accaparement de l'eau, le business de l’eau en bouteille. Ce n’est pas moins d’un million de bouteilles vendues dans le monde chaque minute. L’industrie de l’eau en bouteille puise dans des réserves censées être le bien commun pour les vendre 150 à 1 000 fois plus cher que l'eau du robinet qu'elles contribuent à discréditer via des campagnes marketing, comme le révélait un rapport de l’Institut pour l'eau, l'environnement et la santé de l'UNU en 2023. Et les prévisions de chiffre d’affaires du marché mondial à l’horizon de la fin de la décennie sont plutôt encourageantes pour l’industrie, avec une croissance attendue de près de 20 % pour atteindre les 425 milliards de dollars.


Ce système génère une discrimination d'accès à une ressource essentielle avec les populations les plus pauvres souvent contraintes de payer un prix exorbitant pour une eau potable, tandis que les entreprises réalisent des profits considérables. C’est le cas du milliardaire chinois Zhong Shanshan, qui a bâti son empire Nongfu Spring en extrayant l’eau de rivières et de montagnes. Son entreprise occupe la première place du secteur de l’eau en bouteille en Chine, avec une part de marché nationale d’environ 20 %.


Sans compter que les prélèvements d’eau des nappes phréatiques dépassent souvent leur capacité de renouvellement. Effet boule de neige, le stress hydrique s'aggrave et menace l'accès à l'eau des populations locales, en particulier dans les régions arides ou semi-arides. Il convient d'ajouter l'impact environnemental désastreux de la distribution massive de bouteilles plastiques, qui contribue à la pollution et à la dégradation des écosystèmes. Pourtant, assurer l’accès universel à l’eau potable, un des objectifs de développement durable des Nations Unies, ne coûterait que la moitié de ce que le monde paie chaque année pour l’eau en bouteille...
Autre secteur en cause dans l’accaparement de l’eau, l'agriculture industrielle avec des surfaces agricoles irriguées qui ont augmenté de 60 % en 50 ans. En cause, l'élevage industriel et la production d'agrocarburants particulièrement gourmands en eau et en terres – deux secteurs qui ont consommé presque la moitié des trois milliards de tonnes de céréales produites en 2019. La culture du soja pour l'alimentation animale, par exemple, est responsable d'une déforestation massive et de l'accaparement de l'eau en Amérique latine.
Même les États-Unis ont été victimes de l’accaparement de leurs terres et de leur eau par une entreprise étrangère pour produire de la nourriture pour le cheptel bovin d’Arabie saoudite. Depuis près d’une décennie, l’État de l'Arizona loue des terres à une entreprise saoudienne, lui permettant de pomper toute l’eau dont elle a besoin pour faire pousser foin et luzerne qu’elle exporte ensuite pour nourrir ses vaches laitières sur les terres du royaume. Pendant des années, l’État d’Arizona n’a pas su quelle quantité d’eau l’entreprise consommait dans un contexte de sécheresse aggravée par le changement climatique. Une aubaine pour l’Arabie saoudite, où la culture industrielle de cultures fourragères telles que la luzerne est interdite afin de préserver ses réserves limitées en eau. Ce phénomène avait déjà été relevé par le GIEC dès 2009 :
« Les pays importateurs de denrées alimentaires qui ont des contraintes en matière de terres et d'eau, mais qui sont riches en capitaux, tels que les États du Golfe, sont à l'avant-garde des nouveaux investissements dans les terres agricoles à l'étranger. En outre, les pays à forte population et préoccupés par la sécurité alimentaire, comme la Chine, la Corée du Sud et l'Inde, recherchent des possibilités de produire des denrées alimentaires à l'étranger.
Ces investissements visent les pays en développement où les coûts de production sont beaucoup plus faibles et où la terre et l'eau sont plus abondantes […]. Il est essentiel de veiller à ce que ces transactions foncières et l'environnement dans lequel elles s'inscrivent soient conçus de manière à réduire les menaces et à faciliter les opportunités pour toutes les parties concernées. »
Quand les grandes entreprises agro-industrielles ont souvent un accès privilégié à l’eau, c’est au détriment des petits agriculteurs qui peinent à irriguer leurs cultures et à subvenir à leurs besoins. Ce phénomène aggrave les inégalités socio-économiques dans les régions rurales comme dans la région d’Ica au Pérou, où l'agro-industrie, encouragée par les exportations, a surexploité des ressources en eau souterraine, menaçant la survie des petits agriculteurs et les populations urbaines.
Manque de régulation et collusion des pouvoirs publics : un terrain favorable à l'accaparement
Le droit à l'eau, bien que reconnu par les Nations Unies, est souvent limité à un usage personnel et domestique, laissant le champ libre aux dérives de l'agriculture industrielle et des industries extractives. Si 2023 marque l’année du premier sommet sur l'eau depuis 1977, cette conférence n’avait pas dans ses objectifs le sujet de l’accaparement de l’eau. À l’échelle mondiale, il n’existe aucune réglementation pour empêcher l’exportation ou l’importation de produits très consommateurs d’eau.
Et dans de nombreux pays, la législation relative à la gestion de l'eau est inexistante, incomplète ou inadaptée pour faire face aux défis de l'accaparement par des acteurs privés puissants. De manière générale, les entreprises sont très peu surveillées et contrôlées. Même les pays développés, disposant pourtant de structures administratives et législatives bien établies, sont concernés. Et ce ne sont pas que les États-Unis, berceau du Far West et du culte de l’entreprise, qui sont touchés.
En mai 2023, en France, les pouvoirs publics ont limité pendant deux mois des prélèvements souterrains à cause d’une importante sécheresse. Pourtant, Danone, entreprise aux 900 millions d'euros de bénéfices et plus d’un milliard d’euros de dividendes en 2023, a été autorisée à pomper dans la nappe phréatique… et même à continuer pendant l’été qui a suivi.
Ces phénomènes de privatisation des ressources naturelles vitales sont exacerbés lorsque les institutions sont plus faibles. Au Mexique, c’est la libéralisation du marché de l'eau dans un contexte de corruption endémique qui a conduit, depuis 1992, à une monopolisation de l’approvisionnement en eau douce de la population, avec 2 % des titulaires de concessions qui contrôlent 70 % du volume d'eau.
Sans oublier que les victimes d'accaparement de l'eau sont souvent des communautés locales démunies ou aux ressources limitées, qui peinent à faire valoir leurs droits face à des entreprises puissantes, dotées de moyens financiers et juridiques considérables. Pendant ce temps, les citoyens participent peu aux prises de décisions relatives à la gestion de l'eau et sont insuffisamment sensibilisés aux enjeux liés à l'eau et à son accaparement...
Photo d'ouverture : R_Tee - @Shutterstock
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


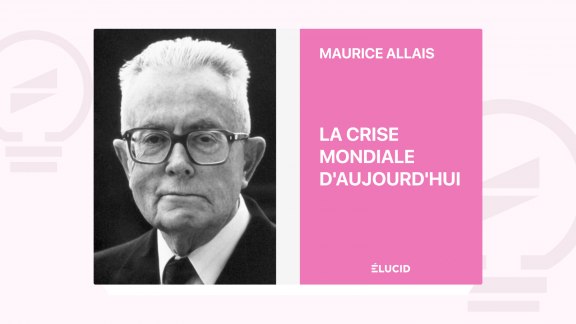
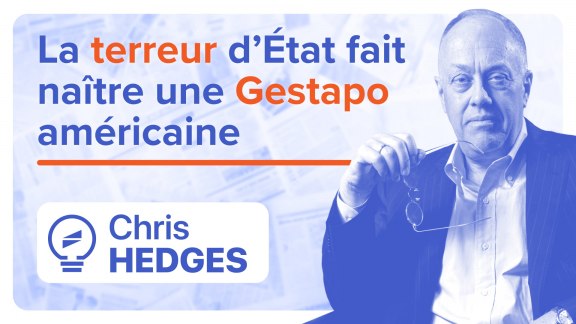




5 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner