Le combat contre l’ethnocentrisme occupe les anthropologues depuis maintenant plus de deux siècles et représente encore aujourd’hui une menace pour notre compréhension de « l’Autre ». Dans La société contre l’État (1974), Pierre Clastres dénonce la vision évolutionniste et ethnocentrique des américanistes.

Podcast La synthèse audio
Œuvre d’une vie, l’ouvrage regroupe une série d’articles publiés entre 1962 et 1974, tous réunis par un seul et même objectif : comprendre pourquoi les tribus amérindiennes, au contraire des sociétés occidentales, n’ont jamais connu l’émergence d’une structure étatique.
Ce qu’il faut retenir :
Victimes d’une tendance naturelle à l’ethnocentrisme, les anthropologues du XIXe siècle ont transmis une image caricaturale des tribus amérindiennes. Ces communautés, analysées à l’aune des valeurs occidentales, sont traditionnellement décrites comme des sociétés morcelées, en situation de guerre quasi permanente, sans État, sans écriture, sans histoire ou sans surplus économique.
L’image d’un système primitif où règnent la division, la violence et la guerre est en partie imaginaire : les relations que ces sociétés entretiennent entre elles ne sont pas toujours conflictuelles, mais, au contraire, sont unies par un puissant réseau d’alliances matrimoniales.
Loin d’être régis par une économie de subsistance, les villages amérindiens subviennent à leurs besoins au-delà même du nécessaire, en travaillant moins de quatre heures par jour – le reste du temps étant consacré à des activités rituelles (chant, mythe, parole, épreuve initiatique, etc.).
La fonction du rite et de la parole dans les sociétés primitives est bien plus essentielle qu’il n’y paraît. Ils permettent de consolider l’esprit de corps et de rappeler la loi fondamentale qui régit la tribu : « tu n’auras pas le désir du pouvoir, tu n’auras pas le désir de soumission ». Autrement dit, la structure même des sociétés primitives garantit l’égalité entre les membres du groupe et interdit l’apparition de tout pouvoir coercitif – donc étatique. Elles ne sont donc pas sans État, mais contre l’État.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


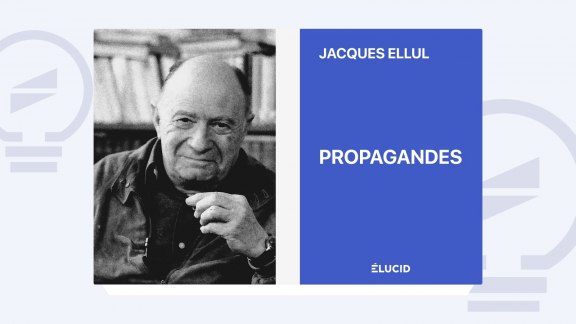


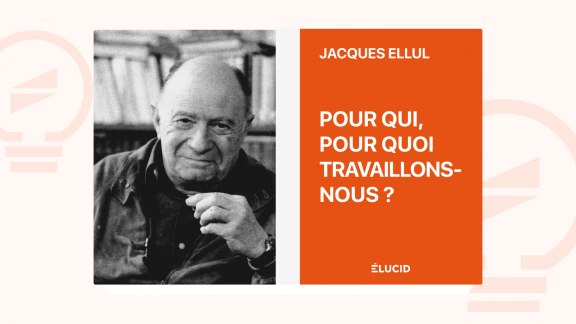


3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner