Ancien Gouverneur de la Banque de France, Michel Camdessus revient sur les troubles économiques et financiers qui rongent nos sociétés depuis plus d’une dizaine d’années. Dans cet entretien inédit réalisé Olivier Berruyer en mai 2013, il nous livre son analyse de cette crise qui, selon lui, trouve son origine dans « une lacune de régulation, une lacune institutionnelle et une lacune éthique ».



Abonnement Élucid
Né en 1933, Michel Camdessus, ancien élève de Sciences Po et de l’ENA, a occupé divers postes politiques depuis les débuts du développement du néolibéralisme dans les années 1980. Il a été Directeur du Trésor (1982-1984), Gouverneur de la Banque de France (1986-1987) et Directeur Général du FMI (1987-2000). Il a également été membre du Conseil pontifical Justice et Paix, organe papal qui avait pour mission de promouvoir « la justice et la paix selon l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église catholique ».
Olivier Berruyer (Élucid) : M. Camdessus, quel regard portez-vous sur la crise actuelle ?
Michel Camdessus : Rien ne serait plus dangereux que de prendre cette crise pour un simple retournement conjoncturel – violent, certes, mais ordinaire. Il ne s’agit pas d’une crise de plus dans la mondialisation, mais de la première crise de la mondialisation.
Elle est certes financière, mais telle l’hydre à sept têtes de la mythologie, la crise financière fait système avec au moins six autres crises : pauvreté du tiers-monde, crise climatique, crise alimentaire, crise énergétique, retour à l’unilatéralisme dans les relations internationales et crise culturelle – sept crises au total.
Il faut toutes les prendre en compte pour régler l’une d’elles, d’autant que toutes trouvent, d’une manière ou d’une autre, leur origine dans l’avidité individuelle et collective – les philosophes diraient « dans le choix de l’avoir plutôt que de l’être ».
O. Berruyer : Comment en sommes-nous arrivés là ?
M. Camdessus : Plus j’avance dans l’analyse de cette crise, plus je ne lui trouve guère de meilleure explication qu’une modeste parabole : il s’est passé dans le village global la même chose que ce qui se passait autrefois dans les villages de mes Pyrénées d’origine.
La vie y était réglée par un conseil municipal – groupe de sages, d’artisans et d’agriculteurs – qui devait gérer les affaires importantes de la commune, comme par exemple définir à quel moment ouvrir la chasse à la palombe, la pêche au saumon, à quelle date fixer les vendanges. Le garde-champêtre faisait respecter la loi et les décisions municipales. Enfin, le curé et l’instituteur se disputaient tout le temps, mais ils faisaient pénétrer dans les esprits des principes éthiques finalement assez voisins.
Mais voilà : si un événement majeur venait à se produire et que, pour une raison ou pour une autre, les Hommes étant ce qu’ils sont, le Conseil municipal préférait ne pas s’en mêler. Qu’au même moment le garde-champêtre était inattentif, que le curé et l’instituteur se chamaillaient ou regardaient ailleurs, il s’instaurait alors ce que mes ancêtres appelaient le règne des voleurs de poules.
Ceux-ci étaient les plus malins, les plus agiles et les moins scrupuleux. Ils tiraient leur épingle du jeu, mais l’effet de contagion de la malhonnêteté et du chacun pour soi était néfaste. Chacun était atteint ; un vide éthique s’instaurait… On finissait par s’en remettre après bien des efforts, mais le village n’était plus exactement le même. Les fondements éthiques de la vie collective avaient été atteints.
Dans le « village global », la même chose s’est produite. Le grand événement a été la financiarisation de l’économie. Les technologies de l’information ont répandu des techniques bancaires sophistiquées jusqu’aux limites du monde ; un immense marché de l’argent a été créé. Face à cet événement, les autorités mondiales n’ont pas été en mesure de réagir. Nul n’était habilité à poser les règles nécessaires à son bon fonctionnement.
Avec la révolution néolibérale incarnée notamment par Mme Thatcher et le Président Reagan, l’État était hors-jeu. « L’État est le problème, non la solution », disait Reagan. Les régulateurs étaient invités à laisser ce nouveau marché se développer en toute liberté tandis que les transactions monétaires seules demeuraient sous la surveillance du FMI.
Par conséquent, la tentation a été forte pour les banques d’inventer des instruments leur permettant de loger sur ce nouveau marché financier des opérations qui, sur le marché monétaire, n’auraient pu se développer avec la même exubérance ni avec les mêmes profits ! C’est ce qui s’est produit avec la « titrisation », la fuite vers le « hors-bilan » quasiment hors de toute règle et de toute surveillance prudentielle.
Comment expliquez-vous ces dérives des financiers ?
Les mœurs collectives des professions financières se sont subrepticement dégradées. Tous les banquiers ne sont évidemment pas des voleurs de poules, mais leurs mœurs collectives ont eu tendance à s’aligner sur le moins-disant en termes d’éthique.
Ainsi, sur un marché sans règle ni garde-champêtre – puisque l’autorité du FMI s’arrêtait à la frontière du marché financier – bon nombre d’acteurs se sont mis à se comporter comme des gens sans foi ni loi. Leurs comportements ont fini par servir de référence, même si quelques voix multipliaient les mises en garde.
Nous avons ainsi abouti à ce qu’Alan Greenspan a appelé en 1996, « l’exubérance irrationnelle ». Cette remarque n’a en rien troublé le consensus global qui préconisait le « laisser-faire ». Un formidable dérèglement fait autant d’erreurs techniques lourdes que de fautes morales graves en est résulté. La liste est longue de ces fautes morales. On peut en discerner à tous les stades de la crise.
« Avec quelque recul, nous percevons le côté immoral de ces agissements. Mais ne faut-il pas d’abord souligner ce qu’ils comportaient d’imprudence, ou de simple mépris des règles élémentaires que suggèrent le bon sens et la raison ? »
Lesquelles par exemple ?
Il est par exemple contraire à toute éthique de consentir des prêts risqués à des personnes dont la solvabilité est loin d’être établie et dont on sait qu’il suffira que les taux d’intérêt augmentent un peu trop ou que le marché immobilier se retourne pour qu’elles soient amenées à tout perdre. Ceci est arrivé à trois millions de familles aux États-Unis, victimes d’un régime instauré sous le couvert de bonnes intentions, mais qui s’est révélé irresponsable et criminel.
Il est également contraire à toute morale de vendre aux épargnants des instruments financiers mélangeant du subprime à haute rémunération mais risqué, à des titres ordinaires et classiques du marché monétaire, sans révéler exactement quelle est la composition du cocktail et sans informer suffisamment ceux qui allaient acheter ces instruments « dynamiques », comme on disait, des risques véritables qu’ils prenaient en les acquérant. Quelques banquiers m’ont confié qu’eux-mêmes ne savaient pas très bien ce que contenaient ces produits ou quel en était le risque.
Il y a eu aussi manquement à l’éthique de la part des régulateurs et des autorités financières à laisser se développer un climat dans lequel la recherche de la maximisation des profits à court terme était la seule loi, et où l’on encourageait, par le régime des rémunérations, la frénésie des vendeurs de titres et l’imagination débridée de l’ingénierie financière.
Dans beaucoup d’établissements financiers, à l’inverse des vieilles habitudes de prudence financière, ceux qui évaluaient les risques et avaient autrefois le dernier mot ont vu leur influence réduite au profit des vendeurs de produits et de tous ceux qui contribuaient à maximiser les profits à court terme. Le métier de banquier était ainsi subrepticement subverti.
Avec quelque recul, nous percevons le côté immoral de ces agissements. Mais ne faut-il pas d’abord souligner ce qu’ils comportaient d’imprudence, ou de simple mépris des règles élémentaires que suggèrent le bon sens et la raison ?
En effet, n’était-il pas naïf, au-delà de tout bon sens, de compter sur les mécanismes d’autorégulation à l’intérieur des institutions financières pour prévenir tout dérapage du système, alors que les mécanismes d’incitation et de rémunération extravagants invitaient délibérément au contraire ?
Pouvait-on laisser se perpétuer un système d’endettement de plus en plus détaché du niveau réel des fonds propres, transformant de grands segments du système financier mondial en véritables pyramides, plus respectables, certes, que celles de Bernard Madoff, mais très gravement exposées au moindre resserrement de la liquidité dans un univers bancaire dont on avait tout simplement oublié que l’illiquidité est le risque financier premier ?
Était-il imaginable que des régulateurs laissent le modèle de gestion des banques être ainsi subverti ? Était-il raisonnable pour la communauté des banques centrales de laisser perdurer à ce point un tel régime de facilité monétaire dans une phase de haute conjoncture mondiale ? Était-il responsable, pour le G8, de ne pas prendre plus agressivement en main le problème des déséquilibres globaux des balances des paiements au risque d’exposer leurs économies à une catastrophe ?
Comment analysez-vous ces dérives ?
Le fait que notre monde se soit installé ainsi – en insouciant passager d’un « bateau ivre » – dans l’« exubérance irrationnelle», le fait qu’aucune résistance sociétale ou citoyenne suffisamment vigoureuse ne se soit organisée, le fait que des dirigeants responsables se soient laissés emporter dans ce dérapage collectif, soulèvent en effet une question que j’ai retournée cent fois : comment cela a-t-il pu être possible ?
« L’homme se trouvait réduit, dégradé, à sa seule fonction économique. »
Une première réponse vient à l’esprit : c’est que tout le monde y trouvait son compte et rêvait de voir se poursuivre quelque temps encore cette euphorie avant que ne s’opèrent les ajustements dont on sentait la nécessité, mais pour lesquels aucun consensus ne se formait. Cette explication ne peut suffire : elle ne peut rendre pleinement compte de cet abandon collectif à l’irrationnel. Il fallait que ces comportements s’enracinent dans un contexte culturel où la séduction de l’argent soit telle, qu’elle entraîne une sorte d’aveuglement collectif et que toutes les vigilances soient désarmées.
Or, ce contexte prévalait, malgré bien des protestations contre la marchandisation du monde. Depuis les « 30 Glorieuses », les pays avancés – de plus en plus imités par les pays émergents – ont laissé se substituer à une économie sociale de marché et à ses valeurs de bonne gestion, de liberté, de solidarité et de justice, une économie utilitariste de type néolibéral fondée sur le « gagner plus pour consommer toujours plus », aboutissant même au « endettez-vous plus pour consommer plus ».
L’homme se trouvait réduit, dégradé, à sa seule fonction économique. On a assisté à une course permanente entre la poussée des désirs exacerbée par la publicité et les capacités collectives à les satisfaire, d’où le stress, la frustration et la fragilisation de la cohésion sociale.
Comme l’a dit Jean-Claude Eslin, « La consommation devenait destin » ; la vie se vidait de sens. La cupidité devenait peu à peu politiquement correcte, s’installant partout au cœur de la culture collective. C’est ainsi que se constituait un terreau fertile pour tous les abus de la sphère financière jusqu’à son quasi-effondrement. Un modèle d’avidité généralisée creusait le vide éthique dans lequel l’économie mondiale s’est engouffrée et, avec elle, une part de ce qui fait notre civilisation.
Résumons-nous : comme le village de nos ancêtres, le « village global » a souffert de trois défaillances majeures : une lacune de régulation, une lacune institutionnelle et une lacune éthique dans les comportements collectifs. Si nous voulons corriger cette situation, il faut combler ces trois lacunes.
Vous avez évoqué une lacune en ce qui concerne la régulation. Quels sont pour vous les principaux chantiers ?
Michel Camdessus : Ils sont nombreux : je pense à la lutte contre les paradis fiscaux, la normalisation des hautes rémunérations, l’éradication des conflits d’intérêts, la transparence et la traçabilité des opérations financières, la lutte conte le caractère procyclique des règles comptables, l’amélioration des fonctions de contrôle…
Nous avons publié un rapport qui révèle, par exemple, l’ampleur du pillage de l’Afrique à travers les dispositifs financiers opaques qui régissent les transactions minières et pétrolières. Ce rapport souligne l’urgence et l’importance des changements à introduire en matière de transparence des transactions et de normalisation du régime des paradis fiscaux.
O. Berruyer : J’imagine que vous avez été régulièrement confronté à des résistances à la régulation ?
M. Camdessus : Oui, bien sûr ! À titre d’exemple, je peux vous raconter mes échanges avec Mme Thatcher. Quand je suis arrivé au FMI, début 1987, le problème le plus urgent était celui de la dette des pays en développement et émergents. Nous étions dans une impasse. Mes prédécesseurs et moi-même comme directeur du Trésor avions poussé aussi loin que possible, en particulier dans le cadre du Club de Paris, les formules de rééchelonnement des dettes.
Mais cela ne suffisait plus. Compte tenu des taux de croissance relativement limités de ces économies, il n’y avait pas de sortie possible, puisqu’on ne voyait pas comment les taux de croissance pourraient devenir supérieurs aux taux d’intérêt. Ces pays ne pouvaient que continuer à s’enfoncer dans l’impasse.
« Thatcher m’a répondu : "Il ne faut jamais faire la leçon aux banquiers". Pour elle, les institutions d’État, même le Trésor britannique, n’ont pas à donner de leçons aux banquiers. »
Les banques s’en étaient rendu compte et avaient commencé à provisionner ces risques dans leurs comptes. Elles devenaient de moins en moins disposées à faire de nouveaux crédits pour aider ces pays à refinancer leur dette. Le système était bloqué. Avec quelques-uns de mes collaborateurs, j’en arrivais à la conclusion qu’il fallait oser la réduction de dette. Non pas un « rééchelonnement de la dette », mais une « réduction » du capital emprunté, donc acceptation de la perte provoquée par les débordements de crédits des années 1970.
Mais, les mots « réduction de dette » étaient tabous. Avant de le prononcer pour la première fois, il fallait préparer le terrain. Je m’y suis employé pendant presque toute l’année 1987 et ce n’est que dans le courant de l’année 1988 que j’ai prononcé pour la première fois la phrase : « We must reduce the debt ». Beaucoup ont été stupéfaits. Certains banquiers ont hurlé, d’autres m’ont traité d’irresponsable, mais six mois après, la réduction de dette faisait partie du nouvel arsenal anti-crise.
Nous étions parvenus à le faire adopter par les instances dirigeantes du FMI, et il ne nous restait plus qu’à le faire accepter par les différentes communautés bancaires. Aux États-Unis, à Wall Street, le Trésor américain avait fait un travail sérieux de persuasion, mais en Europe, cette idée continuait de susciter des réserves. J’avais donc décidé d’essayer de convaincre les banquiers réunis au sein du Club de Londres.
Mme Thatcher m’a alors demandé de passer la voir et dès le début de notre conversation, elle m’a demandé la raison de ma présence à Londres puisque le Royaume-Uni n’avait plus recours au FMI comme du temps de ses prédécesseurs travaillistes. Je lui ai expliqué que les instances du Fonds avaient décidé de réduire la dette et que je venais donc évoquer cette question avec les banquiers.
Elle m’a répondu : « Il ne faut jamais faire la leçon aux banquiers ». Pour elle, les institutions d’État, même le Trésor britannique, n’ont pas à donner de leçons aux banquiers. Sa logique était que les banquiers savent ce qu’ils doivent faire ; ils ont leurs comptes d’exploitation, et le marché est là pour les guider. Les institutions n’ont pas à s’en mêler et à suggérer quoi que ce soit aux banquiers. Le marché sait mieux que quiconque ce qui est bon pour l’économie.
Je ne l’ai évidemment pas suivie… Il reste que le village global s’est trouvé désarmé devant les dégradations progressives des mœurs financières sur cet immense marché laissé hors contrôles.
Propos recueillis par Olivier Berruyer le 29 mai 2013
Découvrez la suite de cet entretien en cliquant ICI
Photo d’ouverture : Discours de l'ancien directeur général du FMI, Michel Camdessus, Washington, 2 juillet 2014 - Jim Watson - @AFP
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


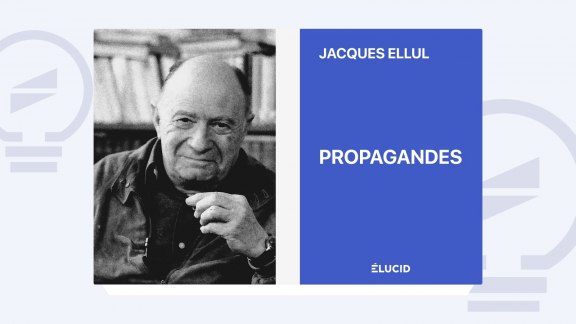





0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner