Le gouvernement français plancherait sur la création d’un fonds de 100 millions d'euros pour accueillir des chercheurs américains désireux de fuir la politique de Donald Trump visant la communauté scientifique. En cause, les coupes budgétaires, les licenciements au sein des agences fédérales américaines chargées du climat ou de la santé, le retrait des accords de Paris, etc… Si l’intention française est louable, il y a un fort risque de douche froide pour les scientifiques américains qui tenteront l’aventure dans l'hexagone. Ils seront rapidement confrontés à la mauvaise santé de la recherche française, qui produit de moins en moins de publications et de brevets, avec des investissements en baisse et des politiques publiques de relance à la peine. En ligne avec l’incongruité de cette annonce, le même gouvernement annonce un mois plus tard près de 500 millions d’euros de coupes dans la mission « recherche et enseignement supérieur ». L’opération d'accueil de chercheurs américains ressemble de plus en plus à un dépouillement supplémentaire des chercheurs français et de la recherche hexagonale, mis au pain sec et à l’eau depuis maintenant des décennies.

S'il est admis que la recherche et l'innovation permettent de faire face aux crises et aux défis à venir, alors la France a hypothéqué son avenir. En cause, un manque de vision stratégique qui se traduit par des politiques peu efficaces. Pourtant, pour le ministère des Finances, l’innovation reste la source des profits.
Décrochage de la France en R&D : diminution du nombre de publications et innovation en berne
La R&D, diminutif de « recherche et développement », vise à développer des innovations, c'est-à-dire les applications industrielles et commerciales d’une invention ou d’une découverte. En économie, cela regroupe donc l’ensemble des processus qui permettent de passer de la recherche fondamentale ou appliquée à la production industrielle en usine. Les publications scientifiques et les dépôts de brevet sont des indicateurs qui permettent de mesurer les difficultés de l’hexagone dans le domaine.
Le verdict est sans appel : la France décroche en matière de production de brevets et de publication d’articles scientifiques. Sur l’année 2022, la part mondiale de publications de la France s’élève à 2,3 %, ce qui la classe derrière le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie. Pour le syndicat UNSA Éducation, qui a publié début 2025 une note d’analyse intitulée « Le lent désinvestissement de la France dans la R&D », « la part des publications scientifiques mondiales détenue par la France, comme par l’ensemble des pays européens, diminue tendanciellement au profit des pays émergents ».
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


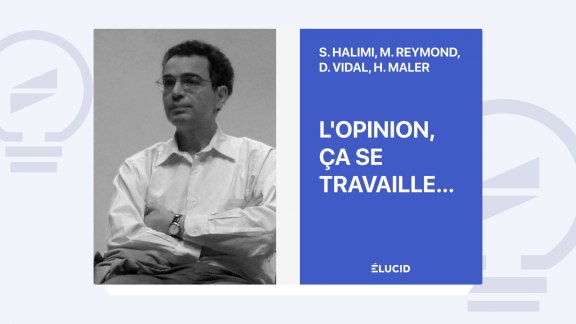

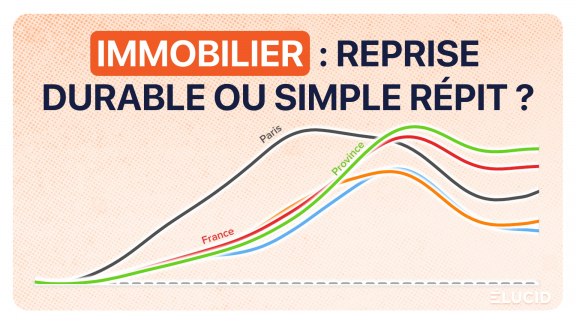
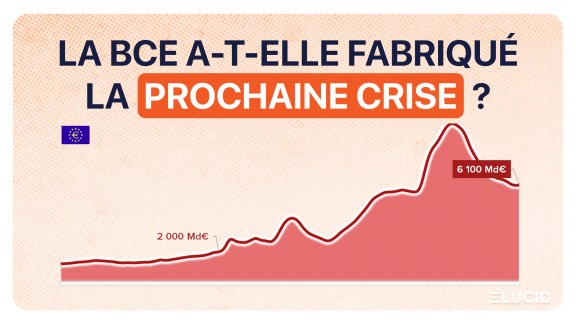


3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner