Dix-sept ans : c'est le temps qui s'est écoulé depuis le dernier référendum, marqué par un mépris cuisant de la volonté exprimée du peuple français. Ce rejet de la démocratie réelle ne date pas d'hier. Se replonger dans l'histoire oubliée de la Ve République, entre combats des républicains et pressions de l'oligarchie néolibérale, permet de mieux comprendre la défiance des citoyens envers des institutions qui sont censées les représenter.



Abonnement Élucid
Il y a presque soixante ans, le 28 octobre 1962, le peuple français approuvait par référendum le principe de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Proposée par de Gaulle, cette réforme – la première de la Ve République créée quatre ans auparavant – représentait une extension considérable du rôle joué par le suffrage universel dans la vie politique nationale. Dès 1965, l’élection présidentielle devint en effet l’élection phare du régime voulu par de Gaulle.
Pour réaliser cet approfondissement démocratique, le président français dut pourtant affronter l’opposition à peu près unanime des médias, des élus et des juristes. Le conflit se cristallisa sur une question de droit : pour contourner l’opposition des assemblées, et conformément à ses vues constitutionnelles, de Gaulle décida d’en appeler au peuple par voie référendaire.
Mais il fut contraint à fonder sa démarche sur le seul article 11 de la constitution (prévoyant un référendum d’initiative gouvernementale) plutôt que sur l’article 89 relatif à la révision de la constitution. Le Conseil d’État s’opposa formellement à ce choix ; le Conseil constitutionnel, de son côté, préféra se démettre en se déclarant incompétent après que ses membres eurent fait part officieusement de leur hostilité au projet.
Cependant, au-delà de sa dimension juridique, la réforme proposée par de Gaulle avait tout pour susciter une crise politique majeure, tant elle heurtait frontalement la culture républicaine forgée près de cent ans plus tôt, dans les premières années de la Troisième République. Depuis cette époque, les Républicains étaient résolument hostiles à l’idée d’un pouvoir exécutif fort par crainte du pouvoir personnel et des dérives autoritaires, dont le parcours du « prince-président » Louis-Napoléon Bonaparte, futur empereur, avait démontré la vraisemblance pendant la IIe République : élu en décembre 1848 à la présidence de la République au suffrage universel, il avait détruit de fait le régime républicain par son coup d’État du 2 décembre 1851.
Le souvenir de cette époque, ajoutée au culte de la Convention révolutionnaire, cristallisa en profondeur, dans la culture républicaine française, la nécessité absolue d’une primauté du législatif sur l’exécutif, la supériorité des chambres, siège d’un pouvoir collégial, sur un chef de l’État et un Président du Conseil que leur solitude rendait dangereux pour les libertés publiques. Cette supériorité s’ancrait précisément dans l’élection au suffrage universel direct de la chambre basse qui conférait à cette institution une légitimité incomparablement supérieure à celle d’un chef de l’État élu seulement, sous la IIIe République, par les parlementaires.
La réforme proposée par de Gaulle s’attaquait donc aux croyances les plus solidement établies de la culture républicaine, elle se proposait d’en détruire le socle pour en fonder une nouvelle. C’est pour cela qu’elle suscita une opposition quasi générale et passionnée, et des débats qui rapidement montèrent aux extrêmes. Guy Mollet, ancien Président du Conseil, socialiste rallié à de Gaulle en 1958, affirma ainsi, le 22 octobre 1962 : « Si vous vous rendez-compte des dangers dramatiques que cela représente, de l’impossibilité ensuite de défendre vos droits, vos revendications, vos libertés autrement que par la violence, alors dites non ! ».
Paul Reynaud, Président du Conseil en juin 1940, et à ce titre acteur-clé de la faillite finale de la IIIe République, avait cependant intégré à son gouvernement le futur chef de la France libre. Vint-deux ans plus tard, il en dénonce l’ambition, le 4 octobre 1962 :
« Voilà un Président de la République, élu au suffrage universel, qui décidera de la vie ou de la mort de la France suivant qu'il fera une bonne ou une mauvaise politique militaire, une bonne ou une mauvaise politique étrangère. Cet inconnu tout-puissant ne sera responsable devant personne. L'Assemblée ? Il la congédiera à sa guise. Au-dessous de lui, les ministres. Pourront-t-ils vraiment être responsables devant le Parlement d'une politique qui n'est pas la leur, qui est celle de leur maître intouchable? Les malheureux joueront le rôle qui était, à la cour de France, celui des menins que l'on fouettait lorsque le petit dauphin faisait des sottises. »
Ce même jour, Maurice Faure, chef de file du parti radical, insiste de son côté sur le caractère hybride de la réforme :
« Votre réforme c’est trop ou c’est trop peu. C’est trop si nous devons rester comme vous le prétendez dans le cadre du système parlementaire de la constitution de 1958, c’est trop peu si nous devons adopter un régime franchement présidentiel ».
Pierre Mendès France, enfin, grande figure de la défunte IVe République, rappela alors toutes les critiques qu’il avait formulées en 1959 à l’encontre du nouveau régime :
« Sous la IVe, c’est un fait que l’Assemblée avait non seulement tout le pouvoir législatif, mais encore le moyen de s’immiscer de manière continuelle dans l’exécutif et de le paralyser ; sous la Ve, c’est la faute inverse. Tous les pouvoirs sont dans l’exécutif […]. Le président de la République est la seule volonté d’agir et de s’imposer tandis que que l’Assemblée n’a plus qu’un rôle de figuration. »
La prise de position la plus emblématique fut celle de Gaston Monnerville, car elle venait de l’intérieur du régime : Président du Sénat – et à ce titre troisième personnage de l’État – Monnerville était une grande figure politique, gardien intègre et sourcilleux du républicanisme d’alors. Dans un discours qui fit date, le 9 octobre 1962, il n’hésita pas à affirmer :
« La Constitution est violée ouvertement, le peuple est abusé. [...] L'élection du Président de la République au suffrage universel […] donnera naissance à un pouvoir personnel, omnipotent, incontrôlable. [...] Réunir en une seule main, sur une seule tête, tous les pouvoirs, sans nul contrepoids, c'est proprement abolir la démocratie. [...] Le 16 mai risquera de resurgir du fond de l'Histoire. »
Avec cette dernière phrase, Monnerville agitait le souvenir de Mac Mahon, premier Président de la IIIe République, aux convictions monarchistes, qui avait tenté sans succès, le 16 mai 1877, d’imposer la supériorité de l’exécutif sur la représentation nationale. Le conflit opposant de Gaulle au personnel politique mettait donc en jeu l’essentiel, et les arguments du Président du Sénat avaient de quoi susciter l’inquiétude de tous les Républicains sincères, jusque dans les rangs gaullistes.
L’ampleur de l’opposition fut si grande qu’elle permit la formation, à l’Assemblée nationale, d’une majorité de circonstance, le « cartel des non », regroupant des radicaux, des socialistes, des indépendants et des chrétiens-démocrates. Ce cartel vota une motion de censure contre le gouvernement, obligeant en retour de Gaulle à dissoudre l’Assemblée (9 octobre 1962).
Tous les opposants à la réformes défendirent donc avec conviction et avec flamme leur attachement à la culture républicaine traditionnelle. Aucun ne pouvait admettre que la République pût se confondre avec autre chose que la version contingente à laquelle ils adhéraient. Ils pensaient que la culture républicaine française, orientée dans un sens particulier au cours des années 1870, avait vocation à traverser les époques tel un bloc monolithique et intangible
Or, Vichy était passé par là, et avait démontré que les parlementaires – qui avaient voté, dans leur immense majorité, les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940 – n’étaient pas les gardiens infaillibles de la démocratie dans notre pays. La guerre d’Algérie, terminée quelques mois avant le référendum, avait de son côté apporté la preuve que le régime d’assemblée pouvait, par sa faiblesse et son instabilité, mettre en péril les institutions républicaines elles-mêmes.
C’est par le peuple que le conflit fut tranché de manière claire et éclatante : le 28 octobre 1962, le « oui » recueillit 62 % des suffrages exprimés, dans un scrutin marqué par une forte participation (78 %). Quatre ans après sa fondation par voie référendaire, c’est donc par cette même voie que la Ve République opérait une mue politique décisive.
Disparition du référendum, effacement du peuple
Avec ce succès, de Gaulle parachevait l’œuvre fondatrice engagée en 1958. Contre la volonté unanime des Républicains traditionnels, il faisait accepter au peuple un renouvellement profond de la culture républicaine française qui, depuis, n’a jamais été remis en cause. Il faut y voir la preuve que, par cette réforme, quelque chose d’essentiel a été atteint, qui met en adéquation les institutions politiques avec ce que les Français en attendent aux plans symbolique et pratique.
De Gaulle opère en fait une synthèse entre des éléments difficiles à concilier, une synthèse que la France a recherchée de manière tâtonnante et violente au XIXe siècle et au-delà, celle qui permettrait de concilier la liberté et l’égalité révolutionnaires avec la force de la puissance publique. Cette dernière, indispensable à l’expression effective de la souveraineté populaire, était en France difficile à réaliser dans un cadre démocratique, car elle était plombée par le spectre mémoriel de l’Ancien Régime, de la Restauration et de l’Empire. De Gaulle, par sa légitimité et par la hauteur de ses vues historiques, parvient donc à faire installer au cœur de nos institutions la formule stable que le pays attendait depuis longtemps, en ancrant la primauté d’un exécutif fort dans la légitimité du suffrage universel direct.
Soixante ans plus tard, cette organisation particulière des pouvoirs publics est régulièrement critiquée. L’expression « monarchie présidentielle » est souvent reprise par ceux qui dénoncent la concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul - concentration sans équivalent chez les autres nations démocratiques. André Chandernagor, ancien membre du cabinet de Guy Mollet en 1956, avait participé à l'élaboration de la Constitution. Il raconte pour Élucid :
« La Constitution sur laquelle nous nous étions alors accordés n’a rien à voir avec celle en vigueur aujourd’hui. Rien ! La Constitution de 1958 était une Constitution parlementaire. L’élection du président au suffrage universel, de Gaulle en avait déjà envie, mais les autres non.
Nous avions accepté que le Président de la République veille au bon fonctionnement des pouvoirs publics — ce que garantissait le droit de dissolution — ou qu’il s’occupe de la politique étrangère, pour le reste, c’était le Parlement qui décidait, avec majorité. Lorsque de Gaulle a mis en place l’élection du Président au suffrage universel, il inaugurait une nouvelle Constitution.
De nombreux maires et conseillers généraux craignaient que l’élection du Président au suffrage universel ne favorise la dérive présidentialiste du système. Ce qui a motivé de Gaulle, c’est qu’il savait qu’avec l’ancien scrutin, il aurait été battu à sa réélection par Antoine Pinay. Je savais qu’inévitablement cela mènerait à un culte du chef. La France est ainsi fabriquée : si vous lui donnez l’alternative du bonapartisme, elle y va ; c’est on ne peut plus simple. »
Dans un autre entretien pour Élucid, Alain Lambert, ancien ministre du Budget (2002-2004), affirme de son côté que la constitution de la Ve République « a été dévoyée » par la réforme de 1962, qu’il décrit comme une « tragédie », car « elle donne au Président une légitimité bien supérieure à celle du Parlement ». La « monarchie présidentielle » qui en résulte « est bien pire qu’une monarchie constitutionnelle, puisqu’on lui donne une sorte de majesté, une prééminence, sur le gouvernement ».

Ces critiques très répandues incitent certains responsables politiques à proposer une VIe République (Mélenchon, Montebourg). Mais leur projet se heurte pour le moment à l’indifférence de la masse de citoyens, pour qui ces questions institutionnelles restent secondaires. Quiconque voudrait surmonter leur défiance à l’égard de la politique en procédant à une refonte de nos institutions raterait sa cible, car cette défiance n’a pas pour origine le déséquilibre des pouvoirs, mais une idéologie dominante, le néolibéralisme, dont ils contestent l’hégémonie.
Depuis quarante ans, ce libéralisme d’un genre inédit a exercé en France un puissant effet dissolvant aux plans économique - en détruisant par exemple une large part de notre base productive - et politique – selon un processus inexorable de désacralisation de la chose publique. Tout ce qui conférait auparavant dignité et grandeur et, partant, efficacité au politique s’est trouvé abaissé et dégradé, à commencer par l’État – financièrement aliéné au Marché par la dette -, et par le peuple, dont la puissance politique est désormais strictement limitée dans le cadre de ce qu’il faut bien appeler une dérive oligarchique.
Conséquence logique de cette entreprise de délitement imposée, beaucoup d’électeurs refusent désormais de participer à des scrutins de plus en plus formels, comme en témoigne l’abstention record au premier tour des législatives le 12 juin dernier (52 %, et même 70 % chez les moins de 35 ans). Cette désertion civique consacre en fait le triomphe du néolibéralisme, en passe d’atteindre le stade de la démocratie sans demos.
Au cœur de cette dépossession démocratique figure la disparition du référendum. Dans l’esprit de Charles de Gaulle, l’organisation régulière de référendums était indispensable : ils représentaient des moments essentiels de la vie politique, moment de respiration démocratique où le peuple pouvait exprimer clairement sa volonté et l’imposer à ses dirigeants. Ces référendums étaient aussi l’occasion, pour le chef de l’État, de retremper sa légitimité, de s’assurer qu’il disposait toujours de la confiance d’une majorité de citoyens ; ils constituaient, enfin, l’assise démocratique du pouvoir exécutif dont la force, peu compatible a priori avec les canons du libéralisme politique, supposait le rappel fréquent de sa source populaire.
Or, les dernières décennies ont été marquées par une dénaturation complète de ce dispositif originel : avec le temps, en effet, les référendums se sont raréfiés jusqu’à disparaître ; dix-sept années se sont ainsi écoulées depuis l’organisation du dernier. Il faut dire qu’en 2005, les Français ont commis le crime impardonnable de rejeter la prétendue « constitution », d’essence néolibérale, que les élites avaient concoctée pour leur Europe. Depuis cette époque, l’affaire est entendue au sein des milieux dirigeants : la haute politique est une affaire bien trop sérieuse pour être tranchée par les citoyens ordinaires. Ceux-ci devront se contenter de référendums locaux portant sur des sujets secondaires, comme il est possible d’en organiser depuis la réforme constitutionnelle de 2003, avec laquelle la République n’est plus tout à fait une et indivisible.
L’actuel chef de l’État, garant des intérêts des couches dominantes, n’a que mépris de son côté pour cette pratique : il se contente d’en évoquer la perspective lointaine pour des raisons tactiques en période préélectorale, d’en proposer un - avant de l’abandonner - sur une question environnementale purement formelle, tout en rejetant avec véhémence l’idée de référendums réguliers avec des arguments qui laisse pantois : « Nous sommes un peuple violent, depuis des siècles et des siècles. La France n'est pas la Suisse », a-t-il ainsi déclaré pour justifier son rejet, exprimant implicitement l’idée que le peuple devait être cadenassé compte tenu de son irrationalité, sans songer un instant que la violence de certaines manifestations pouvait trouver sa cause dans la politique mise en œuvre au sommet de l’État.
La seule riposte populaire d’ampleur à cette entreprise de dépossession réside dans le Référendum d’Initiative Citoyenne. Porté par de nombreux candidats à la dernière élection présidentielle, le RIC, s’il était mis en place, serait l’occasion d’une renaissance de la démocratie en France, bien davantage qu’une réforme du mode de scrutin aux législatives ou que la suppression du poste de Premier ministre. Il permettrait de recréer un lien de confiance et d’estime entre les citoyens et un chef de l’État directement mandaté par le peuple pour agir décisivement dans un domaine particulier.
Une actualisation de l’inspiration gaullienne, en somme, qui en conforterait l’essentiel, à savoir la capacité d’action du chef de l’État au profit de l’intérêt général ; un président dont la légitimité fonderait une verticalité synonyme non pas de domination hautaine, mais d’efficacité de la puissance publique par la concentration de la force de tous en un seul. Très loin, donc, du triste spectacle offert par les trois derniers présidents : Sarkozy (à qui échappait le concept même de verticalité), Hollande (qui l’a rejeté pour sombrer dans l’insignifiance), et Macron (qui l’instrumentalise au profit des dominants, lui conférant ainsi une détestable dimension monarchique).
Photo d'ouverture : Manifestation des Gilets Jaunes devant l'Opéra à Paris, 15 décembre 2018 - Geoffroy van der Hasselt - @AFP
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

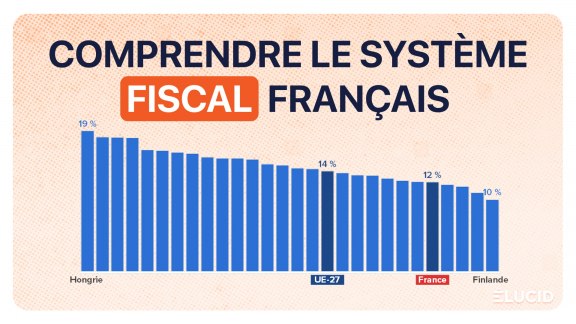






0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner