Le pouvoir des savants ou « épistocratie » est une idée ancienne qui prend corps dans la réalité contemporaine. Professeur de droit public à l’université de Montpellier, Alexandre Viala avait organisé un colloque sur le sujet avant que ne survienne la pandémie de Covid-19. Les actes sont publiés cette année sous le titre « Demain, l’épistocratie ? » aux éditions Mare & Martin. Alexandre Viala explique ici les origines de ce mode de gouvernement, ses liens avec le néolibéralisme et comment s’y opposer.

Laurent Ottavi (Élucid) : Pouvez-vous définir ce qu’est l’épistocratie ?
Alexandre Viala : L’épistocratie est un mot dont l’étymologie est la suivante : « épistémè », qui veut dire « science », et « kratos », qui signifie « pouvoir ». Elle signifie donc le « pouvoir de la science » et désigne un mode de gouvernement dans lequel les savants dirigent. C’est une idée contraire à notre idéal démocratique issu des révolutions libérales du XVIIIe siècle, qui exige que le pouvoir soit confié à des représentants élus par le peuple et censés produire des énoncés normatifs ni vrais ni faux et étrangers, par voie de conséquence, à la rationalité scientifique. Comme le disait lui-même Emmanuel Kant, il n’est pas nécessaire d’être un expert pour énoncer ce qui doit être.
De toute façon, l’épistocratie n’est pas envisageable dans sa pureté conceptuelle, car aucune constitution, dans le monde, n’a formellement confié le pouvoir aux savants. Ce mode de gouvernement ne rentre donc pas dans la typologie classique des régimes politiques (démocratie, aristocratie, monarchie) établie par Montesquieu. Il existe, en revanche, un tropisme épistocratique qui émerge progressivement dans la gouvernance contemporaine, en raison du haut degré de technicité des enjeux et des défis auxquels nous faisons face aujourd’hui.
Élucid : Quel est le penseur ou philosophe qui a promu de façon pionnière l'épistrocratie ?
Alexandre Viala : Platon, incontestablement. Dans La République, le fondateur de l’Académie caresse l’espoir de confier le pouvoir aux philosophes. Lui qui avait conseillé des tyrans, tenait en suspicion la démocratie. Voilà un régime où les hommes appelés à prendre des décisions se basent, selon lui, sur des préjugés. En confiant au contraire le pouvoir aux savants, la société se prémunit contre toute dérive démagogique à laquelle nous expose la démocratie et ne fonde la décision que sur la connaissance rationnelle et objective. L’idéal épistocratique se présente, dans ces conditions, comme un idéal aristocratique dans lequel le monopole du pouvoir revient à une petite élite constituée de gens « éclairés » et éduqués.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

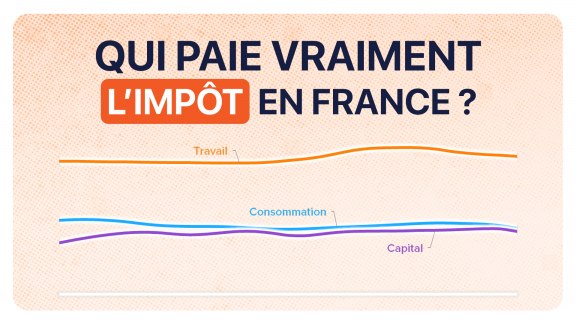
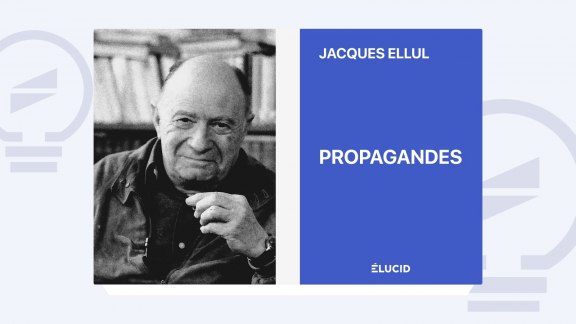





0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner