La paix n’est pas le négatif de la guerre. Après L’art de la guerre de Sun Tzu, Bertrand Badie, professeur émérite de relations internationales à Science Po Paris, fait paraître un Art de la paix chez Flammarion (2024), qui requiert neuf vertus à honorer et autant de conditions à établir. Il décrit la saturation d’un modèle caractérisé par la recherche de l’équilibre entre les puissances et souligne la nécessité de fonder un nouvel ordre international davantage appuyé sur les forces sociales que sur la souveraineté. Entretien.

Laurent Ottavi (Élucid) : Quand et pourquoi la guerre est-elle devenue un principe naturel et fonctionnel des relations internationales ?
Bertrand Badie : Lorsque se sont construits les États-nations, à l’époque de la Renaissance et dans les deux siècles qui l’ont suivie, le principe fondamental qui a été posé était celui de la souveraineté des États ainsi constitués. Parce qu’ils étaient souverains, ils étaient en compétition perpétuelle. Cette compétition, précisément, impliquait une exacerbation de trois sentiments, ceux de puissance, de défiance et de fierté, qui ont amené logiquement à des affrontements périodiques entre les nouveaux États ainsi constitués.
Pire que cela ! Comme ces États étaient souverains, ils n’étaient sujets à aucune loi commune en cas de contentieux. Ils n’avaient donc pas d’autres moyens de les régler que faire usage de la force. Non seulement la guerre devenait fonctionnelle, ce qu’elle pouvait être auparavant et ailleurs, mais elle s’imposait comme le pivot irremplaçable des nouvelles relations internationales : la paix passait après dans le statut dérisoire de non-guerre qui ne l’a plus quittée !
Élucid : Quels avantages en ont tiré les États ?
Bertrand Badie : La guerre permettait en même temps de réguler les rapports entre États et de renforcer et d’institutionnaliser ceux-ci. Dès le XVIe siècle, ils en ont tiré énormément d’avantages. Elle leur a permis de lever l’impôt et de se doter d’une bureaucratie importante. Elle leur a aussi permis d’avoir une armée devenue comme le socle, plus ou moins discipliné, du pouvoir politique et, ensuite, de contrôler et mobiliser la population. De plus, le vainqueur de la guerre pouvait augmenter son territoire et conquérir encore de nouveaux avantages et de nouvelles ressources ! La guerre s’est donc véritablement mariée avec le pouvoir politique.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
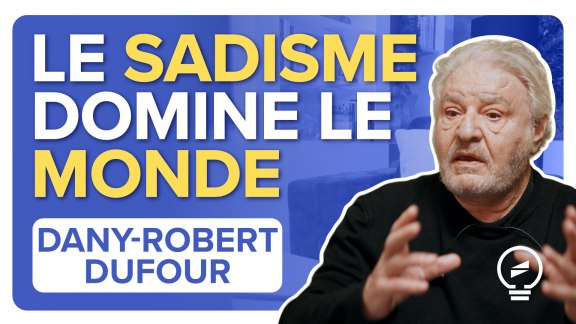

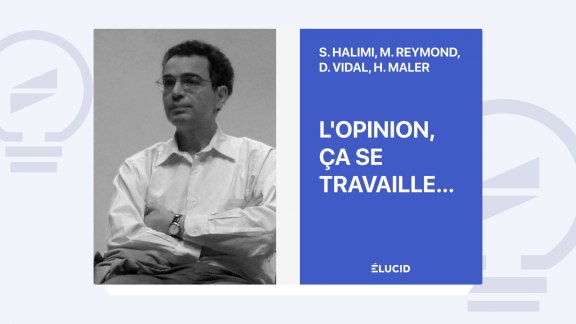
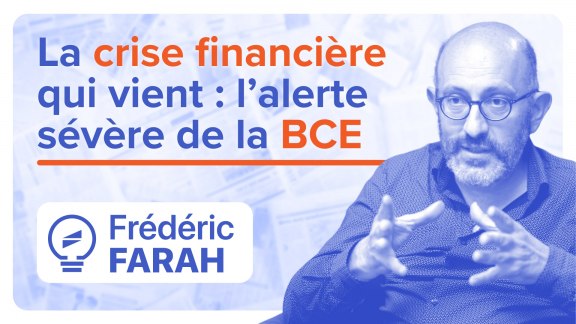


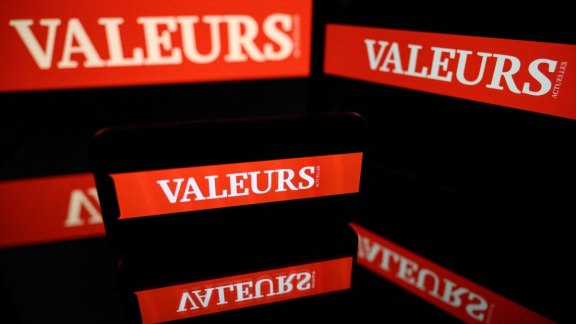

5 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner