Dans Extension du domaine du capital (Albin Michel), Jean-Claude Michéa poursuit son exploration critique d’un capitalisme toujours plus proche de sa forme chimiquement pure, au moment où sa « fuite en avant suicidaire » s’intensifie et où le libéralisme se fait de plus en plus autoritariste et post-démocratique. Le philosophe trouve malgré tout des raisons d’espérer dans les modes de vie de la France périphérique, où il vit depuis sept ans, encore empreints d’un socialisme que Marx présentait au soir de sa vie comme une renaissance, sous une forme supérieure, d’un type social archaïque.

Dans le sillage de Socrate – ou plus exactement de l’image donnée de lui par certains auteurs, dont Platon – la philosophie de l’Antiquité avait pris le sens, pour beaucoup de ses adeptes, d‘une manière de vivre. Une conception similaire, malheureusement si rare aujourd’hui, a présidé au choix de Jean-Claude Michéa de s’installer en 2016 dans un petit village des Landes, situé à 10 km du premier commerce et à 20 km du premier feu rouge comme il aime à le dire, après 43 ans, achevés dans un état de saturation physique et intellectuelle, passés dans la grande ville de Montpellier.
Le philosophe de la décence ordinaire, de la décroissance et de l’autonomie locale, vit désormais plus en phase avec sa pensée aux côtés des invisibles et des dépossédés de la France périphérique – en l’occurrence des héritiers de métayers, dont il salue le sens spontané de l’entraide et les aptitudes manuelles si étrangères aux urbains des grandes métropoles, sur une terre de chasse à la palombe et de corrida. Jean-Claude Michéa puise à la source de son nouvel environnement certains des exemples de son nouveau livre, les plus probants très souvent, harmonieusement mêlés aux références théoriques habituelles de l’auteur (Marx, Engels, Orwell, etc.).
Un « fait social total » progressiste
Extension du domaine du capital a pour point de départ un entretien accordé à une revue radicale gasconne. L’ouvrage développe ensuite, de note en note – et même, à la façon des poupées russes, de « notes de notes » en « notes de notes » – tel ou tel passage du texte initial et s’achève sur un autre entretien. L’aspect extrêmement décousu en apparence du livre, qui ne surprendra pas les lecteurs de Jean-Claude Michéa, est paradoxalement au service d’un fil directeur bien tenu et tissé depuis longtemps par l’auteur. Le philosophe poursuit en effet son analyse et sa critique du capitalisme actuel, toujours plus proche de sa forme chimiquement pure, un « fait social total » selon l’expression reprise de l’anthropologue Marcel Mauss, c’est-à-dire indissolublement économique, politique et culturel, et dont la source idéologique première remonte à la philosophie des Lumières érigée contre les traditions et les « préjugés » issus du passé, notamment au libéralisme d’Adam Smith, de Turgot et de Voltaire.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous




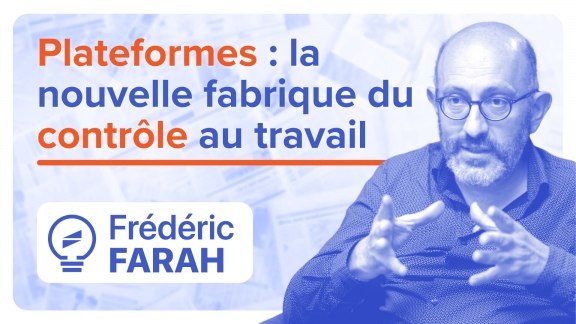

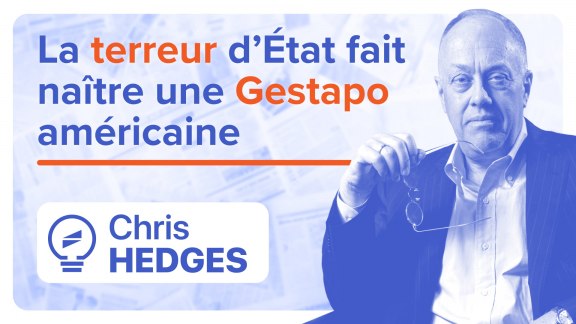
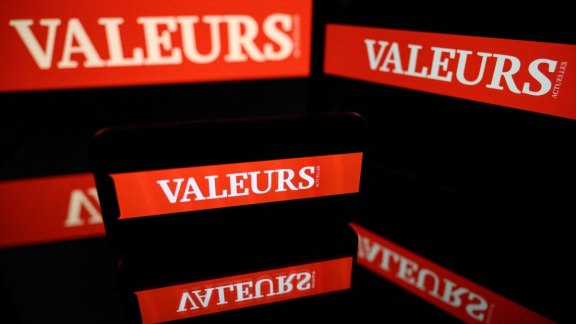
2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner