La cordillère des Andes au Pérou est malheureusement un exemple clair de l’accélération du changement climatique ces dernières années. Alors qu’elle possède la plus grande part des glaciers tropicaux au monde, elle a perdu 56 % de sa superficie glaciaire entre 1962 et 2023. La fonte des glaciers impacte directement la ressource en eau de la région, mais aussi l’agriculture, l’élevage, la biodiversité et la population locale.

Le changement climatique dans la cordillère des Andes a trois grands effets importants : l’augmentation des températures, la variation des précipitations et la fonte des glaciers. « La température augmente et diminue graduellement. Les conditions météorologiques ne se produisent plus comme avant », explique Walter López, Responsable régional des ressources naturelles et de la gestion environnementale du gouvernement régional de Junín.
D’après un rapport publié par l’ONG Care Pérou, intitulé « Projet Polyvalent en Eau et Gestion Intégrée des Ressources en Eau », la température a augmenté de +0,78 °C en 60 ans dans la cordillère des Andes. Selon le niveau d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la température pourrait s’élever entre +1,4 °C et +5,8 °C dans les prochaines années.
Quant aux précipitations, il y a des changements notables d’intensité, la saison des pluies est complètement déréglée et les périodes de sécheresse sont de plus en plus importantes. « Avant, la saison commençait à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de mars, mais aujourd’hui c’est plutôt à partir des mois de décembre et janvier jusqu’aux mois de février ou mars », ajoute Walter López.
Les précipitations liquides surpassent les précipitations solides, ce qui représente un vrai danger pour le futur des glaciers tropicaux au Pérou. « Lorsque la pluie liquide tombe, elle sert de drainage et emporte les parties les plus faibles du glacier, accélérant son recul », assure Roque Vargas, spécialiste en Gestion des Risques de Catastrophes à l’INAIGEM.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


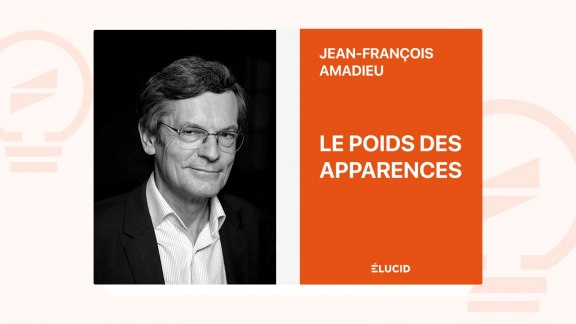





3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner