Dans L’Archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée (2019), Jérôme Fourquet s’efforce de démontrer comment la société française s’est disloquée après l’effondrement de la matrice catho-républicaine.

Podcast La synthèse audio
Profondément divisée, la société ne se retrouve plus dans le clivage politique traditionnel droite/gauche qui prédominait depuis des décennies. Cependant, on assiste aujourd’hui à une reconfiguration du paysage politique autour de nouvelles lignes de faille, certaines ayant l’apparence d’une « Renaissance » d’un ancien clivage de classes, d'autres s'apparentant à des fractures au sein d'une même classe.
Ce qu’il faut retenir :
La déchristianisation, l'effondrement du Parti communiste, la perte d'audience des médias de masse, le processus d'individualisation sur fond d'effritement des structures sociales et d'émergence de la société de consommation, l’immigration, les problématiques liées à la globalisation et à l’intégration européenne : voilà autant de sources de fragmentation pour la société française, suivant de multiples lignes de faille : ethniques, politiques, géographiques, religieuses, sociologiques, professionnelles…
Si l’instabilité concomitante qui nait de ces clivages rend pour le moment impossible toute résurgence d’un sentiment d’unité nationale, quel que soit l’événement utilisé (attentat, victoire sportive, drame national…), la dynamique actuelle consiste en une réagrégation des intérêts autour de deux tendances opposées : l’une souverainiste (nationaliste ou protectionniste), l’autre dite "progressiste" et pro-européenne ; un clivage qui ne parvient cependant pas à effacer totalement le clivage gauche-droite qui demeure.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous





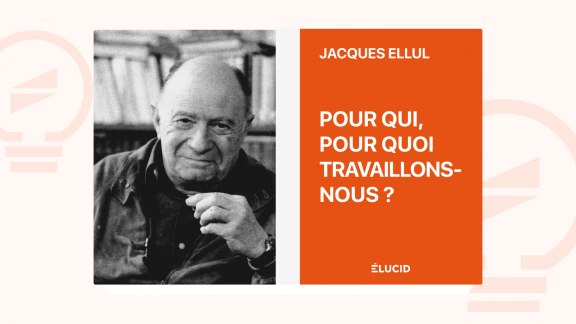


1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner