La France accueillera vendredi 12 novembre une conférence internationale dans l’optique des élections libyennes programmées pour le 24 décembre prochain. Les dirigeants qui y assisteront seraient bien inspirés de (re)lire au préalable un rapport parlementaire britannique paru en 2016, qui jette une lumière crue sur les conditions et les conséquences de l’« intervention » militaire de 2011.



Abonnement Élucid
À un peu plus d’un mois de l’échéance des élections libyennes, les espoirs qu’elles s’effectuent dans de bonnes conditions, ou qu’elles aient tout simplement lieu, sont bien minces. Une loi récemment ratifiée est encore venue ajouter de nouvelles inquiétudes à ce sujet. Elle confère en effet un avantage à l’un des candidats, le maréchal Haftar, commandant de l’Armée nationale libyenne soutenu par l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite et la Russie. L'article qui concentre les critiques prévoit qu'un militaire peut se présenter à la présidentielle, à condition "de se suspendre de ses fonctions trois mois avant le scrutin", et que, "s'il n'est pas élu, il puisse retrouver son poste et recevoir ses arriérés de salaire".
Autorités fantoches
Ces dernières années, le Maréchal Haftar a refusé de reconnaître les deux gouvernements dits « d’union nationale ».
Le premier, le GNA, avait été négocié par les Nations unies en 2016. Sa solidité était tellement relative que ses premières réunions se déroulèrent en Tunisie faute de pouvoir se faire en Libye. Les choses ne s’arrangèrent pas vraiment par la suite, comme le montrèrent les décisions des forces spéciales : les Britanniques prirent appui sur les milices qui soutenaient le GNA au détriment du GNA lui-même, jugé trop faible. Un détachement des forces spéciales de la France aurait lui soutenu l’armée nationale libyenne, pourtant opposée au GNA, pour lutter contre les islamistes à Benghazi.
Le second gouvernement d’union nationale, le GUN, n'est en place que depuis le début d’année. Il bénéficie de davantage de reconnaissance diplomatique et il contrôle plus de territoires que le précédent gouvernement, comme le manifeste sa composition. Son autorité demeure cependant très limitée. La chambre des représentants a déjà voté une motion de censure contre lui. Le GUN ne parvient ainsi pas plus que le GNA à ramener la sécurité dans un pays rongé par une guerre civile entretenue par des puissances extérieures en quête de territoires stratégiques, de pétrole et de gaz.
Cette vacance d’autorité laisse un pays fracturé selon des critères politiques, religieux et tribaux. Elle l’a également fait sombrer économiquement. L’effondrement national a fait le jeu des milices – d’anciennes forces militaires, des tribus et autres islamistes - d’autant plus puissantes, pour certaines d’entre elles, que l’État libyen de Kadhafi y recourait par le passé pour assurer sa propre sécurité.
Des trafiquants d’êtres humains et des mercenaires venus de l’étranger, de la Russie à la Syrie en passant par la Turquie et le Tchad, tirent aussi profit de la situation actuelle. Les islamistes, enfin, ont étendu ces dernières années leur présence sur le pays et, plus largement sur l’Afrique du Nord où ils forment des combattants. L’assistance internationale est bien évidemment quasi impossible à mettre en œuvre dans un pareil contexte.
Du « printemps arabe » à la résolution de l’ONU
Un rapport vieux de cinq ans, paru exactement le 14 septembre 2016, avait déjà tout dit des malheurs libyens. Son auteur était la Commission des affaires étrangères du Royaume-Uni. Elle avait préalablement recueilli les témoignages des principaux acteurs britanniques impliqués dans la décision « d’intervenir » en Libye en 2011. Un seul avait décliné la proposition : le Premier ministre de l’époque, David Cameron. Parmi les autres informateurs entendus par la Commission figuraient des politiciens et des technocrates libyens. L’insécurité dans le pays empêcha, en revanche, les auteurs du rapport de se rendre directement sur le terrain.
La Commission remonte aux origines du chaos actuel. Il est le fruit pourri de ce qui fut appelé trop rapidement le « Printemps arabe ». Celui-ci s’était déclenché en Tunisie en 2010. Dans la foulée, des manifestations contre les régimes oppresseurs d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient se multiplièrent. La dynamique gagna la Libye en février 2011 sous la forme de manifestations dans la ville de Benghazi contre le dirigeant Mouammar Kadhafi. La situation s’embrasa rapidement. En quelques semaines à peine, le régime perdit le contrôle d’une partie de la Libye et décida d’une contre-offensive. La Ligue arabe appela alors, le 12 mars 2011, le conseil de sécurité des Nations unies à prendre les mesures nécessaires « pour imposer immédiatement une zone d’interdiction de vol » au-dessus de la Libye.

De cet enchaînement de circonstances sortit, cinq jours plus tard, la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle fut proposée par la France, le Liban et le Royaume-Uni, avec le soutien des Américains. Les États membres étaient autorisés par elle à établir et à faire respecter une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye.
La résolution ne s’en tenait pas seulement là. Comme la méthode d’une zone d’exclusion aérienne avait fait la preuve de son inefficacité par le passé (en Bosnie et en Irak notamment), les États-Unis, selon les conclusions des rapporteurs britanniques, contribuèrent de façon déterminante à étendre les habilitations des États. Ils étaient ainsi autorisés à prendre « toutes les mesures nécessaires » afin d’empêcher les attaques contre les civils.
L’option militaire privilégiée
Rien ne justifiait explicitement dans cette résolution le déploiement de forces terrestres ou la destruction de l’armée de Kadhafi, encore moins un changement de régime en Libye ou l’assassinat de son dirigeant. Le flou qui entourait l’expression de « mesures nécessaires » rendit pourtant possible, en pratique, des attaques plus larges qu’une simple protection des civils, comme celles dirigées contre les défenses et le réseau de communication libyens. Par ailleurs, même après avoir assuré la protection des civils de Benghazi, l’OTAN poursuivit ses opérations aériennes.
D’après les témoignages obtenus par les rapporteurs, le plan de campagne britannique aurait prévu une pause une fois la protection des civils à Benghazi assurée. Elle aurait eu pour but d’explorer des options politiques. L’armée française avait fait un choix différent. Les options pacifiques telles que les sanctions, les négociations et les pressions diplomatiques ne furent par conséquent pas explorées par les alliés occidentaux.
Elles avaient pourtant contribué à des résultats positifs par le passé en Libye pour ce qui concerne notamment la lutte contre l’islamisme, l’abandon de la recherche d’armes de destruction massive et de missiles balistiques ou le contrôle des migrations. D’autres atouts, comme l’utilisation du réseau libyen de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair ou le recours à l’un des fils de Kadhafi pour négocier un cessez-le-feu, auraient aussi été écartés.
Le changement de régime
De nombreux pays, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni la Turquie ou encore les Émirats arabes unis, outrepassèrent encore la résolution de l’ONU en fournissant des aides aux troupes terrestres sous la forme d’effectifs ou de renseignements. Certains d’entre eux, les Qataris au premier chef, livrèrent même une grande quantité d’armes, en contradiction avec l’embargo décidé par l’ONU. Avec celles du régime de Kadhafi éparpillées à cause de l’effondrement du régime, elles ont nourri l’instabilité et le terrorisme en Afrique du Nord et de l’Ouest ainsi qu’au Moyen-Orient.
Les puissances à l’origine de la résolution 1973 préférèrent fermer les yeux sur ce sujet. Plusieurs problèmes se présentaient à elles : la neutralisation des convois remplis d’armes au départ de la Libye risquait de frapper les civils ; l’objectif de limiter la propagation des armes était aussi, de façon générale, très difficile à atteindre étant donné le nombre d’acteurs étatiques impliqués dans le conflit libyen. Les auteurs du rapport laissent entendre qu’une aussi redoutable et inévitable difficulté aurait dû, dès le départ, remettre en cause toute « intervention » en Libye.
S’il n’était pas question, initialement et officiellement, de changer de régime, toutes ces évolutions préparaient cette issue sans le dire. La France l’assuma assez rapidement : elle reconnut le Conseil national de transition comme gouvernement légitime de la Libye dès mars 2011. David Cameron et le président Obama emboîtèrent le pas à Nicolas Sarkozy le mois suivant en signant avec lui une lettre commune pour « un futur sans Kadhafi ».

Sur les fondements d’une conversation avec un membre des services secrets américains, les auteurs du rapport expliquent l’empressement français par plusieurs raisons excédant de loin le motif de protection des civils : conquérir une grande part de la production pétrolière libyenne ; réaffirmer la position de l’armée et de l’influence françaises en Afrique du Nord et en Afrique francophone ; se montrer proactif en Méditerranée, notamment en ce qui concerne les enjeux d’immigration clandestine au départ de l’Afrique du Nord, pour gagner en popularité en France.
Amateurisme
La Commission des affaires étrangères britannique ne constate pas seulement des motivations dissimulées et contestables, ou un engrenage militaire en contradiction avec les termes de la résolution de l’ONU. Elle souligne aussi l’impréparation criante des puissances occidentales. Sans objectif stratégique clairement défini, elles manquaient, d’autre part, de connaissance du terrain faute de ressources et de réseaux.
La menace immédiate qui pesait sur les civils à Benghazi ne fut par exemple jamais jaugée. Si Kadhafi appelait à répéter les pires crimes de l’Histoire contre son propre peuple, les preuves qu’il allait passer à l’acte étaient inexistantes. Le dirigeant libyen ne commit d’ailleurs pas de massacre de masse contre les civils lors de la reconquête des villes détenues par ses opposants ; il fit aussi des propositions d’aide au développement à ses adversaires avant d’envoyer finalement ses troupes.
Outre les discours de Kadhafi, les auteurs du rapport estiment que deux facteurs déterminèrent la représentation du conflit libyen dans la tête des dirigeants occidentaux : les propos alarmistes des exilés, ennemis de Kadhafi, et la couverture médiatique des événements. Sur ce dernier point, le rapport vise les médias arabes comme Al-Jazeera, mais aussi ceux des pays occidentaux, trop enclins à voir uniquement des gentils parmi les « rebelles » libyens ou des monstres assoiffés de sang dans le camp de Kadhafi.
Les dirigeants occidentaux n’ayant pas évalué par ailleurs la nature de l’opposition en Libye, ils ignoraient donc l’implication des islamistes parmi les insurgés, laquelle conduisit par exemple à l’attaque du Consulat américain le 11 septembre 2012. Le simple souvenir des dernières années aurait pu, au moins, les alerter : de nombreux Libyens s’étaient en effet engagés dans les guerres d’Irak et d’Afghanistan.
L’impréparation établie par le rapport de la Commission vaut aussi au sujet de la reconstruction économique et politique de la Libye. Énormément de plans furent élaborés, mais, outre qu’ils étaient fondés sur des renseignements inexacts ou incomplets, aucun ne prenait en compte le caractère tribal du pays. Ils oubliaient dans le même temps une autre évidence.
La reconstruction dépendait avant tout de la sécurité du pays, elle-même liée à un besoin impérieux d’autorité pour éteindre les feux de l’anarchie. Au lieu de cela, des élections furent décidées précipitamment, laissant à peine le temps aux candidats de faire campagne et excluant, de fait, les personnalités expérimentées. Les aides étrangères ne pouvaient, pas plus, être absorbées efficacement par manque d’institutions à la fois solides et légitimes.
À tous points de vue, donc, la guerre de Libye, pudiquement appelée « intervention », fut un désastre. Pour ce pays, bien sûr, mais aussi pour toute la géopolitique méditerranéenne, africaine et moyen-orientale, que ce soient en termes d’immigration, d’image des puissances occidentales à l’étranger ou de propagation de l’islamisme. Les répliques de cette guerre se feront, à coup sûr, encore sentir pendant longtemps.
Photo d'ouverture - Mouammar Kadhafi, Kiev (Ukraine), 4 novembre 2008 - Sodel Vladyslav - @Shutterstock
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

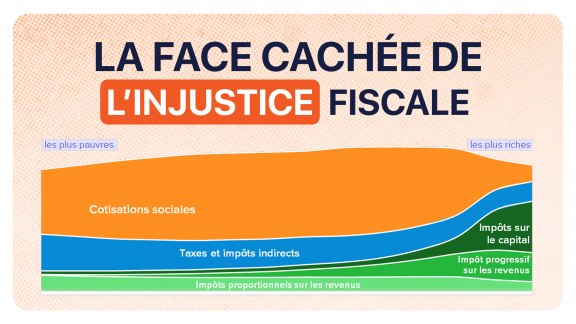






1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner