Article élu d'intérêt général
Les lecteurs d’Élucid ont voté pour rendre cet article gratuit.
Il y a dix ans, le 5 juillet 2015, avec une clarté à toute épreuve, le peuple grec disait « non » aux mesures d’austérité du plan européen que le Premier ministre d’alors, Alexis Tsipras, lui proposait d’avaliser. Ce « non » populaire a été foulé aux pieds et la Grèce a ensuite subi un nouveau train de mesures austéritaires imposé par la Troïka. La coalition de gauche a ensuite été emportée dans les défaites électorales, et Tsipras est allé rejoindre, à raison, les oubliés de l'Histoire. Comme souvent, la politique est une affaire de récits. Les instances européennes et leurs affidés se sont pressés de nous offrir un storytelling à leur avantage : après une période de nécessaire austérité, la Grèce aurait renoué avec la prospérité ; la porte des marchés financiers lui serait à nouveau ouverte, et elle emprunterait même pour moins cher que d'autres pays européens comme la France. Mais qu’en est-il réellement dix ans après, alors que la Grèce ne voit plus les regards se porter sur elle ? Doit-on accorder du crédit à ce récit lénifiant censé justifier l’austérité ? La crise grecque et ses lendemains en disent long sur l’état de déliquescence de la démocratie dans l’Union européenne et sur les impasses de l’austérité. Dix ans à reparcourir pour comprendre la fragilité dans laquelle l’Union européenne se trouve désormais.



Abonnement Élucid
Depuis 2008, l’Union européenne va de crise en crise. La liste mérite d’être rappelée : crise des subprimes, crise des dettes souveraines, Brexit, crise Covid, crise énergétique, et maintenant crise géopolitique. Il ne faudrait pas non plus oublier la nouvelle crise industrielle, qui emporte dans la tourmente l'acier et l'automobile, doublée de tensions commerciales avec les États-Unis, surtout depuis cette année après le retour de Donald Trump à la présidence.
Dans ce paysage plus que tourmenté, la crise grecque mérite un arrêt, car ses conséquences politiques et économiques n'engagent pas que la Grèce mais bien tout le continent.
Présent et avenir de la crise grecque
Au cours des dernières années, tout un récit s’est imposé pour raconter qu’après la purge austéritaire, l’économie grecque aurait retrouvé le chemin de la croissance. L’indicateur positif retenu par les autorités européennes, c’est le retour de la dette grecque sur le marché obligataire. Or, cette référence est trompeuse, car l’essentiel de la dette grecque se trouve hors marché. En effet, 70 % de la dette publique grecque est détenue par des acteurs publics avec des taux fixes bas et une maturité moyenne d’un peu moins de 20 ans.
Par ailleurs, la société grecque n’est pas parvenue à retrouver son niveau de vie avant crise, et son PIB demeure 20 % en-dessous de son pic de 2007. La liquidation de l’économie grecque, en obéissant aux mêmes modalités que celles qui a vu l’économie est-allemande disparaître, a rendu difficile les investissements nécessaires.
En effet, l’économie est-allemande avait été confiée à une structure de défaisance qui s’était chargée de privatiser en masse les actifs est-allemands. Et c'est bien cette voie que le président de la Commission européenne de l’époque, Jean-Claude Juncker, préconisait clairement pour la Grèce. Le port du Pirée, les aéroports civils, la compagnie d’électricité et bien des secteurs stratégiques ont fait l’objet de privatisations massives obérant de la sorte l’avenir du pays. La catastrophe ferroviaire de 2023 a révélé la vétusté du réseau ferroviaire. Et la gestion du port du Pirée par la société chinoise Cosco se fait dans des conditions sociales dégradées (non respect du droit du travail, pénibilité du travail).
L’exode de la jeunesse grecque n’a pas cessé, de même que la spéculation immobilière. Plus de 500 000 jeunes ont quitté le pays entre 2009 et 2019, et ce alors que la Grèce vit un interminable hiver démographique. La pauvreté de la population demeure inquiétante. Plus d’un tiers des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté, aux alentours de 370 euros mensuels. La récente crise inflationniste a renforcé le phénomène et a davantage creusé des inégalités. Entre 2010 et 2018, les salaires ont baissé en moyenne de 30 %. Et le pays détient le record du nombre de factures impayées dans l’Union européenne.
Avant 2009, l’économie grecque devait être une boussole pour les États balkaniques, qui étaient censés suivre sa voie de développement. Aujourd’hui, il en va bien autrement. La Grèce a vu son niveau de vie baisser et elle a rejoint les États de la périphérie en matière de difficultés économiques. Ce petit pays a connu la plus brutale baisse de revenus en temps de paix.
Le constat est clair : une observation attentive de dix ans d’ajustements structurels donne raison aux Grecs d’avoir rejeté le plan européen en 2015. L’étrange concept « d’austérité expansive » promu par la Commission européenne n’a pas trouvé de réalité, hormis dans les projections fantasques des fonctionnaires européens. Celui-ci reposait sur la théorie suivante : si les investisseurs étaient persuadés de la volonté des gouvernements de réduire la dette publique par des saignées sociales significatives, le coût de l’emprunt diminuerait et les investissements reprendraient de plus bel. De ce fait, la réduction de la dépense publique se justifierait.
Sauf qu’en réalité, rien de tout cela n’est arrivé. D’ailleurs, Yanis Varoufakis, économiste et ancien ministre de l’Économie de la coalition de gauche « Syriza », dans un entretien récent, soulignait la médiocrité de ses partenaires en matière économique et leur refus d’engager une discussion sérieuse sur les effets économiques d’une politique d’austérité : « Je dois admettre que j’ai été surpris par l’irrationalité orchestrée et les niveaux incroyables d’incompétence et de cynisme que j’ai rencontrés ».
L’appauvrissement volontaire des Grecs, avec l’appui des différents gouvernements du pays, a montré la réalité d’un mécanisme promis à un inquiétant avenir dans l’Union européenne, celui de la dévaluation interne, à savoir la compression de la demande pour rétablir non une quelconque productivité, mais un semblant de compétitivité.
En effet, dans la zone euro, à défaut de réels transferts entre pays du centre et de la périphérie, ou encore de réel budget capable de contrecarrer une crise « contracyclique », la seule marge de manœuvre restante se trouve dans la dévaluation interne. Et la gestion de la crise grecque a révélé la nature profondément déflationniste de la monnaie unique. L’ajustement ne peut se faire que sur le travail, moins mobile par nature qu’un capital capable d’imposer plus facilement ses conditions en matière de fiscalité et de protection sociale.
La crise grecque révèle l’absence d’une réelle démocratie européenne
La crise grecque a fait éclater avec encore plus de force l’organisation non démocratique du continent sous égide du marché et de ses exigences. Après le « non » français au référendum de 2005 foulé aux pieds par nos « élites » et dix ans après celui des Grecs, la démocratie européenne n’en finit pas d’entrer dans un hiver interminable.
Il faut dire que l’intérêt général ne semble pas avoir été au cœur des enjeux politiques. Là encore, Yanis Varoufakis, dans son témoignage, nous révèle la teneur de ses discussions avec les dirigeants européens de l’époque :
« Cependant, [Christine Lagarde] a ensuite ajouté immédiatement : "Mais Yanis, tu dois comprendre que nous avons mis beaucoup de capital politique dans ce programme, et que ta carrière et la mienne dépendent toutes deux de son accompagnement". Je lui ai dit : "Mais Christine, tu sais que je m’en fous de ma carrière politique. J’ai un mandat du peuple, et c’est tout ce qui m’importe. Si je cesse d’être ministre des Finances, et alors ? Ce n’est pas mon problème". »
Il faut le dire clairement : la Grèce a subi une forme moderne de coup d’État, conduit habilement par la Banque centrale européenne qui a imposé un contrôle des capitaux et qui a réduit les liquidités à disposition de l’État grec dès février 2015. Il était évident que « le printemps grec » ne devait pas aboutir. Le principe thatchérien, « Il n’y a pas d’alternative », prévalait de toute sa force. La Banque centrale européenne avait déjà montré ses capacités en la matière, puisqu’en 2011, elle avait largement contribué à la chute du gouvernement italien de Silvio Berlusconi en laissant une forte spéculation s’emparer de la dette italienne.
L’Union européenne, bafouant ses propres principes démocratiques en voulant se jouer de la décision des peuples en collusion avec des fractions des élites nationales, a ainsi amplifié la défiance à l’égard des institutions tant nationales que supranationales.
Ces dix années passées ont vu une nette affirmation du pouvoir des organes financiers (Banque centrale européenne et trésors nationaux). Ce constat se confirme avec l’importance accordée aux questions budgétaires. Aujourd’hui, la dimension éco-financière est devenue centrale dans les débats. De manière parfaitement non démocratique, la Banque centrale européenne continue de jouer un rôle clé dans la répartition de la richesse par sa politique de taux d’intérêt, ou encore par ce que l’on nomme le « quantitative tightening », à savoir le fait qu’elle réduit ses interventions sur le marché obligataires. Autrement dit, elle rachète moins de titres de dettes souveraines et ne renouvelle plus à échéance ses obligations détenues.
Le risque de cette politique est de faire repartir à la hausse les taux d’intérêt. De la sorte, la Banque centrale européenne exerce une pression sur la politique budgétaire des États. Cette intrusion dans le débat démocratique sans aucune légitimité en dit long sur l’absence de contrepoids démocratique face à cette institution technocratique.
De son côté, 10 ans après le « non » au référendum, la Grèce reste dans une situation économique préoccupante et les quelques indicateurs glanés par la Commission européenne et des commentateurs complaisants ne doivent pas cacher l’échec politique, économique et social de la plus violente cure d’austérité imposée à un État en temps de paix.
Pire encore, la crise grecque et ses préconisations économiques sont loin d’appartenir au passé ; elles nous renseignent au contraire sur l’inquiétante Union européenne qui vient.
La déflation compétitive : quel avenir ?
Ces 10 ans écoulés révèlent également le caractère profondément illusoire de la croyance selon laquelle les élites européennes avaient tiré les leçons de la crise grecque, et qu’elles avaient perçu les dangers de laisser ainsi s’approfondir le délitement démocratique et la défiance à l’égard des institutions européennes. Or, loin de dessiner un nouveau contrat social à la faveurs des crises qui secouent l’Union européenne, c’est encore et toujours la même voie dogmatique qui semble dominer.
C’est en cela que la crise grecque ne doit surtout pas être réduite à un mauvais souvenir, mais bien analysée comme un guide explicatif de l’avenir économique qui nous est promis. Certes, lors de la crises des dettes souveraines et de la Covid, la Banque centrale européenne a su s’affranchir de son mandat historique pour répondre aux besoins des Européens – c’est la période Mario Draghi, qui laissait entendre qu’avec une intervention plus précoce de l’institution, la crise n’aurait pas eu lieu. Mais la Troïka en ensuite souhaité faire un exemple pour les pays du sud de l’Europe, alors tentés par des voix dissidentes et eurocritiques, restent bien dans le rang pendant la décennie 2010.
La récente prise de parole du Premier ministre Bayrou ouvre la voie à un étrange chapitre de notre histoire économique et politique, celle de la déflation compétitive. Les années 1980 avaient promu la désinflation compétitive, c’est-à-dire la modération salariale, la progression plus limitée de la dépense publique pour restaurer la compétitivité des entreprises françaises et réduire l’inflation. Cette politique a pris sa source dans le tournant de la rigueur de mars 1983, pour se prolonger jusqu’en 1997.
Aujourd’hui, c’est une étape nouvelle ; la monnaie unique a vu le jour à la fin des années 1990, le marché unique et ses mesures de libéralisation des transports, de l’énergie et des télécommunications produisent largement leurs effets. Ce cadre a affecté profondément l’économie française ; il en a modifié le visage et en a réduit l’allant. Sans compter les règles budgétaires qui nourrissent les préoccupations, même si elles ne sont pas respectées. Dans un pareil environnement peu coopératif, peu favorable à la croissance, la tentation pour s’y maintenir est d’infliger une véritable déflation interne, à savoir la compression du revenu et de l’investissement pour maintenir un semblant de compétitivité et faire croire à un redressement des finances publiques.
Puisque le cadre ne peut être changé, la seule méthode possible, c’est la logique déflationniste sur les salaires en particulier. La Grèce est plus que jamais notre avenir, non pas parce que nos finances ne sont pas tenues et que demain le FMI sera à Paris, mais tout simplement parce qu’il ne peut y avoir qu'une logique profondément déflationniste (ou non coopérative) dans le cadre de la zone euro. On l'a bien vu lorsque l’Italie et le Portugal ont modifié leur fiscalité pour attirer les résidents étrangers et les retraités. L’Espagne quant à elle, apparaît comme la locomotive du continent en matière de croissance, mais elle revient de loin en matière de contraction du pouvoir d’achat et de remises en causes des droits sociaux. Néanmoins, le chômage des jeunes y reste élevé et la pauvreté y est importante.
Dans son malheur, la Grèce nous a en quelque sorte alerté sur le fait que la déflation compétitive ne pouvait qu’être l’avenir de l’Union européenne, puisque c'est son fondement même. La preuve en est que la zone euro et l’Union européenne n’ont jamais été les moteurs de la croissance mondiale depuis la fin des années 1990.
L’État social européen est ainsi dans la tourmente et subit les coups de boutoir de la financiarisation des économies depuis les années 1990, des effets non coopératifs du Marché Unique (dumping social et fiscal), de la monnaie unique, ou encore du réarmement européen imposé au forceps par les États-Unis. Ce sont donc les logiques antidistributives qui sont à l’œuvre. Il suffit en France de voir les levers de bouclier autour de la taxe Zucman.
Les « remèdes » de la crise grecque bientôt appliqués à la France ?
Depuis la progression des déficits incontrôlés de l’État français et d’une dette publique croissante, la référence à la crise grecque resurgit dans la bouche de nos personnalités politiques. Si certains y font référence avec beaucoup de crainte, on peut se demander si d’autres ne convoquent pas cet exemple comme un souhait pour la gestion de notre pays.
La France a déjà expérimenté, certes de manière atténuée, des méthodes politiques observées au cours de la crise grecque. Des trains entiers de réformes ont été avalisés par le Parlement grec sans aucun débat. En France, les multiples recours au 49-3 pour bon nombre de textes financiers ou afférents à la protection sociale témoignent d’une volonté d’imitation. L’ancien Premier ministre Manuel Valls ne cachait d’ailleurs pas son admiration pour le Parlement grec qui faisait passer des textes de loi à la hussarde :
« Je me faisais la remarque pour que vos auditeurs et vos téléspectateurs comprennent bien. En Grèce, le gouvernement de Tsipras, un gouvernement de gauche avec d'abord une grève générale, mène des réformes courageuses. Ces réformes ont été adoptées en quelques heures, 1 500 pages sans amendement par le Parlement. Parce que parfois, il faut aller vite dans la réforme. »
La gestion de la crise grecque nous a aussi donné des signes avant-coureurs de la brutalisation politique à l’œuvre dans les pays situés au centre de l’UE : réformes avalisées contre la majorité de la population, répression violente des mouvements sociaux, etc. Le traitement infligé à Grèce représente à la fois notre potentiel avenir en termes de brutalisation politique et sociale, mais aussi la vision fantasmatique de nos élites quant à la manière de conduire des réformes, en particulier dans le domaine des retraites ou de l’assurance chômage.
Le dernier discours de François Bayrou, un soi-disant « moment de vérité », participe de cette volonté de créer un effet de sidération au sein de la population, afin d’imposer un calendrier brutal de réformes et une véritable saignée sociale austéritaire.
Ne nous trompons pas. La crise grecque n’est pas l’histoire d’un errement politique et économique, mais bien l’avant-poste d’une tentation autoritaire au sein de la technocratie dogmatique de Bruxelles. Les crises récentes ont montré à quelle vitesse les libertés publiques pouvaient vaciller et la répression sociale resurgir. En somme, c’est un peu notre futur que la crise grecque dessinait sans le dire. En sacrifiant brutalement l’État social grec, les autorités européennes et nationales ont indiqué clairement quelle était la cible des prochains réajustements des anciens compromis sociaux. La récente pression politique américaine sur les nations européennes pour augmenter les budgets militaires et le consentement de ces dernières à le faire – au détriment de l’intérêt général – marquent à ce titre un tournant clé.
Au final, à partir du 5 juillet 2015, la Grèce a ainsi été le lieu d’une expérience politique terrible qui pourrait tout à fait se déployer ailleurs en Europe à l’avenir. Il nous incombe donc de rester vigilant et de ne pas accepter les dérives autoritaires et austéritaires que l’UE nous réserve pour combler son instabilité croissante.
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


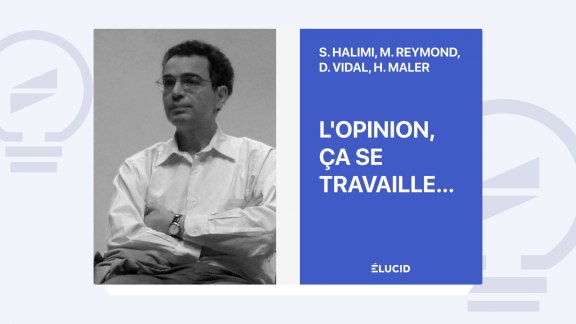
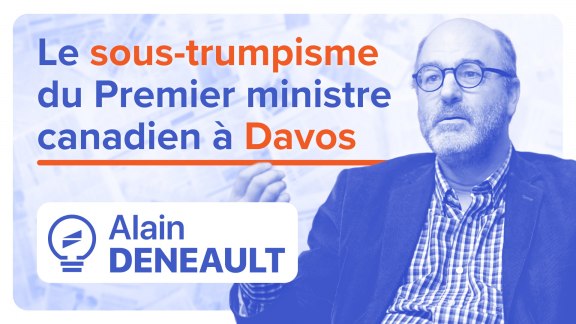


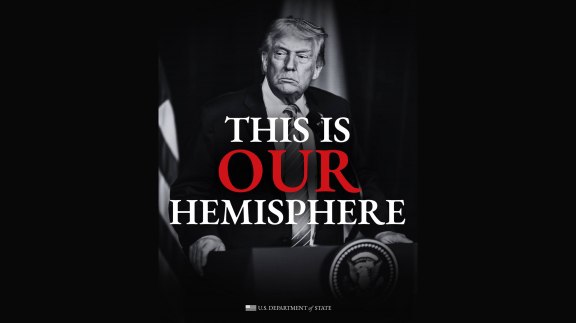

4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner