Article élu d'intérêt général
Les lecteurs d’Élucid ont voté pour rendre cet article gratuit.
Dans le flot de propagande anti-fonctionnaires auquel nous sommes continuellement soumis se trouve l’idée que la France serait remplie d’agents publics qui, de leur propre initiative et pour le plaisir, s’amuseraient à définir des normes en tout genre pour compliquer la vie de tout un chacun. Si de nombreux problèmes bureaucratiques existent bien, ils trouvent leur source chez le politique et dans l’idéologie du marché, et non chez les fonctionnaires qui les subissent bien plus qu’ils ne les décident.



Abonnement Élucid
Un refrain du discours politique consiste à déplorer un pays qui serait rempli de fonctionnaires administratifs n’ayant d’autre but dans la vie que de compliquer la vie des gens ordinaires. Si l’idée que nous sommes étouffés par les formulaires et les règles rencontre un certain nombre d’échos dans notre vécu, les causes de cet état de fait sont très rarement identifiées ou simplement judicieusement recherchées (1).
Le terme de « suradministration » laisse entendre que tout ce phénomène mal identifié est entièrement de la faute de l’administration, de fonctionnaires trop tatillons obsédés par les détails, comme la mesure au millimètre près de la taille des carottes, et exigeant trente-six formulaires à remplir pour justifier d’une carotte non conforme.
Or, ce terme est un leurre, puisque les racines de ce phénomène sont bien ailleurs. Ce n’est pas dans la psychologie des fonctionnaires qu’il faut chercher, mais dans des décisions, présentes et passées, prises au niveau politique. Il se trouve ainsi trois grands types de causes :
1) l’augmentation effrénée des missions des fonctionnaires par la loi sous l’effet d’une inflation législative ;
2) une réorganisation du secteur public en prenant pour modèle le privé ;
3) l’impuissance grandissante de l’administration organisée au nom de la mise en concurrence.
Un fonctionnaire ne fait qu’appliquer la loi
C’est un principe fondamental qui différencie le secteur privé du secteur public : tout ce qui existe dans le public, chacune des missions qui occupe les fonctionnaires, tout cela a été décidé par une loi votée dans un parlement, national ou européen. Parfois, la loi prévoit que les conditions d’application de ladite loi seront précisées par des textes subsidiaires (décrets, arrêtés, circulaires), pris par les ministres ou leurs subordonnés à qui le parlement a délégué expressément cette mission ; mais dans l’ensemble, il y a un texte législatif ou réglementaire en vigueur qui dicte l’action de chacun des agents publics. C’est en vertu de ce corpus de textes qu’un fonctionnaire est en capacité d’exiger d’un particulier ou d’une structure qu’il agisse comme il le lui ordonne.
Et, ces dernières années, la frénésie législative s’est intensifiée : le parlement a été convoqué en sessions extraordinaires tous les ans et parfois plusieurs fois par an. Ce phénomène, déjà ancien, précède largement l’élection d’Emmanuel Macron, mais il s’est aggravé depuis. Les différents gouvernements qui se sont succédé depuis son arrivée au pouvoir ont entendu légiférer sur tout un tas de domaines très variés.
Or, pour qu’une loi ne soit pas qu’un simple bout de papier, il faut qu’il y ait des gens derrière pour la faire appliquer. Si c’est une loi qui définit des normes (sur le taux de pesticides dans les champs, par exemple), il faut des gens pour contrôler ces normes. Si c’est une loi opérationnelle, organisant une refonte des enseignements dans le secondaire, ou du baccalauréat, il faut là aussi que des gens mettent en œuvre ce qui est prévu dans la loi.
Et quand les lois ne cessent d’augmenter la liste des critères pour qu’un particulier ou une structure fasse valoir ses droits, la manière la plus simple de mettre cela en œuvre est alors le formulaire, la demande de justificatifs et les contrôles – comme l’expérimentent les gens ayant à faire valoir leurs droits au chômage ou à la retraite, notamment.
Aussi, c’est parce que la société exige des contrôles (ou parce que le politique pense qu’elle en exige) que le politique fait voter des lois qui imposent à l’administration de contrôler tout un tas de choses.
Par exemple, c’est parce que le politique fait mine de croire que le public attend de lui qu’il contienne les dépenses de la Sécurité sociale, les arrêts de travail ou les prescriptions de médicaments, que les médecins libéraux deviennent malgré eux des bureaucrates et les hôpitaux des bureaucraties pour fournir à chacun des justificatifs exigés par les différentes lois votées dans cet esprit.
L’organisation du public sur le modèle du privé
Dans le dogme néolibéral, il existe une croyance selon laquelle l’organisation du privé serait bien plus efficace que celle du public, et qu’il faudrait donc appliquer au public le mode de fonctionnement du privé pour que ce dernier fonctionne mieux : c’est le new public management. Depuis son introduction dans le secteur public à la fin des années 1960, il n’a cessé de s’étendre au point de devenir un mode de fonctionnement hégémonique qu’on ne questionne même plus.
Or, le postulat de départ est erroné. Le privé est bien plus efficace que le public… selon certains critères du privé. Si l’on compare un tournevis et un smartphone, lorsqu’il s’agit de visser, le tournevis est un instrument bien plus efficace, mais il existe bien d’autres activités pour lesquelles un smartphone est d’un bien plus grand secours.
Prenons encore une fois l’exemple de la santé. Lorsque, comme aux États-Unis, la priorité du système de santé est de rapporter de l’argent aux propriétaires des cliniques et des assurances privées, le secteur privé est plus efficace que le public (qui n’a, par construction, pas d’actionnaires à enrichir). En revanche, si l’objectif est d’avoir une population en bonne santé, avec un accès aux soins généralisé, d'accroître l’espérance de vie, de diminuer la mortalité infantile, etc., c’est là que le secteur public européen surpasse en efficacité le privé nord-américain.
Ceci étant posé, il a donc été décidé arbitrairement d’importer les modes de fonctionnement du secteur privé dans le public (2). Et en particulier :
- la volonté de contrôle et de remontée d’informations vers le haut de la hiérarchie (dont le regretté David Graeber avait judicieusement dressé le portrait dans l’excellent Bullshit Jobs).
- La production de normes, dont il faut ensuite contrôler la bonne application.
- L’externalisation à outrance, pour laquelle il faut ensuite contrôler les prestataires ou sous-traitants.
Dans les trois cas, les travailleurs du secteur public sont de plus en plus astreints à des contrôles fréquents, à des collectes, productions ou inventions d’informations, d’indicateurs, etc. Ils doivent rendre des comptes à la hiérarchie et aux acteurs politiques, pour leur permettre de se rassurer en se racontant qu’ils sont totalement en contrôle de ce qui se passe, que ce soit dans l’administration ou dans le secteur qu’ils aient à gérer.
En outre, la production et le contrôle des normes étant un élément essentiel du fonctionnement du Marché selon la doctrine néolibérale, afin que la concurrence puisse se faire sur des produits respectant un certain nombre de normes (3), il faut donc un acteur neutre (l’État) pour s’assurer en dernier ressort que les normes sont bien respectées. Et nous revoilà encore avec des contrôles à faire, des formulaires à remplir et des justificatifs à produire afin de s’assurer que chaque acteur du marché respecte les conditions d’une concurrence « loyale ».
L’impuissance organisée du secteur public
PTT, SNCF, DDE, EDF-GDF, DDASS, la liste est longue des acronymes synonymes d’une époque où le secteur public ne se contentait pas d’édicter et de contrôler des normes, mais était un acteur au service de la population.
Or, il a été décidé (sans aucun mandat pour cela) de mettre fin à cet état des choses, et à la place de ces services publics agissants, de construire des marchés. Marchés nécessitant la destruction des structures publiques officiant dans ce secteur, qui, en pareil cas, constituent une concurrence déloyale. Car un service public, parce qu’il est financé par des impôts, a une obligation de service public et non de rentabilité financière, et est ainsi soutenu par l’État en cas de difficulté.
Plus précisément, un service public ne doit jamais cesser de fonctionner, contrairement à une entreprise dont les principes du marché requièrent qu’elle puisse faire faillite, et l’État doit garantir la poursuite du service quoiqu’il arrive. Cependant, cette aide apportée par l’État les mettait dans une position différente des autres acteurs sur le marché, « faussant » ainsi la concurrence.
Pour garantir une égalité de traitement entre les services publics et autres acteurs, les services publics associés ont été systématiquement privés de tous leurs volets opérationnels, incompatibles avec l’établissement du marché (par privatisation, externalisation, décentralisation, etc.), pour ne garder que les fonctions de contrôle et parfois de pilotage.
Les agents publics, experts opérationnels, sont donc devenus progressivement juste des agents de contrôle, voire des agents de supervision des structures privées effectuant les contrôles. Or, il faut bien justifier, ne serait-ce qu’à ses propres yeux son propre travail. Aussi, lorsque notre rôle se réduit à une fonction de contrôle de règles et de normes, a-t-on tendance à y mettre tout notre zèle, pour faire la différence ; afin de repérer des choses non conformes, souvent sans conséquences, mais dont la recherche et l’éradication justifient à nos yeux notre activité quotidienne.
Le seul sens, la seule manière de faire la différence qui nous reste réside donc dans le fait de traquer sévèrement tout ce que font les gens qui agissent réellement et qui ne respecteraient pas ce qui est prévu par la loi ou les normes, puisqu’on ne peut plus agir nous-mêmes. A contrario, lorsqu’on a été de l’autre côté de la barrière et qu’on a soi-même connu le côté opérationnel, ce zèle est tout à fait évitable : lorsqu’on connaît pour l’avoir vécu comment les choses fonctionnent, on a davantage de discernement pour savoir comment effectuer des contrôles pertinents.
Par ailleurs, la perte des capacités opérationnelles saborde d’autant plus la puissance publique qu’en se privant d’agents compétents techniquement parlant, elle perd même la capacité à piloter le privé pour accomplir des tâches complexes : quand on n’y comprend rien, comment définir un cahier des charges sur un sujet non trivial ? Comment suivre l’avancement d’un marché public ? Comment certifier que la mission est correctement remplie par le prestataire, si l’on n’a aucune idée de comment cela fonctionne ?
Ainsi donc, c’est l’impuissance à agir de cette administration croupion qui favorise la tendance à être particulièrement tatillon sur des vétilles, déjà fortement encouragée par ailleurs.
Il ressort de tout cela que les fonctionnaires sont un bouc émissaire bien commode lorsqu’il s’agit de déplorer une situation résultant pourtant de choix du personnel politique, tant en termes de quantité de lois votées, de construction et d’extension à marche forcée du domaine du Marché et, pour ce faire, de démantèlement des services publics au service des citoyens.
Notes
(1) L’administration n’appréciant guère d’ouvrir ses arcanes au tout venant, fût-il un citoyen en droit de demander des comptes, il est d’autant plus ardu pour le quidam désireux de comprendre de venir enquêter sur pourquoi les choses sont comme elles sont.
(2) La liste de ces importations et l’explication de leur nocivité pouvant faire l’objet d’un volume de plusieurs centaines de pages, ce qui suivra ne sera donc nécessairement pas exhaustif.
(3) Il y a par exemple des normes sur les écrous et tournevis, afin de bien s’assurer notamment de leur interchangeabilité indépendamment du fabricant.
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


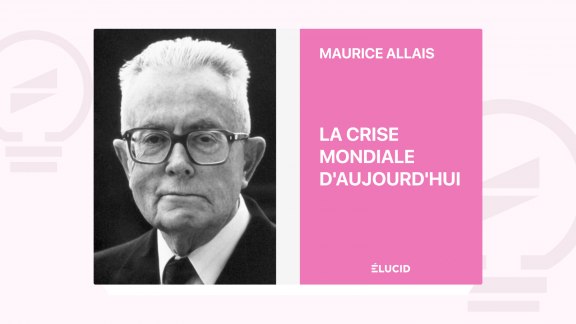

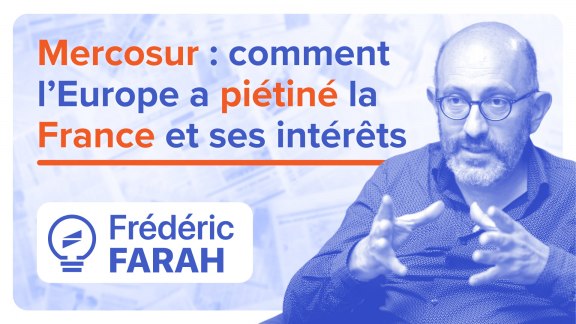


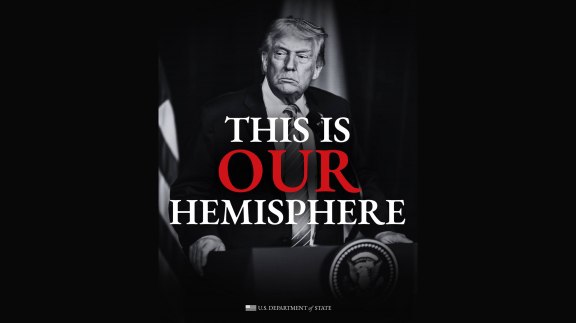
12 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner