Alors que l’Union européenne se découvre un adversaire géopolitique qu’elle n’attendait pas, il lui faut faire face à ses incapacités dans ce domaine, dans des circonstances défavorables marquées par le reflux de l’européisme et par un affaiblissement économique préoccupant.

L’ambition clairement exprimée par le nouveau président américain d’annexer le Groenland place l’Union européenne dans une situation intenable, puisque c’est de l’intérieur même de l’alliance nord-atlantique que surgit une menace contre la souveraineté d’un des 27, le Danemark. Au nom de la « sécurité nationale », Donald Trump ne voit aucun inconvénient à l’idée de piétiner l’intégrité territoriale d’un allié pourtant fidèle, dont la participation à l’OTAN et la préservation du lien transatlantique ont toujours constitué une priorité de sa politique étrangère.
Face à l’expansionnisme étasunien, l’évanescence de « l’Europe »
Si elle existait un tant soit peu en matière géopolitique, l’Union européenne devrait trouver dans cette crise une occasion d’éprouver sa solidité, de démontrer la solidarité qui unit ses États membres et leur capacité à faire face aux menaces extérieures d’où qu’elles viennent. Ce ne sera évidemment pas le cas, tant les intérêts et les cultures géopolitiques des 27 divergent : on voit mal la Pologne ou l’Allemagne sacrifier leur lien à Washington pour sauvegarder la souveraineté danoise sur le Groenland, et pas davantage les États baltes, ou même la Hongrie de Viktor Orban et l’Italie de Giorgia Meloni officiellement enchantées de la réélection de Donald Trump.
À ce stade, c’est en ordre dispersé que les Européens ont décidé de réagir… ou pas. À l’indifférence des uns répond le silence gêné des autres, et notamment de la Commission européenne, qui se souvient fort opportunément qu’elle n’a aucune prérogative en matière géopolitique, quoi que son activisme pro-ukrainien ait pu laisser penser le contraire depuis 2022. Si l’Allemagne se contente sobrement d’un appel au respect des règles sur lesquelles l’ordre international est paraît-il fondé, la France a tenu à se distinguer par la voix de son ministre des Affaires étrangères qui a affirmé, dans un accès de fermeté langagière : « Il n’est pas question que l’UE laisse d’autres nations du monde, quelles qu’elles soient, s’en prendre à ses frontières souveraines ».
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

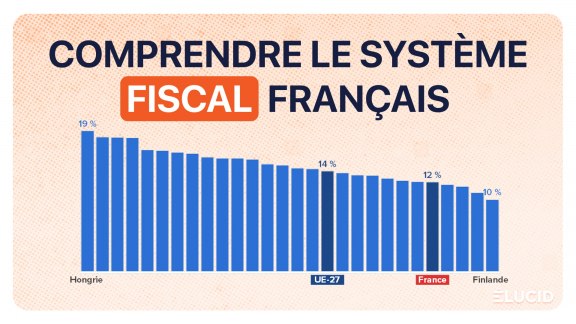
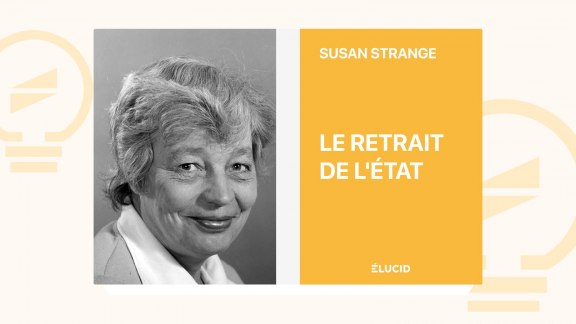


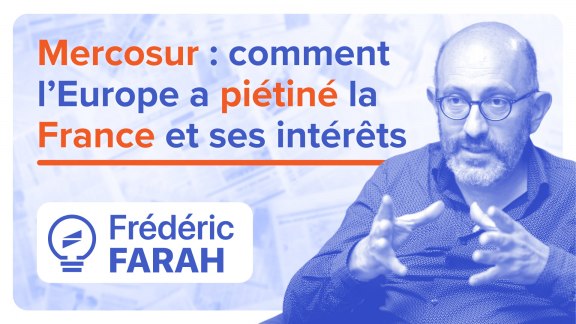


4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner