Le métier de sage-femme est à bout de souffle. Mise de côté par la loi Ségur, la profession tire la sonnette d’alarme : la situation ne peut plus durer et risque d’avoir, à terme, une conséquence sur la santé des femmes.

La situation n’a jamais été aussi grave dans les maternités. S'il est courant pour les sages-femmes de faire appel à des remplacements pendant l’été, cette année, le nuage gris s’assombrit pour le métier. D’après une récente enquête, plusieurs services ont même dû à fermer cet été… faute de professionnelles disponibles.
En Île-de-France, par exemple, « 10 lits sur 80 » seront fermés ces prochains mois à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine). Certes, la statistique ne paraît pas significative à l’échelle d’une seule maternité, mais révèle pourtant un grand dysfonctionnement des services à l’hôpital public. Mais quelles sont les causes de cet échec ?
Tout d’abord, le métier de sage-femme est de moins en moins attractif que dans le passé, comme le souligne l’Organisation nationale des syndicats de sages-femme (ONSSF).
« Nos rangs se clairsèment à longueur de temps, c’est déjà assez compliqué pour la maternité de trouver des remplaçants. Là pour l’été, c’était dramatique. Nous voulons bien accepter de plus en plus de gardes, mais nous ne pouvons pas aller travailler quand nous ne tenons plus debout. Quand nous sommes censés faire douze gardes par mois, mais que nous en faisons seize finalement, ce n’est plus possible » - Camille Dumortier, présidente de l'ONSSF
Où sont les sages-femmes ?
Ce désaveu pour le métier pourrait même se faire de plus en plus tôt, avant même le diplôme :
« Lors de leurs études, les sages-femmes rencontrent des difficultés et abandonnent de plus en plus tôt. Les étudiants ne veulent plus rentrer dans la profession. Selon le numerus clausus, 1 000 sages-femmes intègrent l’école chaque année. Désormais, seul 850 à 870 sages-femmes en sortent. Ça ne suffit absolument pas. Les deux tiers des propositions d’emploi ne sont plus pourvues. Pourtant, il n’y aucune alternative à ces remplacements, il ne peut manquer personne. »
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


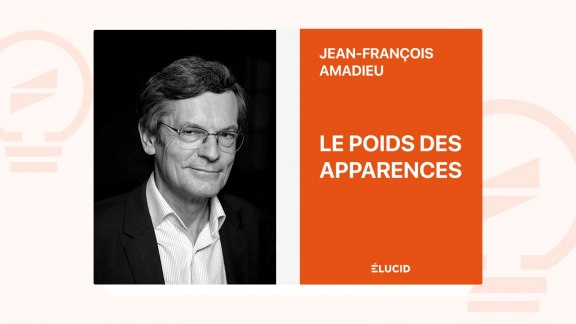

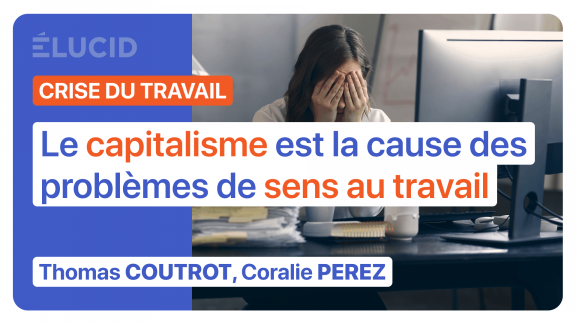

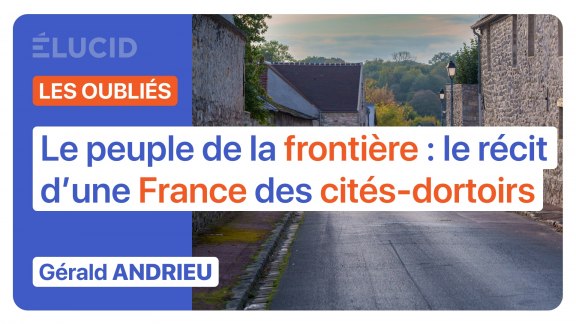

0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner