Les grands mouvements mondiaux de flux de données et d’accaparement constituent des sources d'accroissement du pouvoir des GAFAM, qui peuvent de la sorte asseoir et renforcer leur position dominante.

Rachat de concurrents potentiels avant qu'ils deviennent trop gros, étouffement de la concurrence, contraintes et taxes sur les producteurs pour accéder aux marchés numériques, etc. : les géants du numérique peuvent imposer leurs règles aux entreprises et aux consommateurs qui sont contraints de les utiliser. Cette extension des activités des géants du numérique repousse les frontières du privé – et empiète sur des activités et des services historiquement dévolus à l'État.
Le libéralisme économique prône la concurrence comme valeur cardinale : celle des entreprises, celle des travailleurs, celle des États. Paradoxalement, le XXIe siècle voit s'ériger de gigantesques monopoles dont le capital et les modes d'appropriation de la valeur sont d'un genre particulier : la monopolisation de la connaissance.
Les cartels numériques
En 2015, une juge fédérale aux États-Unis accepte une proposition de règlement amiable : Apple, Google, Intel et Adobe doivent débourser 415 millions de dollars pour avoir passé des accords secrets au détriment de leurs salariés. Les entreprises de la Silicon Valley s'étaient mises d'accord pour une politique « anti-débauchage » et le maintien de salaires artificiellement bas au moins entre 2005 et 2009. 64 000 salariés étaient représentés dans cette plainte.
Une affaire similaire s'était produite en France dans un autre secteur : en 2015, l'Autorité de la Concurrence avait condamné les entreprises du « cartel du yaourt » à 192 millions d'euros d'amende pour s'être mis d'accord sur les prix et les appels d'offres. Franceinfo précisait :
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


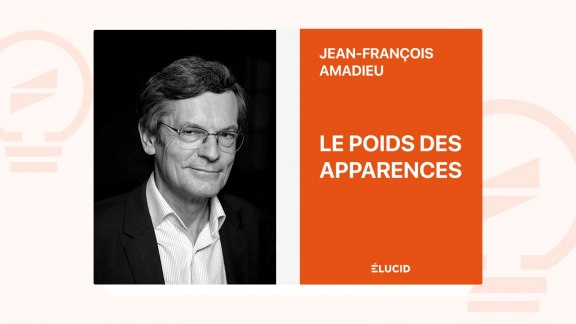

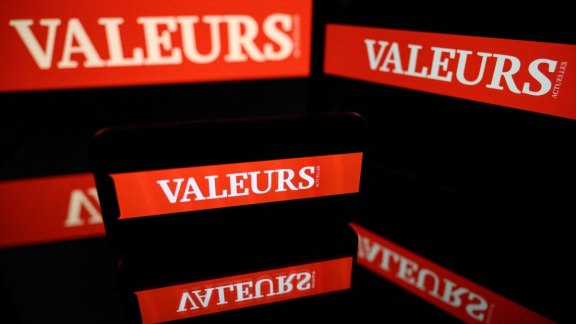
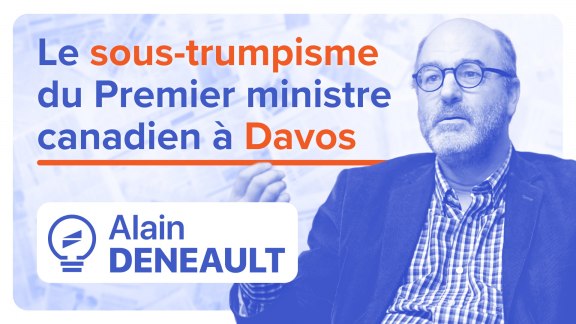
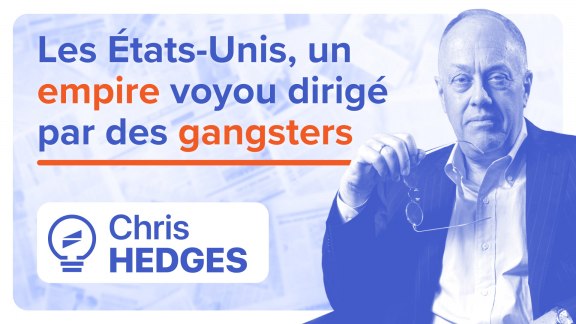

0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner