Alors qu’elle stagne sur le front, la guerre en Ukraine a pris une nouvelle ampleur dans la vie politique et économique sur le continent européen.

Les déclarations d’Emmanuel Macron, sur le fait de « ne pas écarter » l’envoi de troupes en Ukraine, ont fait réagir négativement tous ses partenaires européens et ont beaucoup occupé les médias en France et à travers le monde. Beaucoup moins commenté, au même moment, se déroule un exercice de l’OTAN, dirigé vers l’est, et occasionnant le déploiement de troupes « le plus important depuis la fin de la Guerre froide » d’après le Secrétaire à la Défense britannique.
La raison d’être de l’OTAN
L’OTAN continue de pousser vers l’est, pas seulement en exercice, mais aussi avec l’intégration de la Suède, officielle depuis le 7 mars. Un élargissement que le Kremlin dénonce comme menaçant et sur lequel il s’appuie pour justifier son invasion de l’Ukraine. Les deux puissances nucléaires sont ainsi prises dans un cercle vicieux dans lequel elles se rapprochent géographiquement l’une de l’autre, leurs dangereuses progressions se justifiant par elle-même.
L’élargissement de l’OTAN est présenté par ses membres comme unique moyen de se protéger de la Russie, alors que la Russie présente l’élargissement de l’OTAN comme la menace contre laquelle elle doit se protéger. Du point de vue du Général Jean-Yves Lauzier, auteur de L’Europe contre l’Europe, c’est la grande erreur de Vladimir Poutine :
« L'invasion de l'Ukraine a justifié la pérennité de l'OTAN. D'un seul coup, des gens qui pensaient, à commencer par la France, que l'OTAN c'était le passé, se retrouvent aujourd'hui à devoir montrer qu'on serait capable de s'opposer à la Russie militairement. Donc on fait des exercices, qui ont tout à fait leur utilité, mais qui sont aussi un mode d'existence. »
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

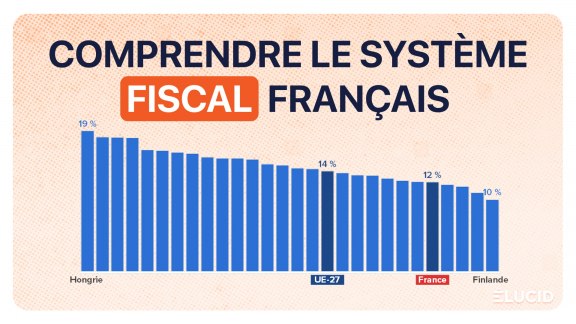
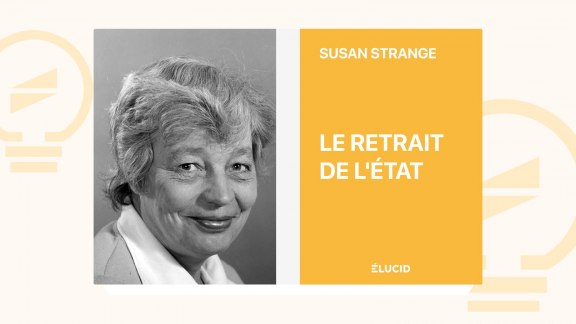

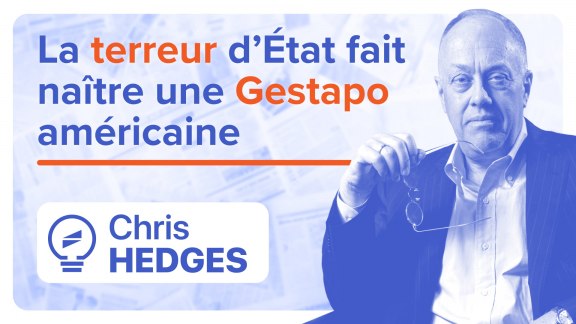
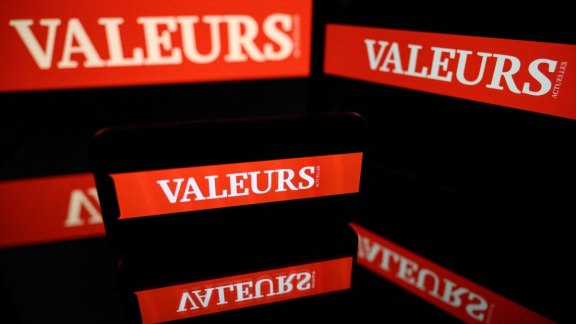
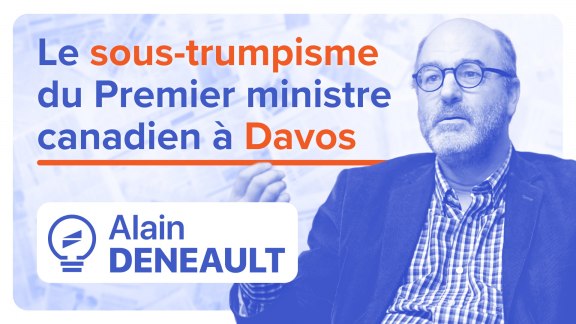
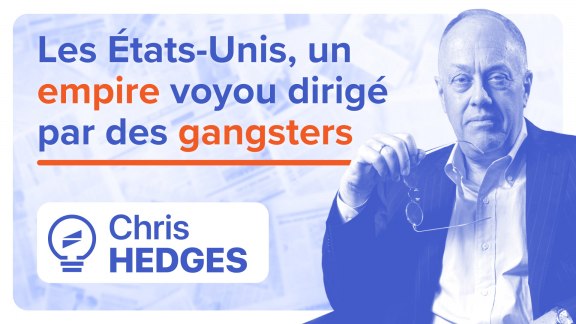
2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner