Si certains ont dénoncé la « trahison » des techno-capitalistes qui, hier, soutenaient le Parti démocrate américain, le glissement d’une frange influente de la Silicon Valley vers le trumpisme réactionnaire révèle une vérité plus profonde. Si beaucoup opposent les « progressistes » de la Big Tech à l'extrême droite, ce phénomène témoigne au contraire d'un commun idéal anti-démocratique et anti-humaniste, mais aussi d'une même haine de l'humain et de la vie incarnée.


Abonnement Élucid
Elon Musk (Tesla, SpaceX, X), Peter Thiel (PayPal, Palantir…), Jeff Bezos (Amazon), Sam Altman (OpenAI), David Sacks (PayPal, Geni…) ou Mark Zuckerberg (Meta) : le glissement idéologique de plusieurs figures influentes de la Silicon Valley vers Donald Trump a parfois été dénoncé comme une « trahison ». C'est, il est vrai, le Parti démocrate qui avait jusque-là principalement bénéficié des largesses financières de la Big Tech.
Mais voir dans ce retournement une simple « trahison » ou un pragmatisme opportuniste lié aux velléités de régulation portées par l’administration Biden est un contresens. Car le cœur idéologique de la Silicon Valley n'a, en réalité, jamais varié. Le techno-capitalisme y prospère sur un fond doctrinal où la foi dans la croissance illimitée, la sanctuarisation du marché, le culte de l’innovation et la fascination pour les promesses du transhumanisme sont constitutifs. En témoigne le Manifeste techno-optimiste de l'un d'entre eux, Marc Andreessen, qui défend une vision du monde qui nie les limites planétaires, méprise l'écologie qualifiée de « mensongère » (1) et prône une fuite en avant technicienne pour « libérer l’esprit humain ».
Ce qui frappe, rétrospectivement, c’est l’incroyable naïveté politique qui a longtemps entouré ces acteurs. C'est un impensé politique aberrant, en particulier pour la gauche, de n'avoir pas vu, pendant tant d'années, dans ces outils (Facebook, Twitter, le smartphone…) la propriété de techno-capitalistes qui ne mettaient pas à disposition, avec magnanimité, des « services » publics ou des médias alternatifs dévolus au débat démocratique (2) ?
Car le vrai sujet n’est pas tant la couleur partisane des géants du numérique que le monde qu’ils façonnent. Un monde technicien, né de la « révolution numérique », qui emporte avec lui un imaginaire, une culture, des affects, des usages – bref, une vision de l'humain. Comme l'a analysé Jacques Ellul dans Le Bluff technologique (Hachette, 1988) : « […] la technique n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'elle emporte par elle-même, et, quel que soit l'usage que l'on veuille en faire, un certain nombre de conséquences positives ou négatives ». Elle implique en effet un rapport au monde, au corps, au langage, au temps, à autrui. Et comme il l'exprime également dans L'Empire du non-sens, « la technique devient un milieu » : c'est en elle, et non plus dans la nature, que l'individu contemporain vit, pense, ressent (3).
Ce monde que fabrique la Technique
Or, ce monde technicien n’augmente pas l’humain – il le dépossède. L’IA générative, les applications de navigation ou de rédaction automatisée, les réseaux sociaux omniprésents : tout cela délègue, remplace, atrophie. Mémoire, concentration, imagination, jugement et synthèse deviennent superflus dans le monde de l'IA générative, du GPS, de la robotique et des smartphones qui, dès l'enfance, normalisent une dévastation cognitive et physique à l'échelle de la planète. Ce n’est pas la lente transformation de l’humain par des outils, mais sa mutation brutale sous l’effet d’artefacts qui s’interposent entre lui et le réel, entre lui et les autres.
Et cette dépossession n’est pas qu’individuelle. Elle est civilisationnelle. La culture du clic et de la dopamine algorithmique affaisse le jugement critique, désorganise le débat public et favorise une pensée réflexe, pulsionnelle, binaire. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le succès des discours autoritaires. Face au chaos d’un monde technicisé, complexe, insaisissable, le besoin d’ordre brutal, simple, régressif grandit. L’extrême droite techno-libertarienne – de Trump à Bukele, de Musk à Milei – fait prospérer son imaginaire dans ce désarroi.
C'est d'ailleurs bien cette droite techno-optimiste (4) qui développe un discours obsessionnel sur la « liberté », parce que « nous sommes disposés à croire que la liberté requiert l'abolition de l'expérience de la nécessité, et en particulier de la résistance que nous oppose le réel », ainsi que l'analyse Daniel Cérézuelle (L'échappée, 2021). « L'expérience de la limite et de l'obstacle est donc toujours vécue comme un amoindrissement de notre liberté, comme une imperfection, et nous nous imaginons volontiers qu'être libre c'est abolir ce qui résiste à notre volonté et ce qui limite notre puissance ».
Haine du corps, des limites, de la démocratie
C'est ce que les fétichistes du Progrès, dont les plus naïfs sont peut-être ceux de la gauche, ne veulent pas voir. Günther Anders avait anticipé cette dynamique dans L'Obsolescence de l'homme (5). Il évoquait la « honte prométhéenne », ce sentiment d’infériorité de l’humain devant ses propres créations technologiques, dont il ne maîtrise ni le développement ni les conséquences. Le résultat ? Une dévalorisation de l’humain lui-même, considéré comme imparfait, lent, fragile, fini – donc, en un sens, dérisoire, insuffisant.
L’être humain, dans sa chair, dans sa vulnérabilité, dans son historicité, devient une erreur à corriger, voire un stade à dépasser. C'est là que se révèle la cohérence de cet imaginaire « techno-optimiste » de la Big Tech avec certaines de ses tendances eugénistes et transhumanistes (à l'image d'un Elon Musk espérant pouvoir accomplir technologiquement le transfert de la conscience sur un support électronique), mais aussi avec le mépris de la démocratie chez eux (Peter Thiel en premier lieu) et leurs idéologues néoréactionnaires (Curtis Yarvin ou Nick Land). De la haine du corps, de la vulnérabilité et la mortalité humaines – qui doivent être dépassées – à celle de la démocratie, il y a une cohérence profonde.
Leur dénominateur en commun, une volonté de puissance plus proche d'Ayn Rand que de Friedrich Nietzsche, implique fondamentalement le rejet du tragique de la condition humaine et des limites de quelque type qu'elles soient – politiques, fiscales, géographiques, géophysiques-environnementales, morales et éthiques. Leur haine – régressive, infantile – des limites est le fondement tout à la fois de leur indifférence à l'enjeu écologique, de leur haine de la démocratie, de leur préférence pour les autocrates, de leur mépris de la vérité – et in fine de leur positionnement « libertarien ». Le ralliement à l'internationale réactionnaire est donc moins un revirement que la conséquence logique d'un rapport au monde intrinsèquement antidémocratique – celui de la Technique.
C'est à l'aune de cette question de l'illimitation de la Technique comme incompatible avec la démocratie qu'il faut rappeler combien l'acceptation du tragique était, pour le philosophe Cornelius Castoriadis, la condition sine qua non de la démocratie. Ainsi, écrivait-il (6) :
« Dans une démocratie, le peuple peut faire n'importe quoi – et doit savoir qu'il ne doit pas faire n'importe quoi. La démocratie est le régime de l'autolimitation ; elle est donc aussi le régime du risque historique – autre manière de dire qu'elle est le régime de la liberté – et un régime tragique. […] Et il n'y a aucun moyen d'éliminer les risques d'une hubris collective. Personne ne peut protéger l'humanité contre la folie ou le suicide. »
C'est peu dire que le mythe progressiste qui sous-tend le système technicien, dont on voit maintenant la nature réactionnaire, obscurantiste et régressive, a toujours été contraire au tragique et à l'idéal d'autonomie qui fonde la démocratie. C'est pourquoi, contrairement au philosophe de la gauche dite « radicale », Geoffroy de Lagasnerie, qui déclare assez naïvement avoir « beaucoup de mal à penser la technique du point de vue du pouvoir », la Technique, le smartphone, les réseaux dits « sociaux » sont bel et bien une question politique majeure. Et même décisive... ce que les extrêmes droites ont compris de toute évidence.
Notes
(1) « On nous dit que la technologie nous vole nos emplois, réduit nos salaires, accroît les inégalités, menace notre santé, détruit l'environnement, dégrade la société, corrompt nos enfants, altère notre humanité, menace notre futur et est sur le point de détruire tout », écrit-il dans le premier point de son manifeste, intitulé « Mensonges », d'une façon péremptoire, envers et contre une abondance de preuves empiriques solides…
(2) À ce sujet, citons l'analyse très représentative du philosophe chouchou de la gauche dite « radicale », Geoffroy de Lagasnerie : « J'ai beaucoup de mal à penser la technique du point de vue du pouvoir. La technique, on peut toujours s’en retirer. Je ne vois aucun effet de pouvoir de Facebook, de Twitter ou d’Instagram parce que je peux les fermer. Le seul pouvoir dont je ne peux me retirer, c’est l’État. Mais Facebook ne me met pas en prison. Instagram ne me met pas en prison. Mon iPhone ne me met pas en prison » (“Guérilla juridique, infiltration, action directe… Il faut déployer un autre imaginaire de l’action”, entretien avec Hervé Kempf, Reporterre, 28 novembre 2020). De Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau à David Guiraud ou Louis Boyard, c'est peu dire que la gauche montre quotidiennement le peu de distance critique qu'elle entretient avec les cadres formels et systémiques du monde numérique – ce qui ne manque pas d'étonner, alors que la gauche est si riche d'une histoire de critique des médias.
(3) L'Empire du non-sens. L'art et la société technicienne, PUF, 1980. Rééd. L'échappée, 2021.
(4) « Je suis un techno-optimiste fanatique », a ainsi confessé Javier Milei lors d'un entretien télévisé de complaisance, après qu'une affaire a éclaté, qui le mettait en cause pour un délit d'initié dans une arnaque en façon de pyramide de Ponzi à laquelle il a apporté sa caution – vraisemblablement sans en connaître la nature. Cependant, de la « start-up nation » d'Emmanuel Macron à la fascination de Jean-Luc Mélenchon pour le progrès technique, c'est l'ensemble du monde politique qui, à un degré plus ou moins avancé, peut être qualifié de techno-optimiste.
(5) L'obsolescence de l'homme. Sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, 1956. Réédition L'Encyclopédie des nuisances, 2002.
(6) « La polis grecque et la création de la démocratie », cité dans « Cornelius Castoriadis et la création politique (2) », sur le site Implications philosophiques.
Photo d'ouverture : @Midjourney
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

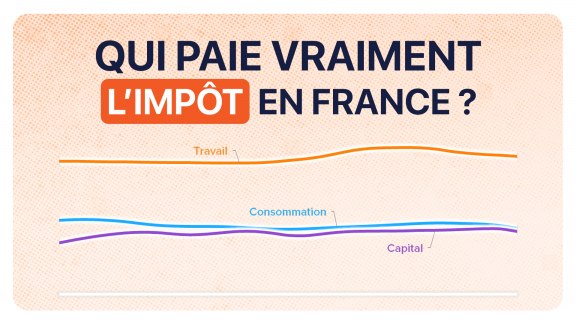
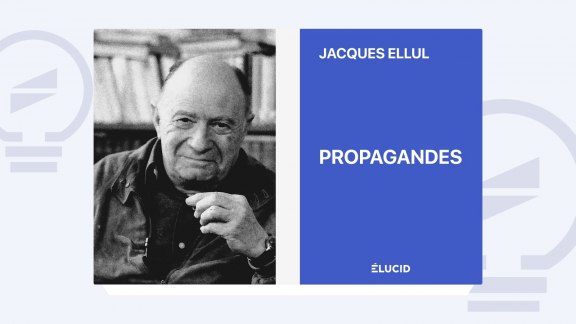


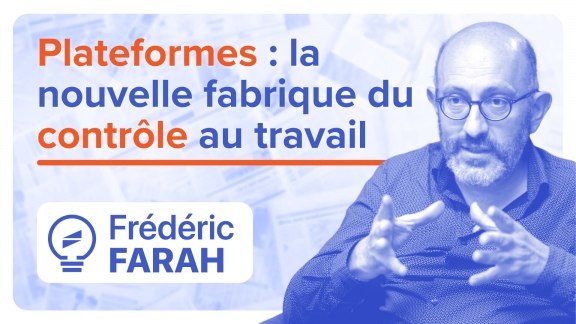

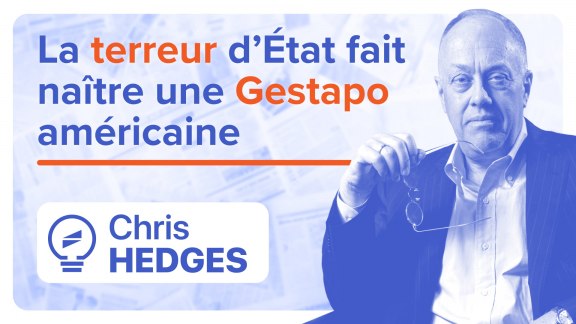
3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner