Article élu d'intérêt général
Les lecteurs d’Élucid ont voté pour rendre cet article gratuit.
La liberté est aujourd’hui trop souvent confondue avec la délivrance des nécessités de la vie quotidienne, alors qu'elle se situe dans l’autonomie individuelle et collective. Aurélien Berlan, docteur en philosophie et maître de conférences à l’université de Toulouse, invite les citoyens dans Terre et Liberté (La Lenteur, 2023) à faire le maximum de choses par eux-mêmes afin de s’extraire de la dépendance au système capitaliste. Lui-même s’adonne simultanément à des activités de subsistance au quotidien dans la campagne du Tarn où il vit.



Abonnement Élucid
Laurent Ottavi (Élucid) : Les détracteurs du libéralisme ont tendance à souligner ses effets inégalitaires, mais ils peuvent aussi lui attribuer la paternité de certaines formes de contrôle social. Le libéralisme en est-il venu aujourd’hui à se faire l’ennemi de la liberté ?
Aurélien Berlan : Nous sommes censés vivre dans des sociétés libérales ou néolibérales. Dès lors que j’ai pris conscience des problèmes que posait notre conception actuelle de la liberté et de l’émancipation, notamment sur le plan écologique, mon premier geste a été d’aller relire les penseurs libéraux. La liberté ne se confond pas pour eux avec la démocratie comme chez les anciens Grecs et comme le pense encore une partie du sens commun. Les libéraux l’associent plutôt à l’État de droit, en d’autres termes à un État dont l’activité est encadrée par une Constitution. Dans ce cadre, la liberté se définit par l’inviolabilité de la vie privée : elle repose sur la reconnaissance d’un certain nombre de droits, ou de libertés fondamentales et inaliénables, accordés aux individus.
Le paradoxe est que cette conception libérale de la liberté n’est plus garantie aujourd’hui dans le contexte du développement du capitalisme numérique. L’inviolabilité de la vie privée est piétinée par une surveillance et une analyse constantes des comportements au moyen des technologies de l’information et de la communication, que cette surveillance soit le fait des États – comme l’a révélé Edward Snowden en 2013 – ou qu’elle soit réalisée par les grandes entreprises – comme les GAFAM qui récoltent toujours plus de données sur nous pour les vendre ou les fournir aux États.
Élucid : Comment expliquez-vous que, dans ces conditions, beaucoup de gens se sentent toujours libres dans la société libérale ou néolibérale ou, en tout cas, pas moins libres qu’avant ?
Aurélien Berlan : J’y vois l’indice que notre sentiment de la liberté est alimenté par autre chose que la certitude de l’inviolabilité de la vie privée. L’idée de liberté qui domine notre société ne se joue pas sur le plan des institutions juridiques et politiques, mais sur celui de la vie quotidienne. Elle touche fondamentalement à la volonté d’être délivré des contraintes de la vie sociale et matérielle. Être libre, autrement dit, équivaut à ne pas avoir à faire un certain nombre de corvées, de tâches pénibles, chronophages et routinières : produire de quoi se nourrir, fabriquer et réparer son logement, s’occuper des personnes dépendantes autour de nous, etc.
D’où le succès de sociétés comme Deliveroo, qui permet de se décharger non seulement de la tâche de faire à manger, mais aussi d’avoir à se déplacer pour acheter son repas. Cette idée que la liberté suppose la délivrance des nécessités de la vie matérielle n’apparaît pas explicitement sous la plume des penseurs libéraux, mais elle traverse implicitement toute la pensée libérale. Adam Smith, pour ne prendre qu’un seul exemple, détermine la valeur d’une marchandise à partir de sa capacité à nous épargner un certain nombre des maux de l’existence liés aux activités quotidiennes de subsistance.
« L’assimilation de la liberté à la libération du labeur et du besoin est une conception aristocratique qui précède de loin le libéralisme et le marxisme. »
Le marxisme différait-il tant que cela du libéralisme dans ses aspirations ?
Cette idée de délivrance n’est jamais défendue pour elle-même chez les auteurs libéraux. Ils font plutôt l’apologie du travail que celle de la délivrance du travail et de la nécessité. Le seul penseur moderne à avoir prôné une liberté assimilée à la délivrance est précisément Karl Marx ! Il l’oppose au « règne de la nécessité », identifié à tout ce qu’il faut faire pour satisfaire nos besoins premiers. Si Marx était tant favorable, comme les libéraux, au développement économique, technologique et industriel, c’est justement parce que ce dernier faisait miroiter l’espoir que tous les êtres humains pourraient un jour être délivrés, comme les aristocrates et les bourgeois, des contraintes liées aux activités de subsistance.
Si le libéralisme et le marxisme partagent une même conception de la liberté, celle d’une délivrance de la nécessité, seraient-ils le produit d’une même matrice ?
L’assimilation de la liberté à la libération du labeur et du besoin est une conception aristocratique qui précède de loin le libéralisme et le marxisme. Les nobles ont toujours voulu être exonérés des tâches de subsistance, qu’il s’agisse de travailler la terre ou même, pour les femmes, d'allaiter les nourrissons (les nobles le faisaient faire à des nourrices). Pour les aristocrates grecs, les eupatrides (les « bien nés »), dont Platon était un représentant, l’homme libre possède des esclaves afin de pouvoir se consacrer pleinement aux activités politiques, à la création artistique, à la théorie, etc. Il existe une continuité entre la conception aristocratique de la liberté dans le monde antique et médiéval, la conception bourgeoise et libérale dans les temps modernes et la conception socialiste de l’émancipation, notamment celle défendue par les marxistes.
Qu'est-ce que cette continuité historique implique en termes de domination sociale ?
Pour être libre au sens de la délivrance, il faut être affranchi des tâches de subsistance jugées chronophages, fatigantes et peu réjouissantes. Le seul moyen est de les faire faire par d’autres, ce qui suppose la domination sociale. Dans l’antiquité, la solution fut l’institution de l’esclavage, au Moyen Âge celle du servage, et dans les temps modernes celle du salariat, vécu par les ouvriers comme une forme d’esclavage déguisé.
Une telle conception de la liberté comme délivrance contredit donc l’idée que tous les humains naissent libres et égaux, qui est au cœur de l’idéologie bourgeoise et de la pensée moderne. Si l’on veut être à la hauteur de cette promesse utopique, qui consiste à dire qu’aucun être humain ne doit être l’esclave d’un autre (au sens strict ou au sens large), il faut abandonner l’identification de la liberté à la délivrance. C’est à cette condition que nous pourrons changer de modèle de société aujourd’hui.
« Avec les Trente Glorieuses, les citoyens, rassasiés sur le plan des besoins fondamentaux, sont pour ainsi dire "pacifiés", réduits à une passivité politique larvée. »
L’accès à la liberté ne s’est-il toutefois pas massifié au XXe et au début du XXIe siècles ?
La délivrance s’est peu à peu généralisée dans les sociétés occidentales à partir, grosso modo, des Trente Glorieuses. La société de consommation qui apparaît alors élargit l’accès à un mode de vie délivré du labeur physique, du besoin, et des affres de la pénurie à des pans croissants de la population. Les gens se nourrissent, se vêtissent et se chauffent avec plus de facilité – mais la contrepartie, c’est qu’ils sont de plus en plus dépendants du système capitaliste, donc soumis aux élites qui le dirigent, car il est difficile de mordre la main de ceux qui nous nourrissent.
Nous sommes pour beaucoup d’entre nous devenus comme le chien de la fable de Jean de la Fontaine. Nous sommes bien nourris, logés et vêtus par le système, mais en échange nous avons une chaîne autour du cou. Nous préférons ce destin à celui du loup de la fable qui est plus libre, mais n’est pas délivré du besoin. Le capitalisme de consommation est à ce titre un système de domestication des masses, où les citoyens, rassasiés sur le plan des besoins fondamentaux, sont pour ainsi dire « pacifiés », réduits à une passivité politique larvée.
Mais si les classes populaires se sont facilement converties au projet de délivrance de la nécessité, c’est pour une raison bien simple : avant les Trente Glorieuses, elles ployaient sous le poids d’une double nécessité, satisfaire leurs nécessités et celles des classes dominantes qui les exploitaient. Il est donc compréhensible qu’elles aient embrassé avec soulagement la promesse d’être délivré des nécessités de la vie, en dépit du fait que cette délivrance allait verrouiller leur impuissance face au système capitaliste, comme l’ont vite compris certains critiques précoces de la société de consommation.
La domination que vous avez évoquée sur certaines parties de la population (à propos de la conception aristocratique de la liberté) ne se double-t-elle pas également d’une domination sur la nature ?
À partir du XVIIe siècle, une partie de la bourgeoisie européenne a pris conscience de la contradiction entre le rêve de délivrance et le principe de liberté égale pour tous. L’idée apparaît alors chez Descartes et d’autres auteurs que, si l’on parvenait à se rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature », c’est-à-dire à l’exploiter de la même façon que l’on exploitait les esclaves de l’Antiquité, les classes dominantes pourraient alors se passer d’esclaves et de serfs. Bref, le projet était de remplacer la domination sociale des classes inférieures par la domination technique et scientifique de la nature.
La domination de la nature permettrait de mettre la délivrance à portée de toutes et tous. À l’époque, c’était totalement fantasmatique. Mais ce projet est peu à peu devenu possible avec la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, la domestication de la vapeur, le recours aux énergies fossiles et la construction de machines de plus en plus précises et efficaces. Cette promesse égalitaire permet de comprendre l’adhésion de Marx au projet de délivrance de la nécessité.
« À la liberté comme délivrance, j’oppose la liberté au sens de l’autonomie : non pas être déchargé des nécessités, mais les prendre en charge nous-mêmes. »
Sortir de la situation actuelle de domestication des masses requiert une autre conception de la liberté. Existe-t-elle de nos jours de façon résiduelle et comment la qualifiez-vous ?
À la liberté comme délivrance, j’oppose la liberté au sens de l’autonomie : non pas être déchargé des nécessités, mais les prendre en charge nous-mêmes. Il existe encore dans nos sociétés modernes des formes d’autoproduction, certes marginales, permettant d’être moins dépendants des supermarchés et du système industriel en général.
Ces formes d’autonomie sont portées par une partie des classes populaires, notamment rurales, celle qui n’a pas totalement rompu avec sa culture vernaculaire d’origine au profit de la culture de la consommation de masse – et actuellement, elles sont réinvesties par les franges des classes moyennes qui cherchent à déserter, à s’émanciper du système capitaliste, en développant d’autres formes de vie, notamment à la campagne. En dehors des sociétés occidentales, en revanche, l’immense majorité des gens, notamment les paysans, subviennent à une bonne partie de leurs propres besoins à travers une agriculture vivrière et locale qui les rend bien moins dépendants des circuits capitalistes mondiaux.
Vous vous êtes installé à la campagne pour gagner en autonomie. Comment avez-vous réussi à vous dégager de l’imaginaire capitaliste et, plus largement, de l’imaginaire de la liberté conçue comme la délivrance de la nécessité ?
Je suis issu des classes moyennes intellectuelles, mes parents avaient peu d’activités manuelles et l’idée de produire des choses par moi-même ne m’était jamais venue à l’esprit. Les choses ont changé pour moi au terme d’un processus de réflexion sur ce qui n’allait pas dans la société, et notamment sur ce qui faisait qu’on était totalement impuissant face à une évolution socio-écologique dont on savait pourtant qu’elle nous conduisait dans le mur. J’en suis venu à considérer que le problème était que nous étions devenus totalement dépendants d’un système destructeur.
J’ai alors commencé à me réapproprier certaines pratiques de subsistance (produire une partie de ma nourriture ou rénover mon logement sans passer par les circuits marchands ou les administrations étatiques), ce qui m’a permis de décoloniser mon imaginaire. J’en ai tiré une grande liberté et une certaine confiance en moi. À partir du moment où l’on reprend ses conditions de vie en main, au moins en partie, on reprend confiance dans notre capacité de jouer un rôle politique.
Inversement, le fait de tout déléguer à des « pros » et des « experts », notre alimentation comme notre logement, notre santé comme l’éducation de nos enfants, ne peut que conduire à l’apathie politique : le sentiment que, sur le plan politique aussi, il faut s’en remettre à des experts, en l’occurrence à une classe politicienne qui se constitue en oligarchie. Faire les choses par soi-même est la solution à beaucoup de nos maux.
« Quand on se bat, comme tant de peuples dans le monde, pour accéder aux ressources et assurer sa subsistance, on estime que l’émancipation sociale suppose de se prendre en charge soi-même. »
Vous avez commencé l’entretien en évoquant votre désir d’aller relire les auteurs libéraux pour comprendre la conception dominante de la liberté aujourd’hui. Avez-vous également été porté à étudier des mouvements sociaux animés par une autre conception de la liberté ou à faire des recherches sur des façons alternatives de se constituer en société ? En quoi ces expériences peuvent-elles nous aider à prendre un autre chemin collectif ?
Nous avons vu que l’idée de délivrance était déjà présente sous l’Antiquité, avant de devenir hégémonique dans l’Occident du XXe siècle. Elle est aussi très présente, sous des formes variées, notamment religieuses, dans d’autres civilisations. Mais c’est contre la conception de la liberté comme autonomie, surtout portée par les classes populaires, qu’elle s’est imposée.
L’aspiration à l’autonomie a rarement été théorisée, mais elle imprègne la texture même des modes de vie et des luttes populaires contre la domination. Quand on se bat, comme tant de peuples dans le monde, pour accéder aux ressources (la terre, la forêt, l’eau, les moulins, les fours, etc.) permettant d’assurer sa subsistance, cela signifie implicitement que l’on estime que l’émancipation sociale suppose, non d’être affranchi des nécessités de la vie quotidienne, mais de se prendre en charge soi-même.
Si l’on suit la logique que vous avez établie précédemment en évoquant différents continuums, la liberté comme autonomie dont vous parlez ne va-t-elle pas de pair avec plus de démocratie directe ?
L’autonomie suppose de façon générale de changer d’échelle. Plus on s’organise à une échelle vaste, plus le pouvoir tend à être confisqué par une direction séparée. Et sur le plan écologique, les « économies d’échelles » conduisent toujours à des formes de production encore plus nocives et polluantes. Karl Marx avait trop sous-estimé ces problèmes de domination des humains et de la nature liés aux gains industriels de productivité.
L’aspiration à l’autonomie politique et matérielle conduit à valoriser la relocalisation et le rapprochement des instances de décision et de production, donc le municipalisme libertaire, le régionalisme, les circuits courts, etc. Pour le dire d’un mot, je défends l’idée de retrouver une échelle à taille humaine pour tout.
« Les élites capitalistes tenteront de profiter de l'aggravation écologique pour lutter contre les pratiques de subsistance, afin de maintenir le plus possible les populations en dépendance vis-à-vis du système. »
Le fossé semble immense entre la voie de l’autonomie que vous proposez et la réalité d’une dépendance massive au numérique. Beaucoup peuvent adhérer à vos idées tout en les jugeant impossibles à concrétiser. Que leur répondez-vous ?
Je me bats bec et ongles contre la numérisation à marche forcée de notre société. Elle crée des « monopoles radicaux » (Illich) et des « effets de cliquet ». Autrement dit, les nouveaux outils, une fois généralisés, empêchent de revenir en arrière, car ils rendent quasi impossible l’utilisation des outils précédents. Aujourd’hui, l’ensemble de l’espace social et géographique est construit pour la circulation motorisée. Se déplacer à vélo ou à cheval peut s’avérer dangereux, voire impossible. La voiture est donc en situation de monopole radical. Le numérique, de même, est en passe d’établir un monopole radical sur l’information, la communication et le lien social – raison pour laquelle certaines personnes n’imaginent même plus pouvoir se passer de leur smartphone, considéré comme la condition de leur intégration sociale. Et de fait, quelqu’un sans téléphone ou ordinateur vivra bientôt comme un ermite.
Cela dit, on peut constater que l’effet de cliquet n’est pas absolu. Une partie des gens ne passe pas systématiquement par le numérique et ne se laisse pas séduire par les transhumanistes qui promettent une délivrance de la nécessité toujours plus accrue. Avec les problèmes écologiques qui vont s’aggraver, nous allons être à la croisée des chemins. D’un côté, ces problèmes peuvent nous inciter à bifurquer vers l’autonomie, la relocalisation, les pratiques de subsistance en nous inspirant de modes de vie du passé. Mais d’un autre côté, l’aggravation des conditions écologiques rendra de plus en plus difficile d’assurer notre subsistance de manière autonome et les élites capitalistes tenteront de profiter de cette aggravation pour lutter contre les pratiques de subsistance, afin de maintenir le plus possible les populations en dépendance vis-à-vis du système.
Il est déjà question, en cas de trop fortes sécheresses, d’interdire d’arroser les jardins potagers des particuliers, alors que les produits de qualité sont souvent hors de prix dans les magasins et que les grands industriels déversent de leur côté des litres et des litres d’eau sur les cultures de maïs. Rien n’est joué entre ces deux scénarios possibles. Tout dépendra de ce qu’on est capable, dès à présent, de faire pour défendre non seulement la nature, mais aussi, et par là même, une liberté authentique.
Propos recueillis par Laurent Ottavi.
Photo d'ouverture : fran_kie - @Shutterstock
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

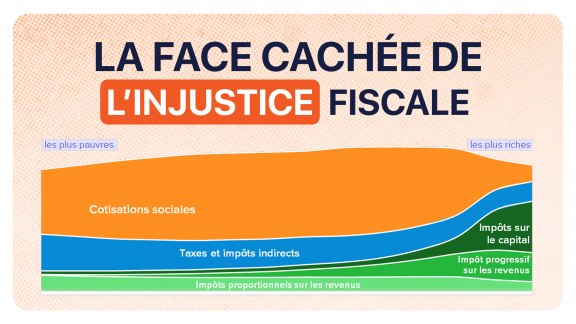






3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner