Une équipe de chercheurs a déterminé que l’Arctique pourrait connaître des étés sans glace de mer dès 2030, soit dix ans plus tôt que les prévisions du GIEC.

Essentiellement causée par les activités humaines, la disparition de la glace de mer serait irréversible, même dans le scénario d’une réduction effective des émissions de gaz à effet de serre. Si, depuis la France, cette manifestation très concrète du réchauffement climatique nous semble lointaine, elle aura – et a déjà – des répercussions dans l’ensemble du globe. Les inquiétudes qu’elle suscite sont en outre renforcées par l’opportunisme économique de certains acteurs, qui y voient de nouveaux itinéraires pour le commerce maritime.
Effet albédo
En analysant les données satellitaires de 1979 à 2019, une équipe de chercheurs a estimé dans une étude parue dans la revue Nature Communications que la glace de mer en Arctique atteindrait une surface inférieure à 1 million de kilomètres carrés à l’été dès la décennie 2030 – c’est-à-dire qu’il ne restera plus que de la glace résiduelle le long des côtes. Cette superficie est mesurée au mois de septembre, lorsqu’elle atteint son plus bas niveau.
Cette étude a également déterminé que les causes de la fonte de la glace de mer étaient essentiellement liées aux émissions de gaz à effet de serre, l’activité volcanique et les aérosols formant un facteur secondaire.
La glace de mer, qui se forme à la surface de l’océan sous l’effet du froid, est à l’origine de la formation des banquises. Si sa disparition progressive n’a pas d’effet direct sur l’élévation du niveau de la mer – contrairement à la fonte de la calotte glaciaire –, elle en est indirectement responsable, et entraînera par ailleurs une hausse du réchauffement climatique, suivant un cercle vicieux décrit par la glaciologue Heidi Sevestre, auteure de Sentinelle du climat.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

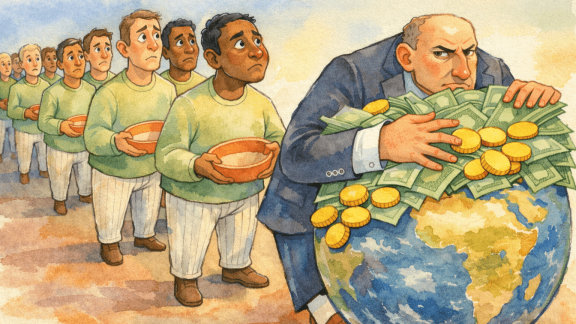
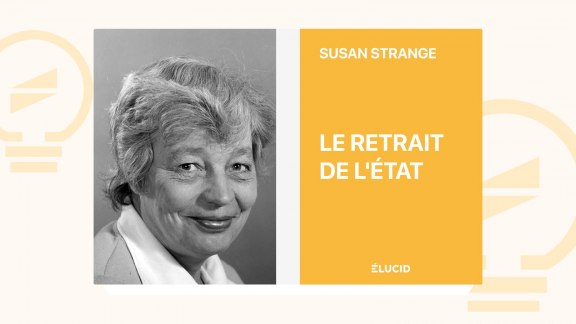





1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner