Vents extrêmement violents, pluies torrentielles, ondes de tempête, fortes inondations… Lorsque les cyclones tropicaux touchent terre, ils peuvent avoir des répercussions aussi bien humaines que matérielles très graves. Face à leur intensification dans certaines régions, beaucoup de pays deviennent de plus en plus vulnérables à ces phénomènes météorologiques extrêmes. C’est pourquoi, lors de la COP 27, les nations du monde sont parvenues à un accord sur la création d’un fonds pour compenser les « pertes et préjudices » causées par le réchauffement climatique.

Cyclones, ouragans, typhons… ce sont tous les trois des cyclones tropicaux, seuls leurs noms changent en fonction de la zone géographique dans laquelle ils se forment. D’après la définition donnée par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) :
« Un cyclone tropical est une dépression à rotation rapide qui prend naissance au-dessus des océans tropicaux, d'où elle tire l'énergie nécessaire à son développement. Les vents y soufflent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère Sud et dans le sens inverse dans l'hémisphère Nord. »
On parle d’ouragan lorsque ce phénomène climatique extrême a lieu en mer des Antilles, dans le golfe du Mexique, dans l’Atlantique Nord et dans le centre et l’est du Pacifique Nord, alors qu’on utilise le terme de typhon pour la partie ouest du Pacifique Nord, telle que les Philippines et le Japon.
« Dans le concept de cyclones tropicaux, il n’est pas uniquement question d’ouragans, il y a également des vents et des tempêtes de moindre intensité, tels que la dépression tropicale avec des vents ne dépassant pas les 63 km/h et la tempête tropicale avec des vents compris entre 64 et 118 km/h », indique Rosa Maria Roman-Cuesta, écologiste tropicale, chercheuse invitée au Laboratoire des sciences de la géo-information et de la télédétection de l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas. Elle dirige également le projet CORESCAM financé par la Fondation BNP Paribas.
Ensuite, l’échelle de Saffir Simpson permet de classer les ouragans en 5 catégories en fonction de leur intensité. « L'ouragan de catégorie 1 commence avec des vents soutenus compris entre 119 km/h et 153 km/h, et le plus intense, de catégorie 5 correspond à des vents soutenus supérieurs à 252 km/h », explique l’experte. Des agences météorologiques, telles que l’Agence américaine d'Observation Océanique et Atmosphérique (NOAA en anglais), se chargent de prévoir et d’anticiper l’arrivée d’un cyclone tropical. « Il n'y a pas de modèles de prédiction parfaits, mais il y a de bons modèles », ajoute-t-elle.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


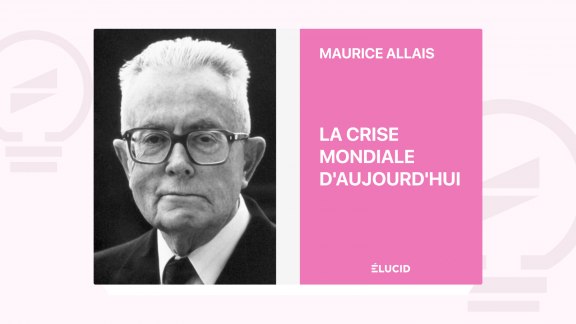





2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner