Parmi les ouvrages italiens de sociologie, Il colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa (2012), en français, « Le coup d’État des banques et des gouvernements. L’attaque contre la démocratie en Europe », propose une analyse singulière de la crise.



Abonnement Élucid
Podcast La synthèse audio
Selon l’auteur, Luciano Gallino, la crise, loin d’être un phénomène inexplicable, résulte du fonctionnement du capitalisme financiarisé et de la logique inégalitaire qu’il emporte. Plus encore, la collusion entre l’appareil d’État et la finance de marché qui caractérise le fonctionnement capitaliste déstabilise les fondements de nos démocraties.
Ce qu’il faut retenir :
La crise de 2007-2008 n’a rien d’un phénomène inexplicable ou d’une catastrophe naturelle s’abattant sur un environnement économique sain. Penser les phénomènes économiques comme des mécanismes naturels revient à les dépolitiser et refuser de les soumettre au débat. La crise de 2007-2008 prend naissance dans une économie déjà largement en prise avec les conséquences de la financiarisation.
Pour Luciano Gallino, l’utilisation du récit est déterminante dans la création de rapports de force, permettant de justifier les politiques retenues pour affronter la crise. Au lieu de la faire apparaitre pour ce qu’elle était, c’est-à-dire le fruit du capitalisme financier et déréglementé, elle a été présentée par les institutions européennes, les gouvernements comme le résultat d’une dépense publique trop généreuse et particulièrement d’une dépense sociale inconséquente. Ce récit dominant a rendu possible l’austérité appliquée au sein de l’Union européenne de 2011 à 2013.
Luciano Gallino recourt à la notion de coup d’État qui, bien qu’elle paraisse fantaisiste, a permis de mettre en lumière la responsabilité des institutions nationales, européennes et internationales dans la mise en place des politiques austéritaires. Ainsi la crise a vu naitre une série de nouveaux dispositifs d’encadrement et de limitation de la dépense publique hors de tout champ de contrôle démocratique. Désormais, les grandes orientations européennes en matière budgétaire, sociale semblent de moins en moins faire l’objet de délibérations collectives.
Biographie de l’auteur
Luciano Gallino (1927-2015) est sociologue, écrivain et professeur. Il est l’un des sociologues italiens les plus cités, expert des questions des rapports entre nouvelles technologies, formation et transformations du monde du travail.
Au cours d’une carrière très diversifiée, Luciano Gallino a œuvré pour imposer la sociologie dans le champ des sciences sociales en Italie. Professeur de sociologie à l’Université de Turin (1971-2002), président de l’association italienne de sociologie (1987-1992), il a écrit de nombreux livres et articles, se spécialisant dans la sociologie économique en lien avec les transformations du marché du travail.
Avertissement : Ce document est une synthèse de l’ouvrage de référence susvisé, réalisé par les équipes d’Élucid ; il a vocation à retranscrire les grandes idées de cet ouvrage et n’a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l’ouvrage de référence chez votre libraire. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l’ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur.
Plan de l’ouvrage
I. L’accumulation financière
II. Les inégalités comme cause de la crise
III. Les États européens libéralisent la finance
IV. Les banques européennes dans la crise
V. La crise systémique ou la criminalité organisée ?
VI. Crise bancaire et crise des comptes publics
VII. Coup d’État en Europe
VIII. Le démantèlement de l’État social
IX. La crise comme modalité de gouvernement
X. Rejeter les théories économiques néolibérales
XI. Créer de l’emploi alors que le travail disparaît
XII. La finance au service de l’économie réelle
Synthèse de l’ouvrage
Partie 1. L’origine de la grande crise globale, entre États-Unis et Union européenne
Chapitre 1. L’accumulation financière comme réponse à la stagnation économique
L’accumulation financière est née à la faveur de la crise du système dit d’accumulation productiviste (ou « compromis fordiste » selon la formule consacrée en France), qui s’était développé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le fonctionnement capitaliste reposant sur la reproduction du capital, le système d’accumulation financière est au cœur du capitalisme.
Cependant, lorsqu’un régime d’accumulation entre en crise, comme cela a été le cas, d’abord pour l’accumulation productiviste, puis pour l’accumulation financière, le phénomène peut être expliqué par des causes externes ou internes. Ceux qui privilégient les causes externes considèrent que le système économique trouverait de lui-même son équilibre grâce à sa capacité d’absorption des chocs. D’autres, comme Keynes ou Marx, privilégient les explications internes selon lesquelles le système capitaliste est intrinsèquement instable et ne pourrait éviter une crise.
L’accumulation productiviste entre en crise à partir des années 1970 face au tassement relatif des gains de productivité et du fait que les ménages avaient atteint des taux d’équipement élevés (en bien électroménagers par exemple). Depuis le début des années 2000, cette accumulation en crise a laissé place à un régime d’accumulation financière caractérisée par trois éléments : l’accumulation d’une dette sans précédent ; la constitution d’une banque de l’ombre (shadow banking) qui a transformé, au moyen de la titrisation, cet endettement massif en des titres de crédit ; et une financiarisation accrue de l’économie. Ce processus de financiarisation s’observe dans l’importance croissante des marchés financiers, des motivations financières, des institutions financières et des élites financières intégrées à l’organisation économique nationale ou internationale. Le secteur financier et les profits qu’il génère ont ainsi largement augmenté, comme la part de la dimension spéculative dans les transactions financières.
Chapitre 2. Les inégalités comme cause de la crise
Les inégalités de richesse et de revenus, en nette augmentation aux États-Unis et en Europe depuis des décennies, constituent l’autre dimension clef de la crise. Elles sont à la fois une cause structurelle de la crise et un effet accélérateur de cette dernière.
Dans le cas américain, 1 % des contribuables les plus aisés percevait 9 % du PIB en 1980 alors qu’en 2006, à la veille de la crise des subprimes, il récupérait 23 % de la richesse. En conséquence, 40 % de la population a vu son propre quota de revenu descendre, dans la même période, de 18 à 14 %.
Malheureusement, les statistiques européennes offrent une information plus lacunaire. En Italie, le dixième le plus riche de la population disposait d’un revenu de 10 à 11 fois supérieur à la part de revenu perçu par la famille ayant le revenu le plus bas. Autre mesure des inégalités, la diminution de la part des salaires en faveur des profits dans le partage de la valeur ajoutée a permis de montrer qu’entre 1976 et 2006, dans les pays de l’OCDE, la part salariale rapportée à la valeur ajoutée a diminué de dix points, passant de 67 à 57 %. En Italie, ce fut encore pire, la baisse a atteint plus de 15 points, passant de 68 % à 53 %.
Ces inégalités ont été renforcées par des pratiques illicites comme la disparition de sommes mirobolantes dans les paradis fiscaux. En 2009, on estime cette somme à dix mille milliards d’euros. Si l’on considère cette question, les inégalités sont hors de toute réelle mesure, car ce qui est renfermé dans ces paradis fiscaux ne peut être pleinement mesuré.
Cette situation est le résultat d’une redistribution inversée, c’est-à-dire du bas de l’échelle de la richesse vers le haut. Ces inégalités sont, le plus souvent, expliquées par les écarts de formation professionnelle, les plus riches profitant ainsi d’un progrès technique biaisé. Cette explication, cependant, laisse de côté la stagnation salariale et l’évasion fiscale. Pour que cette situation se transforme en crise, il a fallu articuler les inégalités à des pratiques financières créées par les banques et les institutions financières qui ont facilité l’endettement des ménages. La crise, engendrée par les inégalités, s’est transformée dans les pays de l’OCDE en une crise de la demande agrégée.
Chapitre 3. Les États européens libéralisent la finance et courtisent le capital
La crise a acquis cette ampleur parce que les États, les parlements et les institutions internationales ont ouvert la voie à une large financiarisation de l’économie, mettant en marche un processus de libéralisation financière. Le terme « dérégulation », trompeur, ne met pas en évidence l’origine de ce processus. Ses origines sont à trouver dans les traités et autres milliers de règles qui l’ont rendu possible. La modernisation et l’unification des systèmes financiers nationaux sont certainement nécessaires. Cependant, les gouvernements ont enclenché ce développement en empruntant la voie la plus dangereuse pour leurs populations en faisant naitre des risques endogènes et exogènes.
L’Union européenne a entamé ce processus de renforcement de la puissance des marchés financiers dans les années 1980 et 1990. La contre-offensive de la classe globale, de l'élite financiarisée, s’est traduite par l’abrogation des conquêtes du monde ouvrier et des classes moyennes obtenues dans le capitalisme démocratique d’après-guerre (concernant, entre autres, les services publics, les droits sociaux, ou le droit du travail). Cette offensive est le résultat de la libéralisation des mouvements de capitaux.
Les gouvernements français, allemand et britannique ont conduit ce processus avec zèle et avec le soutien des différentes instances internationales comme la Commission européenne, l’OCDE, ou le FMI.
Ce cadre à l’œuvre viendra montrer toute son importance lorsqu’au cœur de la crise de 2008, la crise financière se transformera en crise des dettes publiques puis en une crise démocratique. En effet, le pouvoir de discussion des parlements sur les grandes orientations économiques ayant été réduit à néant, la démocratie s’est ainsi appauvrie. La libre circulation des capitaux a forcé les États à courtiser le capital, essayant de lui offrir les conditions économiques, sociales et fiscales les plus favorables. La croyance selon laquelle les marchés étaient par essence efficients, c’est-à-dire capables d’assurer la meilleure allocation des ressources, a encore attaqué les fondements démocratiques, les États pensant qu’il valait mieux « obéir aux marchés » plutôt que d’agir pour les populations. Cette nouvelle situation a donné un poids sans précédent aux experts financiers et techniques, qui ont alors pris le pas sur les représentants parlementaires.
Chapitre 4. Les banques européennes dans la crise. La finance de l’ombre
Trois éléments se sont articulés pour préparer, puis accélérer la crise de 2007. Le premier de ces éléments est l’accumulation financière, développée comme réponse à la crise de l’accumulation productiviste d’après-guerre. Elle a été une réponse efficace pour trois décennies, mais s’est révélée erronée sur le long terme. Elle s’est accompagnée d’une redistribution de la richesse du bas vers le haut – deuxième élément – provoquant une croissance des inégalités sans précédent – dernier élément.
L’explication essentielle réside dans la création monétaire massive opérée par les institutions bancaires, profitant des liquidités des banques centrales. Les banques européennes et américaines ont ainsi créé des quantités de monnaie. À la fin de l’année 2007, parmi les 20 plus grands groupes bancaires du monde, 14 étaient européennes et 3 étaient américaines. Au total, les banques européennes détenaient près de vingt-huit mille milliards de dollars d’actifs. Le système financier devenu global, il n’était plus possible de séparer en la matière l’ensemble européen de l’ensemble américain.
Une véritable finance de l’ombre émergea de ce système financier, caractérisée par un vaste recours à la titrisation des crédits et aux dérivés prenant la forme d’instruments financiers de couvertures. La création de centaines de véhicules financiers a contribué à mettre un ensemble de crédits hors bilan des banques. De vastes campagnes de rachat de banques étaient mises en œuvre par d’autres. Ce système financier s’est développé hors de portée de toute régulation et de surveillance. Aussitôt ont surgi des signes de fragilité, avec la faillite des caisses d’épargne américaines en 1988, l’effondrement d’Enron en 2001 ou la faillite de la banque Lehmann Brothers en 2008.
La titrisation incontrôlée allait créer les conditions d’une crise globale du système. Les titres que les banques s’échangeaient entre elles étaient toxiques et ont créé un climat de méfiance au moment du déclenchement de la crise. Autrement dit, les banques, assoiffées, voyaient face à elles dix bouteilles d’eau, dont l’une était empoisonnée, sans savoir laquelle. Parce que les banques se méfiaient les unes des autres, elles refusaient de se prêter les sommes dont elles avaient besoin sur le marché interbancaire, obligeant alors à une intervention majeure et concertée des banques centrales. Ce soutien, sans contrepartie réelle, vint conforter le système, alors que les crédits étaient de plus en plus difficiles pour les petites et moyennes entreprises. En outre, le plein emploi, en principe au cœur des missions de certaines banques centrales passa en second plan.
Chapitre 5. Crise du système ou criminalité organisée
Si les facteurs précédemment évoqués permettent de mieux comprendre l’émergence d’une telle crise, l’explication n’est que partielle. Comment expliquer que le système financier se soit emballé jusqu’à provoquer une crise affectant des millions de personnes et réduisant considérablement l’activité ? S’agit-il de la conséquence d’erreurs d’organisation, de gestion ou de projection quant à la capacité du système à répondre aux défaillances qu’il contenait ? Ou, doit-on y voir la marque d’une certaine criminalité ?
La crise a révélé de nombreuses manœuvres frauduleuses (et pas seulement réductibles au cas de B. Madoff) : des milliers de prêts ont été accordés sciemment à des ménages dont les capacités de remboursement étaient visiblement insuffisantes. En outre, les opérations financières de titrisation de vaste ampleur et la dissimulation des créances en titre financier laissent soupçonner l’existence d’une véritable criminalité. Le terme criminalité organisée, c'est-à-dire l’accord entre plusieurs personnes pour accomplir des actions illicites pour un temps prolongé, a été employé dans plusieurs textes relatifs à la responsabilité des personnes et institutions liées la crise. En janvier 2011, le terme a été repris par le rapport de la Commission nationale d’enquête sur la crise transmise au Congrès américain. Une large section du rapport est dédiée aux conditions qui facilitent le crime. Le crime en question est celui de la fraude et particulièrement de la fraude hypothécaire. Selon la Commission, près de trois mille milliards de prêts hypothécaires de 2005 à 2007 étaient frauduleux. Les informations sur la situation du prêteur étaient incomplètes, inexistantes, ou bien la valeur du bien immobilier était excessivement amplifiée.
Les dispositifs financiers qui faisaient sortir du bilan des créances douteuses en les transformant en titre financier ont été rendus possibles par la théorie économique standard et par les agences de notation. La théorie économique dite standard a laissé entendre que les marchés financiers fonctionnaient au plus près d’une concurrence parfaite et savaient répartir les ressources de manière optimale. Selon cette théorie standard, nous étions persuadés que nous pouvions calculer les risques. Autrement dit, le danger de l’éclatement d’une bulle était écarté. Les agences de notation sont venues corroborer la valeur et la sureté de ces titres en circulation, nourrissant davantage l’aveuglement au désastre.
En somme, « la dérégulation est devenue de fait un synonyme de décriminalisation de droit ».
Partie 2. Transformation de la crise en coup d’État
Chapitre 6. Dans l’Union européenne, la crise bancaire s’est transformée en crise budgétaire des comptes publics.
Une crise est aussi un récit que l’on se raconte. Le récit majoritaire explique la crise par une dépense publique inconsidérée qui aurait conduit les États à une situation d’insoutenabilité budgétaire. Selon cette thèse, défendue par l’économie standard, la crise ne pouvait provenir du marché, ce dernier étant nécessairement autorégulateur. Cette croyance a empêché d’anticiper la crise qui se préparait et les États ont été forcés de secourir les banques pour éviter l’écroulement du système bancaire.
Depuis le début des années 2000, les gouvernements et les banques savaient que certains pays de l’Union avaient de graves problèmes de bilan. Pourtant, les gouvernements de l’UE ont favorisé la création d’instruments financiers à haut risque par les banques. Parallèlement, et sur un temps relativement long, la finance et la politique se sont intriquées progressivement et ainsi, au moment de la crise, seuls les fonds publics étaient en mesure de secourir le secteur bancaire et financier. Le sauvetage des institutions financières et bancaires, entrainant une accélération de l’endettement public, s’est traduit par des politiques d’austérité. Les citoyens sur plusieurs générations ont dû payer cette politique par la réduction de la qualité des services publics. Le rôle des banques centrales, à qui l'on a interdit d'acquérir des titres de dette publique, s'est modifié. Ainsi, le trésor italien, à partir de 1981, ne pouvait plus se refinancer auprès de la banque centrale italienne. Ce mouvement a affecté l’ensemble des pays européens. Les banques de second rang ou commerciales ont ainsi commencé à prêter aux États avec des intérêts plus élevés.
En définitive, il semble « que les gouvernements de l’Union européenne ont agi comme des acteurs financiers reconnus, alors que les banques et en particulier la Banque centrale européenne agissaient comme des acteurs politiques de premier plan ».
L’augmentation significative du déficit et de la dette publique entre 2008 et 2010 ne peut être expliquée par un excès de dépense publique dans le secteur de la protection sociale. Il est presque entièrement imputable au sauvetage des banques.
Les banques, malgré les interventions publiques, n’ont pas été assainies. Elles sont sous-capitalisées et affichent des niveaux d’endettement supérieurs à ceux des dettes publiques. Selon le FMI, en 2011, les dettes des banques françaises ont dépassé les 150 % du PIB, celles des banques portugaises, 250 % du PIB, et celles des banques espagnoles, plus de 111 % du PIB. Les banques du fait de la détérioration de leurs situations financières ont alors réduit les crédits aux petites et moyennes entreprises entrainant des fermetures et des faillites. En outre, les interventions massives de la Banque centrale européenne ont retardé l’assainissement nécessaire des banques en leur fournissant des liquidités à bon marché (plus de 3000 milliards d’euros).
Dans l'UE, les autorités de régulation et de vigilance, les ministres du Trésor avec leurs conseillers, les dirigeants bancaires et tous ceux chargés de surveiller le fonctionnement du système bancaire ont été incapables de prévoir la crise et de prendre des mesures préventives. Le système reste très largement opaque et les moyens mis en place, au lendemain de la crise, pour assurer un contrôle suffisant ne sont pas apparus à la hauteur des défis.
Chapitre 7. Coup d’État en Europe. Acteurs et instruments
Les pays de l’Union européenne, pour faire face à la crise, ont engagé des coupes sévères dans la dépense sociale en matière de retraites, aggravé les conditions de travail, et réduit les budgets pour l’éducation, la santé et des services publics de manière générale. Différents experts ont parlé de transition oligarchique dans l’Union européenne ou d’expropriation de la démocratie. D’autres ont parlé de coup d’État de la finance qui aurait imposé aux États un agenda politique. On peut cependant se demander si la finance était capable, seule, d'organiser une telle opération sans l’aide des États.
La notion de coup d’État renvoie à l’appropriation illégitime, par une fraction politique, des pouvoirs fondamentaux souverains de l’État prévus par la Constitution. Une série d’éléments laisse penser que la finance aurait agi de la sorte.
Le premier de ces éléments est lié à l’organisation de l’UE et particulièrement aux dispositifs constitutionnels qui rendent impossible la monétisation des déficits de la part de la Banque centrale – sans compter tous les dispositifs qui contraignent constitutionnellement le budget (règle d’or, encadrement du budget par des autorités de surveillance comme le semestre européen). Ces opérations n’ont pas été réalisées par des individus extérieurs à l’appareil d’État, mais par les gouvernements eux-mêmes. En outre, les banques européennes avaient atteint un niveau d’endettement sans précédent et accordé des crédits en trop grand nombre. Les États et la Banque centrale ont apporté leurs soutiens aux établissements bancaires pour éviter une catastrophe supérieure dans le cas où l’ensemble du système bancaire viendrait à s’effondrer. Les institutions internationales comme la Commission, la Banque centrale et le Fonds monétaire ont renforcé le discours en donnant pour origine à la crise, une dépense sociale jugée excessive.
Par ailleurs, le Traité sur la coopération et la gouvernance en Europe, s’il a été signé par des chefs de gouvernements élus, était d’une telle importance qu’il aurait dû être soumis à une consultation populaire. La démocratie a été plus encore entamée par le Pacte de stabilité et de croissance et ses versions plus contemporaines qui ont supprimé une fonction première du parlement démocratique : le pouvoir de décider des ressources et des dépenses de l’État. Enfin, tout cela a été permis par la collusion entre autorités financières de régulation et l’univers de la finance et de la banque.
En définitive, les gouvernements n’ont en rien subi un diktat de la finance, mais ont largement œuvré en faveur de la finance afin d’établir l’ordre néolibéral. Les gouvernements européens se sont mis au service des intérêts d’une certaine classe en revenant sur les conquêtes sociales acquises après la Seconde Guerre mondiale et en accélérant des processus de privatisation de tout ou partie des services publics.
Il est urgent de faire advenir une nouvelle génération d’élites ou de membres de la fonction publique pour ramener la finance à sa fonction première : apporter les fonds nécessaires au fonctionnement de l’activité économique.
Chapitre 8. Le démantèlement de l’État social
L’État social est l’une des cibles préférées des politiques dites néolibérales. Désormais, pour la plupart des gouvernements européens, les retraites, les indemnités chômage, la santé publique apparaissent comme autant de luxes qu’il faut réduire ou éliminer. En faisant ces choix de politique économique, les gouvernements sont proprement réactionnaires ; autrement dit, ils réagissent contre la progression de la prise en charge collective des risques sociaux.
Les critiques de l'État social sont connues. La plus évidente le présente comme une dépense excessive, particulièrement concernant la santé (en effet, en même temps qu’elle progresse, la médecine coûte plus cher). Les critiques traditionnelles de l’école de Chicago sont également reprises. Selon cette école de pensée, l’État social inciterait l’inactivité (les individus seraient encouragés à profiter de subsides indus) et le financement des retraites pèserait trop lourd sur les actifs. Cependant, les chiffres démentent ces diverses critiques. Avant la crise de 2007, les dépenses sociales restaient stables – autour de 25 % du PIB en moyenne – dans la plupart des pays de l’Union européenne.
Ces attaques à l’égard de l’État social s’inscrivent en réalité dans un projet politique plus large de remarchandisation de nos sociétés, particulièrement de certains biens publics, afin d’engager un processus de redistribution inversé, c’est-à-dire du bas vers le haut.
Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons assisté à une « grande transformation », selon les termes de l’économiste hongrois K. Polany, entendue comme le réencastrement de l’économique dans le social par l’affirmation de l’État social. Ce processus s’est déroulé dans la plupart des pays développés, y compris aux États-Unis avec les programmes Medicare ou Medicaid mis en place dans les années 1960. La contestation de ce modèle à partir des années 1980 a réintroduit la notion de responsabilité individuelle face aux risques sociaux et l’idée de solidarité fut limitée. Parmi les conséquences de ce processus de remarchandisation, il faut compter l’affaiblissement du principe démocratique de participation des populations à la gestion des biens publics. Ces attaques ont généré une déstabilisation accrue des sociétés européennes, une insécurité sociale sans précédent et ont fait naitre un profond ressentiment dans les populations, aggravé par des discours de culpabilisation de ces dernières que l'on accusait d'être responsables de l’accroissement des dettes publiques.
Chapitre 9. La crise comme modèle de gouvernabilité des personnes
La présente crise ouvre un champ plus large, car elle peut être présentée comme une modalité de gestion des conduites humaines. Elle revêt une certaine dimension psychologique qui s’articule avec une anthropologie particulière, celle de l’homo economicus calculateur. Le courant néolibéral voudrait diffuser ce modèle à l’ensemble des activités humaines.
La notion de gouvernabilité de M. Foucault donne un éclairage utile de la situation. Selon ce concept, le gouvernement des conduites humaines passerait, non pas par la coercition, mais par un ensemble de pratiques indirectes qui modèlent l’homme selon un certain modèle afin de le contrôler. Dans cette perspective, la crise peut être vue comme une vaste expérience de contrôle social sur les populations. Ce contrôle, ressemblant à la description de la gouvernabilité foucaldienne, s’observe dans le récit de la crise relayé par les médias, les intellectuels et les politiques pour légitimer leur discours et dans le processus de culpabilisation des personnes qui ont supporté les coûts les plus significatifs.
Les médias ont décrit la crise comme un phénomène inexpliqué, à l’instar d’un désastre naturel. Hormis Madoff et quelques autres, la finance a été très largement épargnée des critiques et l’intervention des gouvernements et des banques centrales en faveur des banques a été présentée comme nécessaire pour le bien commun. À cela s’est ajoutée la culpabilisation des individus, les rendant responsables de dépenses de santé incontrôlées. La crise est donc plus qu’un phénomène économique, mais une modalité de gouvernement.
Troisième partie. À la recherche des politiques anti-crises
Chapitre 10. Rejeter les théories économiques néolibérales
La doctrine néolibérale, tendant à s’appliquer à l’ensemble de la société et refusant la critique, porte en elle un élément totalitaire. Elle a ainsi eu un effet destructeur puissant sur les sociétés occidentales. En effet, la domination du néolibéralisme a produit l’une des crises économiques les plus fortes de l’histoire humaine.
Les théories économiques néoclassiques, desquelles le néolibéralisme a émergé, reposent sur une certaine conception de l’homme : celle d’un homme calculateur qui veut maximiser son utilité et sa satisfaction au maximum. De nombreuses politiques sont issues de la résurgence de ces théories en Angleterre et aux États-Unis à la fin des années 1970 : la libre circulation des capitaux aux États-Unis comme en Europe, la déréglementation de la création et de la circulation d’instruments financiers (à l’instar des produits dérivés structurés), la titrisation sans limites des crédits, la transformation des banques traditionnelles en banques universelles, la croissance démesurée des investisseurs institutionnels (comme les fonds de pension, les fonds d’investissement ou les fonds spéculatifs) et l’affirmation d’un capitalisme en faveur des actionnaires. Ces orientations auront des effets délétères. La globalisation économique et financière promue par la doctrine néolibérale se traduira par des désindustrialisations, des délocalisations, un accroissement des inégalités (conséquence de la redistribution inversée), une forte déconnexion entre l’économie réelle et l’économie financière, et le développement de banques trop importantes, qu’il fallait absolument soutenir.
Le plus préoccupant fut de trouver à gauche des promoteurs inattendus du néolibéralisme. Dans les années 1980 par exemple, la gauche française encouragea la libre circulation des capitaux et, à partir de 1983, reprit très largement à son compte le corpus économique du néolibéralisme inspiré des économistes néoclassiques. Mais, la rencontre véritable entre les deux univers, celui de la gauche et de la pensée néolibérale, fut dans l’affirmation, dans les années 1990, d’une troisième voie par des dirigeants de gauche comme Tony Blair en Angleterre ou G. Schroeder en Allemagne. En somme, le néolibéralisme a pu s’imposer sans rencontrer, de la part de la gauche, une opposition significative. Cette dernière est devenue un instrument au service des classes dominantes, fidèles au principe d’un monde où le pire touche seulement les plus faibles et le meilleur, seulement les plus forts.
Chapitre 11. Créer de l’occupation alors que le travail disparaît
Face au chômage de masse, principal mal qui frappe nos sociétés, il est essentiel de retrouver une situation de plein emploi. Il ne s’agit pas d’appeler naïvement au retour de la croissance, sans avoir auparavant traité la question du système financier, responsable de la contraction de l’activité et de la perte de milliers d’emplois. Il ne faut pas non plus croire que la seule croissance suffirait à faire redémarrer la production. Il faut une demande soutenue et plus rapide que la productivité. Il faut renverser la perspective : le développement ne résultera pas des recettes éprouvées et onéreuses, comme la concession de largesses fiscales aux plus aisés ou les exonérations de cotisations sociales pour réduire le coût de l’emploi. Le développement est créé par l’emploi.
L’idée d’un nouveau « New Deal » pourrait être une solution. Il ne s’agit pas de recréer cette expérience historique, car les temps ne sont plus les mêmes, mais d’en tirer certaines leçons valables pour notre temps. Deux idées peuvent retenir notre attention : imaginer une agence gouvernementale chargée d’atteindre l’objectif du plein emploi et identifier les secteurs dans lesquels il serait préférable de concentrer la main-d’œuvre.
Il faudrait, en outre, faire du plein emploi, le but de l’Union européenne. Une restructuration du système économique et financier apparait alors nécessaire, par une modification des traités européens :
- Intégration et modification des articles 3 et 127 des traités de l’Union européenne, et pas seulement l’article 2 du statut du système européen des banques centrales afin de faire du plein emploi la fin première de l’Union et de ses institutions financières.
- Exiger de la BCE qu’elle impose aux banques, lorsqu’elles s’engagent dans des opérations de crédits, de consentir à des prêts qui engagent une création d’emploi.
- Demander aux États d’émettre un prêt obligataire de l’ordre de 25 milliards pour les principaux pays afin de promouvoir la création d’emplois et de demander à la BCE d’en acquérir une grosse part sur le marché secondaire.
Chapitre 12. Remettre la finance au service de l’économie du réel.
Pour reconstruire une finance au service de l’économie réelle, il conviendrait de démanteler la finance de l’ombre et la pratique du hors bilan pour empêcher quiconque de s’affranchir des règles prudentielles (particulièrement celles issues des accords dits de Bâle qui offrent des garanties de sécurité en cas de crédits ou d’opérations financières sur les marchés par des banques).
En outre, de nouvelles législations doivent être envisagées pour empêcher que les dépôts des épargnants soient utilisés à des fins spéculatives dans des opérations à haut risque, et pour remettre le métier de banquier au service de l’économie réelle et de l’emploi (en retirant l’excitation de l’activité spéculative et financière). Pour y parvenir, il est nécessaire de réduire la taille des grands groupes bancaires. Plus ces derniers grandissent, plus leurs choix sont orientés vers l’activité spéculative, au service des actionnaires. Ils atteignent alors une taille qui rend difficile leur contrôle. Pour œuvrer dans cette direction, il convient de séparer les activités commerciales des activités d’investissement. Les banques chargées des premières s’occuperaient essentiellement de récolter l’épargne et l’octroi de prêts aux entreprises et aux familles, tandis que celles chargées des secondes seraient spécialisées dans les fusions ou dans les grandes entreprises qui voudraient générer de puissants investissements.
Par ailleurs, l’État ne doit pas être le grand absent de cette réforme générale du système financier. Il doit pouvoir emprunter pour l’emploi et la dépense sociale aux mêmes conditions que les banques privées.
*
Vous avez aimé cette synthèse ? Vous adorerez l’ouvrage ! Achetez-le chez un libraire !
Et pour découvrir nos autres synthèses d'ouvrage, cliquez ICI
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

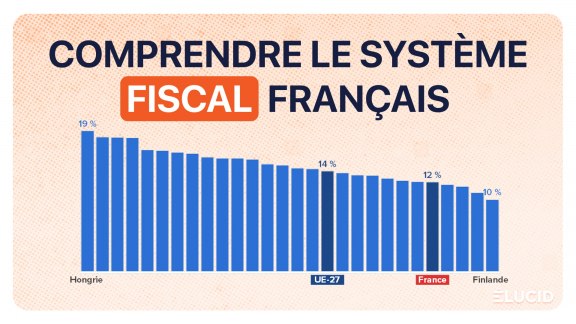






7 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner