Alors que notre monde est de plus en plus prospère et paisible, la colère, le ressentiment et l’insatisfaction grandissent. Pourquoi sommes-nous enclins à préférer la violence ? Comment expliquer que nous refusions d’embrasser la paix dont nous pourrions pourtant jouir aujourd’hui ?

Podcast La synthèse audio
Dans La Haine orpheline (2020), Peggy Sastre tente d’expliquer cette « haine » sans cause. Selon Sastre, nous ne parviendrons à nous libérer de cette colère qu’en saisissant pleinement nos origines. L’évolution, la lutte pour la préservation des gènes, le conflit entre parent et progéniture sont autant de clefs de compréhension que nous offre l’auteur pour prendre du recul sur notre nature profonde et, peut-être, s’en détacher.
Ce qu’il faut retenir :
Un sentiment d’insatisfaction et de colère généralisé semble caractériser notre époque. Loin d’être un évènement propre à la modernité, ce phénomène résulte en réalité d’une tendance ancestrale à la conflictualité. En effet, à l’échelle évolutionnaire, il importe pour chaque espèce de se maintenir dans le temps, et, par voie de conséquence, pour chaque individu au sein d’une espèce, de perpétuer ses propres gènes. Cette loi de l’évolution crée un perpétuel état de compétition génétique entre les membres d’une même espèce, y compris entre les parents et leurs progénitures, qui n’ont qu’une moitié de gènes en commun.
Puisqu’il importe de diffuser ses gènes le plus largement, chez les espèces sexuées comme les humains, il est essentiel d’attirer un partenaire pour la reproduction. Ainsi, la compétition sexuelle prend la forme d’une compétition intrasexuelle, entre hommes pour obtenir une femme, et entre femmes pour obtenir un homme. Les femmes ont leurs propres stratégies, fondamentalement différentes de celles des hommes, pour retenir un partenaire (médisance, beauté, etc.).
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous





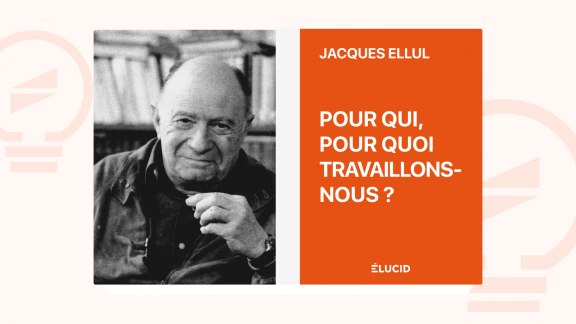


6 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner