La pauvreté dans l’abondance (2002) est un recueil de textes écrits par John Maynard Keynes entre 1925 et 1938.

Podcast La synthèse audio
Les questions abordées sont assez diverses, mais tournent toutes autour de la « nouvelle donne » indispensable au dépassement des problématiques économiques et sociales qui émergèrent à la fin de la Grande Guerre.
Ce qu’il faut retenir :
Le cycle des booms et des crises successives s’explique par les fluctuations de l’investissement et de son rapport avec l’épargne. À l’heure où le système capitaliste montre ses limites et face à la concurrence des modèles autoritaires et socialistes, les hommes politiques libéraux doivent mettre à jour leurs croyances économiques et relever les défis de cette nouvelle phase du développement économique. Le libre-échange, le caractère autorégulateur du système économique et les théories libérales du taux d’intérêt doivent absolument être démis de leur piédestal et confrontés aux faits actuels.
Les pessimistes et les millénaristes qui attendent soit un effondrement de la civilisation industrielle, soit une résolution violente des évènements qui suivirent le premier conflit mondial se trompent. Par les politiques d’investissements publics et de modération des taux d’intérêts à long terme et la relative remise en question des théories libérales, les gouvernements ont l’opportunité de faire accéder l’humanité à un nouveau stade de civilisation, libéré des crises et des imperfections du capitalisme.
Biographie de l’auteur
John Maynard Keynes (1883-1946) est un économiste et un haut fonctionnaire britannique. Issu d’une famille d’universitaires libéraux, il fit ses études au King’s College de l’université de Cambridge. Il s’intéressa d’abord aux mathématiques et aux « sciences morales » avant de se tourner vers l’économie politique. Tout au long de sa carrière, Keynes s’est efforcé de conjuguer la recherche scientifique et la quête d’une doctrine d’action au service du bien commun. Il choisit ainsi de ne pas embrasser une carrière purement académique et se met, en parallèle, au service de l’État britannique.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

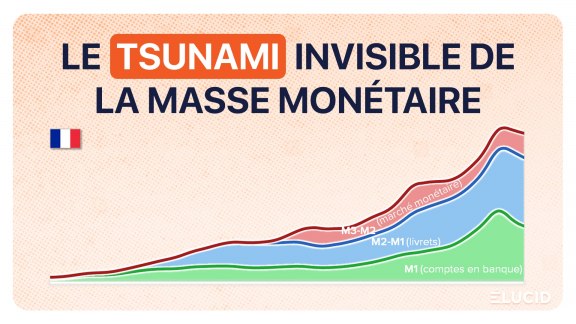
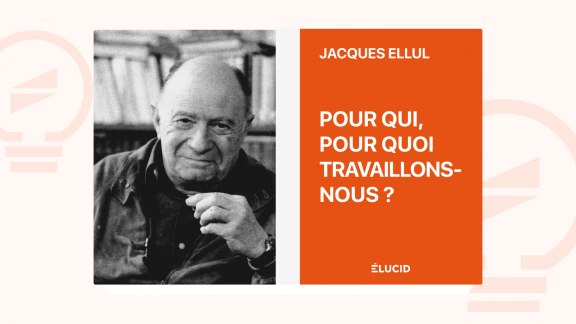





0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner