L’économie de la nature (2019) est la première publication d’un « feuilleton théorique » dans lequel Alain Deneault analyse le sens attribué au terme « économie » à travers l’histoire. Dans cet ouvrage, il explique comment les premiers « économistes » ont dévoyé ce terme pour fonder une science de l’agriculture.
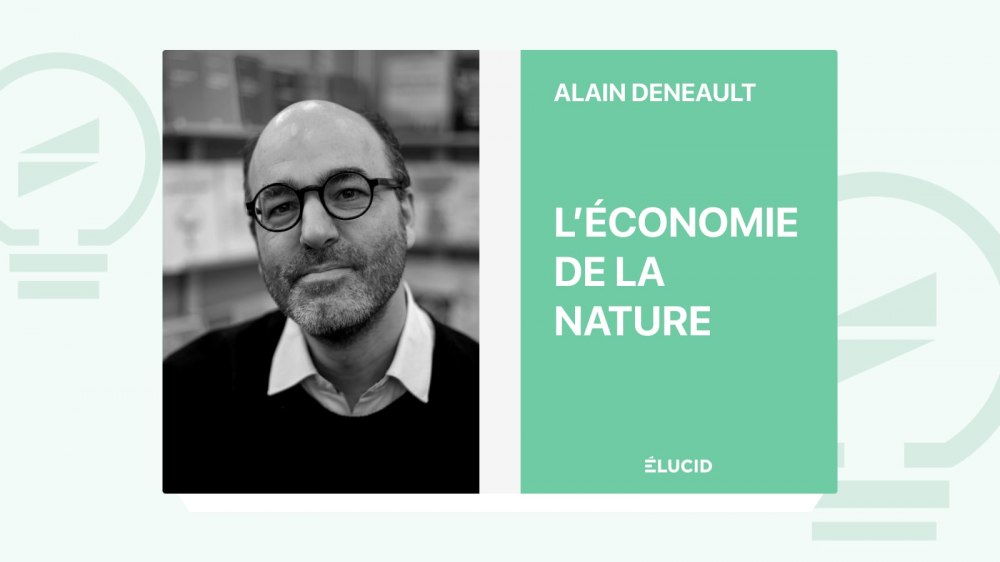
Podcast La synthèse audio
Dépouillée de son lien direct avec l’idée de nature, l’économie de la nature perd son sens et sa raison d’être pour être réduite à une activité d’intendance, un détournement dont nous pâtissons encore aujourd’hui et sans lequel le terme « écologie » n’aurait pas lieu d’être.
Ce qu’il faut retenir :
Le sens actuellement attribué au mot « économie » est un héritage des physiocrates du XVIIIe siècle. Il est antinomique de l’esprit qui a habité cette expression tout au long de l’Histoire. L’économie, jusqu’à cette époque comprise comme « la connaissance des relations bonnes entre éléments, entre gens, entre sèmes, entre choses », a été ainsi réduite à des activités comptables, commerçantes, de gestion et d’intendance.
L’économie, dissociée de la nature, a donné naissance à l’écologie et a fait naître une opposition entre l’Humanité et son environnement. Cette opposition rend impossible une évolution harmonieuse de l’Homme au sein de la nature.
L’attitude des sociétés capitalistes envers leur habitat naturel est la preuve la plus flagrante du dévoiement du terme économie puisque, bien au contraire, elles le traitent de manière dépensière et destructrice, et en aucun cas de façon économe.
Biographie de l’auteur
Alain Deneault, né en 1970, est un philosophe québécois, docteur en philosophie de l’Université Paris VIII et directeur de programme au Collège international de Philosophie à Paris. Auteur de nombreux essais politiques et économiques, il s’est intéressé, au cours de sa carrière, aux questions d’évasion fiscale, au pouvoir des multinationales, à la culture de la gouvernance ou encore au fondement colonial du Canada en développant des concepts comme l’extrême-centre et la médiocratie. Plus récemment, il s’est penché sur la question de l’éparpillement des gauches en une multitude de causes identitaires dans Mœurs. De la gauche cannibale à la droite vandale (2022).
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


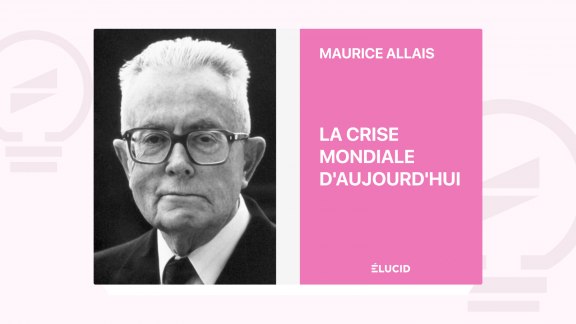
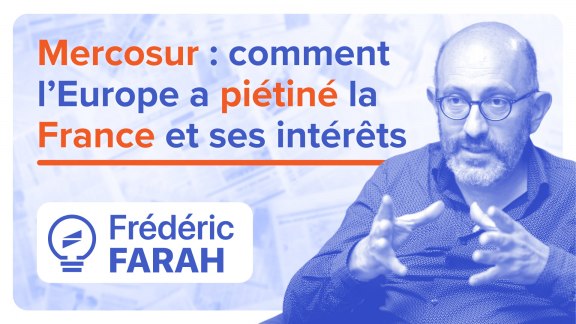
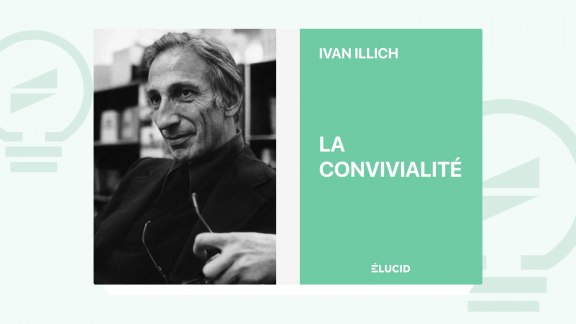
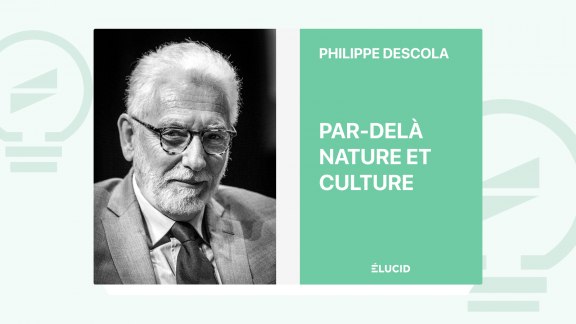

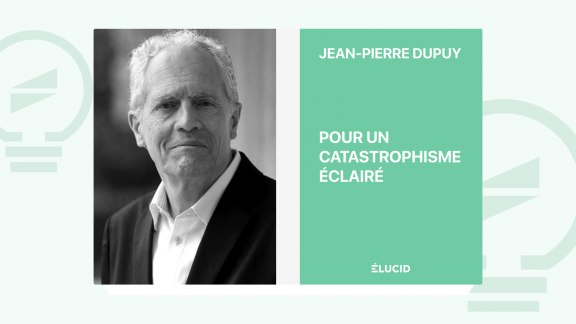
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner