Selon Paul Bairoch, l’économie, une science pourtant jeune, regorge déjà d’idées fausses et de paradoxes. Dans Mythes et paradoxes de l’histoire économique (1999), l’auteur s’efforce de déconstruire ces idées, dans une tentative d’analyse lucide de la discipline.

Podcast La synthèse audio
L’Histoire sert bien souvent d’exemple pour légitimer les politiques économiques. Bairoch remet en question les mythes historiques qui ont justifié ces dernières. Il cible et tranche en plein cœur de la jungle des idées fausses, quelle que soit leur orientation idéologique, s’attaquant au libre-échange, à l’esclavage ou au protectionnisme.
Ce qu’il faut retenir :
L’histoire économique est utile pour remettre dans son contexte les évènements que l’on a pu mythifier et transformer. Il s’agit ici de détruire ces mythes qui voilent la réalité.
Le premier de ces mythes concerne le libéralisme. Si dans certains cas le libéralisme est bénéfique, au regard de l’histoire, cela est loin d’être une évidence. Le Royaume-Uni bénéficia d’une remarquable croissance après son tournant libéral en 1846, mais, il doit cette croissance à l’avance technologique acquise au fil de longs siècles de protectionnisme qui lui permit de dominer ses voisins et le monde.
Veillons également à ne pas confondre les phénomènes historiques récents avec d’autres, plus anciens, comme cela est fréquemment le cas avec l’histoire de la colonisation : la révolution industrielle ne fut pas permise par la colonisation ; les colonies ne servirent pas de débouchés aux Européens ; les pays développés ne furent pas dépendants des importations de matière première et d’énergie du tiers monde avant 1955.
En revanche, les pays du tiers monde sont victimes de mythes persistants : la croissance démographique menace leur croissance économique ; l’urbanisation galopante et l’existence de céréales bon marché détruisent leur productivité agricole ; l’exportation de produits primaires n’est pas une voie vers le sous-développement.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous




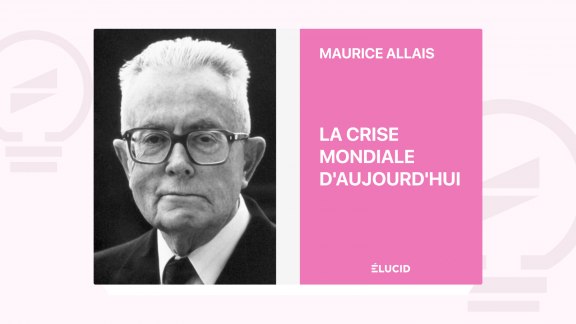
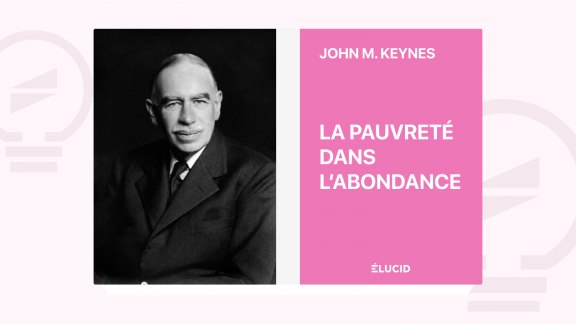
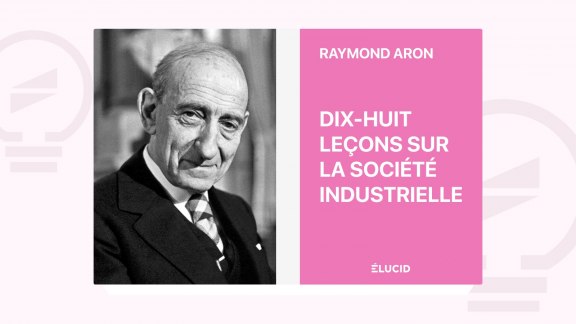
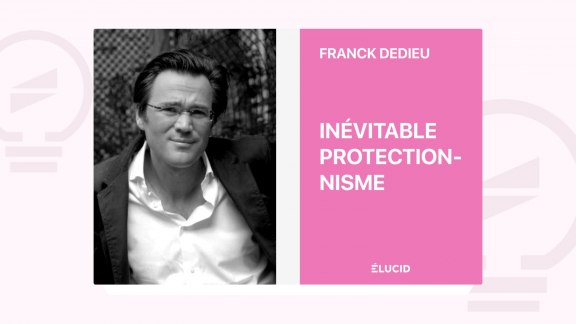
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner