Le mode de production industriel qui s’est installé durablement dans nos sociétés nous promettait la fin de l’esclavage de l’homme par l’homme. Sa promesse a-t-elle été tenue ?

Podcast La synthèse audio
Dans La Convivialité (1973), Ivan Illich, observant les dérives de la croissance, de la surproduction, de la consommation excessive et du règne des experts, considère que l’outil a asservi l’homme plus qu’il ne l’a libéré. Pour atteindre une autonomie véritable, Illich défend l’instauration d’une société post-industrielle fondée sur la « convivialité ».
Ce qu’il faut retenir :
Avec le développement du mode de production industriel, le rapport à l’outil s’est dégradé en dépassant deux seuils de mutation : dans un premier temps, la pratique évolue et se développe une tendance à quantifier son efficacité ; dans un second temps, cette efficacité diminue et l’utilité marginale décroît. Autrement dit, l’outil est devenu contre-productif.
Cette contreproductivité a conduit l’homme à devenir l’esclave de l’outil. Pour arrêter ce mouvement, nous devons inverser notre rapport à l’outil, c’est-à-dire favoriser les outils conviviaux, qui respectent les limites naturelles de la vie et nous permettent de garder le contrôle de l’outil sans dégrader l’autonomie personnelle.
Seule une société conviviale, fondée sur de tels outils, nous permettra de trouver un équilibre dans notre rapport au monde, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’expression de notre créativité ou des autres effets néfastes du mode de production industriel.
Biographie de l’auteur
Ivan Illich (1926-2002) est un philosophe autrichien, précurseur de l’écologie politique et grand critique de la société industrielle. Après avoir étudié la théologie à l’université grégorienne de Rome, il choisit initialement de devenir prêtre, mais finit par entrer en conflit avec l’Église, s’opposant à certaines de ses positions concernant la bombe atomique ou les préservatifs. Il renonce à son sacerdoce en 1969 et publie une série d’ouvrages critiques du fonctionnement des systèmes éducatif et de santé, de l’impérialisme américain et, de manière générale, de la technique et du mode industriel de production.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


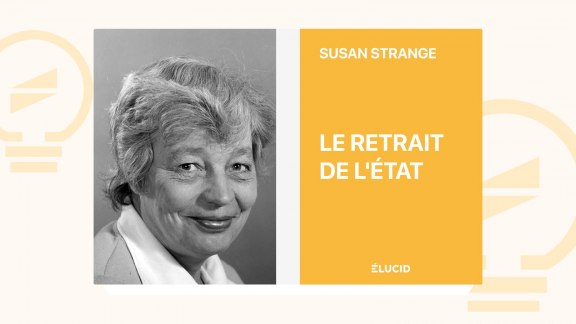
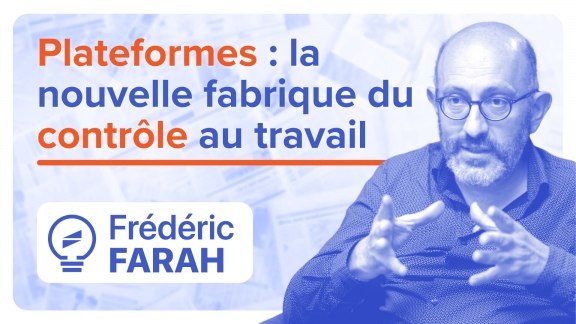
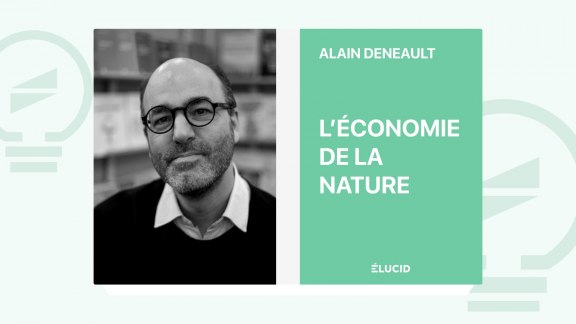
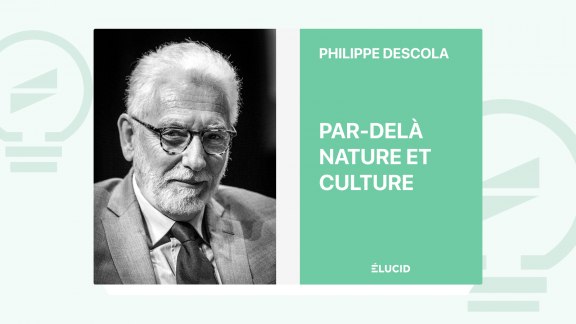

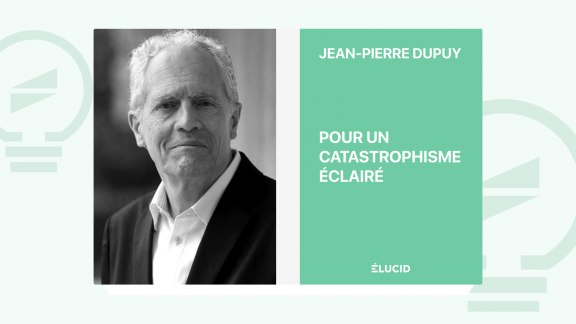
3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner