La chute de Bachar el-Assad, à la suite d’une offensive éclair du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, a pris tout le monde de court. Elle rebat les cartes à la fois dans une Syrie soudainement plongée dans l’incertitude sur son avenir après des années de gel relatif du conflit, et dans un paysage géopolitique plus large où une multitude d’acteurs doivent se repositionner pour appréhender cette nouvelle donne au Levant.

Le dénouement de la guerre civile syrienne a jailli de nulle part. Depuis déjà des années, le conflit syrien ne faisait plus parler de lui. En dehors de quelques bombardements sporadiques des aviations syrienne et russe sur la province d’Idlib, la situation semblait s’être détendue à tel point que le processus de normalisation politique de Bachar el-Assad à travers le monde arabe avançait désormais bon train. Et puis, en à peine quelques jours, tout a basculé.
Cette issue n’avait été anticipée par personne. L’offensive lancée en direction d’Alep le 27 novembre par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, depuis ses bases dans la province d’Idlib, n’a jamais rencontré de résistance significative. À la surprise générale, en quelques jours à peine et presque sans combats, elle parvenait jusqu’à Damas.
La fuite du président syrien, ce dimanche 8 décembre 2024, met fin à plus d’un demi-siècle de domination politique de la famille el-Assad sur la Syrie, et constitue le point final d’une guerre civile dévastatrice qui durait depuis 2011, et qui a entraîné la mort d’un demi-million de Syriens et l’exil de millions d’autres. L’arrivée au pouvoir des djihadistes de HTS marque l’ouverture d’une nouvelle ère pour la Syrie ; reste à voir si elle se soldera par des évolutions positives pour les Syriens.
De fait, si la majeure partie de la communauté internationale s’est réjouie de la chute inopinée d’un régime dictatorial particulièrement violent, cette brève euphorie a rapidement été douchée par une brutale prise de conscience : ceux qui ont renversé Bachar el-Assad risquent fort de constituer des interlocuteurs tout aussi déplaisants et indésirables que lui.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous






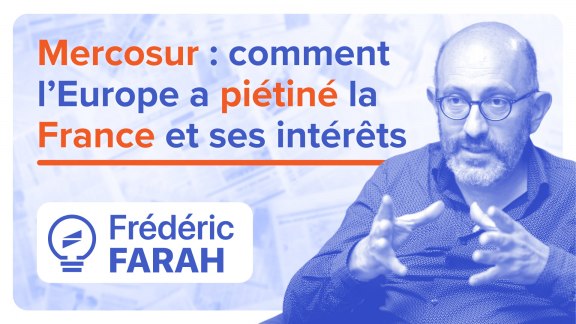

4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner