La « nouvelle » conquête de la Lune, celle de Mars et d’autres élucubrations techno-spatio-solutionnistes dissimulent un juteux business. Philippe Lugherini, ancien membre de la direction du programme Hélios – nom du premier satellite militaire d’observation de la Terre en Europe –, qui fut aussi PDG d’une société d’ingénierie et d’une société spécialisée dans les lasers de haute performance, puis directeur de la stratégie d’ArianeGroup, retrace dans L’Espace des fous (Cépaduès) l’avènement d’une démesure et d’une irrationalité de l'industrie spatiale et plaide pour le retour à un « espace utile ».

Laurent Ottavi (Élucid) : Quelles furent les retombées sur nos sociétés du premier pas sur la Lune ? La célèbre phrase d’Armstrong, dont vous rappelez qu’elle était tronquée par rapport au texte qui lui avait été préparé, s’est-elle vérifiée ?
Philippe Lugherini : Sous le coup d’une émotion compréhensible, Armstrong a en effet « mangé » le « a » de « for a man » qui apposait plus nettement la singularité d’un individu et le destin de l’humanité tout entière : « un petit pas pour un homme (et non pas pour l’homme comme prononcé par Armstrong), mais un pas de géant pour l’humanité ». Il faut revenir au sens originel de cette phrase. En pleine Guerre froide, l’humanité faisait un bond de géant parce que « le camp du bien » c’est-à-dire le peuple américain en marche vers sa destinée manifeste l’emportait sur « l’empire du mal », c’est-à-dire le monde communiste. On peut penser, et c’est mon cas, qu’en remettant ainsi les pendules à l’heure dans l’espace, les Américains ont véritablement stabilisé le monde de la Guerre froide. C’était formidablement important, mais cela n’avait guère à voir avec « l’humanité » dans une acception d’universalité.
Fantastiques au plan géostratégique, les retombées de l’aventure lunaire étaient banales ou inexistantes dans le quotidien, y compris technique, y compris même dans le domaine spatial. Ce qu’on allait plus tard appeler « l’espace utile » n’avait pas attendu la conquête de la Lune. Les satellites de télécommunications, de météorologie, les sondes d’exploration n’avaient rien à voir avec la conquête lunaire et n’ont en pas bénéficié, si ce n’est par l’impulsion de confiance qu’elle a générée.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous






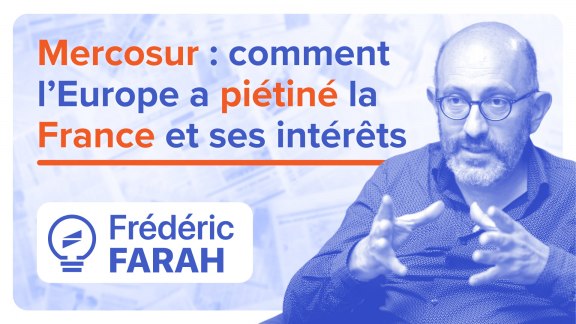

1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner