Article élu d'intérêt général
Les lecteurs d’Élucid ont voté pour rendre cet article gratuit.
Les instances occidentales se veulent garantes d’un « ordre international basé sur des règles ». Un rapide examen des faits invalide cette prétention.



Abonnement Élucid
Si la Russie est sans aucun doute coupable de l'invasion brutale et sanglante de l'Ukraine, il faut cependant convenir que, pour résoudre cette guerre et protéger les populations civiles – premières victimes des guerres dont les intérêts ne les concernent pas – il nous faut comprendre le contexte de son émergence. Et regarder la vérité en face : l'Occident n'a pas su anticiper ce conflit par une diplomatie intelligente ; il a au contraire mis de l'huile sur le feu tout au long des dernières décennies. Si l'on s'évertue à croire que l'ennemi agit sans raison, par un « coup de folie », si l'on se prive de regarder l'Histoire, alors on se condamne à multiplier encore et encore les mêmes erreurs, jusqu'au jour ou nous atteindrons le point de non-retour.
Or, depuis près d’un an, l’irruption de la guerre en Ukraine a été l’occasion d’une impressionnante régression des esprits. L’éclatement en Europe, pour la première fois depuis 1945, d’un conflit de haute intensité impliquant une grande puissance a produit un tel choc qu’il a rendu possible, et même nécessaire, le renoncement à toute idée d’impartialité, de rigueur et de recherche de la vérité quant au déroulement du conflit et à ses causes. Des deux côtés, il a semblé nécessaire de procéder promptement, avec toutes les ressources disponibles, à l’élaboration d’un récit visant à présenter l’adversaire comme l’incarnation du mal, capable de toutes les barbaries.
Du côté russe, la propagande de guerre mise en œuvre par l’État et relayée par des médias pour la plupart aux ordres du pouvoir politique, a fait de l’Ukraine un pays infesté de nazis, envoyant au massacre, avec la complicité de Washington, les Ukrainiens ordinaires devenus chair à canon ; l’idée que ces derniers puissent être mus par un authentique patriotisme, par un sens du sacrifice alimentant une remarquable bravoure au feu ne saurait être évoquée.
Du côté occidental, et alors même qu’ils jouissent d’une liberté qui fait à juste titre notre fierté collective, les médias, dans leur immense majorité, ont gravement mésusé de cette liberté en produisant, en dépit de leur prétendue diversité idéologique, une lecture plate, réductrice et manichéenne du conflit, dont la genèse se trouverait tout entière dans l’esprit détraqué d’un président russe souvent assimilé à un tyran sanguinaire, et dont le caractère sanglant devrait tout à la sauvagerie spontanée de la soldatesque russe.
Si cette manière de voir écrase une réalité autrement plus complexe, si elle produit une analyse indigente en refusant d’analyser les déterminants géostratégiques, historiques et culturels du conflit, elle se montre efficace dans la création d’un consensus guerrier, dans la fabrique de l’ennemi, dans l’affirmation d’une lutte à mener au nom de la morale. Rien de mieux qu’un manichéisme grossier pour accoutumer insensiblement l’opinion publique à l’idée que la guerre est nécessaire, qu’il faut s’y engager pleinement puisqu’elle a pour enjeu, par-delà les peuples et les États impliqués, le triomphe du Bien sur le Mal.
Il n’y a rien d’étonnant à ce que Russes et Ukrainiens, en guerre les uns contre les autres, se rallient sans grande réserve à une telle perception des choses. Il est difficile, en revanche, d’expliquer pourquoi les médias et les gouvernements des pays membres de l’OTAN ont spontanément pris le parti d’appréhender ainsi un conflit auquel ils ne participent pas directement. Si ces pays étaient ouvertement en guerre, le discours visant la Russie, son président et son peuple ne pourrait pas être plus caricatural qu’il ne l’est actuellement. Peut-être faut-il voir dans cette attitude un travers typiquement occidental, américain notamment, qui pose comme préalable à toute action ou à toute considération géopolitique l’idée que les nations occidentales sont l’incarnation d’une pureté morale sans équivalent.
Mais ce réductionnisme moral n’est pas sans danger, tant sa déconnexion avec le réel est grande. Il porte en lui les germes d’une montée aux extrêmes capable d’étendre la guerre et d’en augmenter l’intensité dans des proportions vertigineuses. Si l’essentiel se joue au niveau des principes plus encore qu’à celui des intérêts, si l’ennemi est capable du pire en raison de sa propension atavique au mal, il faut s’y préparer et peut-être même l’empêcher par des actions préventives.
Le potentiel belligène de ce manichéisme doit en conséquence être combattu, et rien n’est plus important à ce sujet que de reprendre contact avec la réalité des aventures états-uniennes et otaniennes (Extension à l'Est, Kosovo, ABM, Irak, Libye, Minsk II), telle que les dernières décennies la donnent à voir, dans ce qu’elle peut avoir de dégradant pour un Occident un peu trop sûr de son excellence morale.
Extension de l’OTAN : entre promesses non tenues et faute stratégique
Dès 1990-1991, au moment de l’effondrement du bloc communiste, la question d’un éventuel élargissement de l’OTAN à l’Est constitue une préoccupation majeure pour les autorités soviétiques. Dans le cadre des intenses négociations diplomatiques d’alors, elles obtiennent à plusieurs reprises de la part de leurs homologues de l’Ouest l’engagement formel qu’il ne saurait en être question. Le Secrétaire d’État américain James Baker évoque par exemple, en février 1990, devant Edouard Chévarnadzé, des garanties « en acier » quant au non-élargissement oriental de l’Alliance atlantique. Si ces engagements ne font l’objet d’aucune convention écrite — ce qui sera reproché ultérieurement à Gorbatchev —, Moscou pense à cette époque avoir été entendu.

Dès 1994, lors d’un sommet organisé en décembre à Budapest, Boris Eltsine, président de la Fédération de Russie, se trouve pourtant contraint d’exprimer publiquement son opposition et sa déception face au projet d’expansion de l’OTAN concocté par l’administration Clinton, dont il a pris connaissance quelques mois auparavant :
« Il s’agit d’une décision dont les conséquences détermineront la configuration européenne pour les années à venir. Elle peut conduire à un glissement vers la détérioration de la confiance entre la Russie et les pays occidentaux. […] Pourquoi semer les graines de la méfiance ? Après tout, nous ne sommes plus des ennemis ; nous sommes tous des partenaires maintenant […] L’Europe, qui ne s’est pas encore libérée de l’héritage de la guerre froide, risque de plonger dans une paix froide. […] Pour la première fois de son histoire, notre continent a une réelle chance de trouver l’unité. Le manquer, c’est oublier les leçons du passé et remettre en question l’avenir lui-même. »
Cette leçon de sagesse historique et cet avertissement se heurtent à une fin de non-recevoir à Washington, où les faucons présents au sein de l’appareil d’État imposent leur volonté. Dès 1999, la Hongrie, la Tchéquie et la Pologne intègrent l’OTAN ; elles sont suivies en 2004 par la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Désormais, l’OTAN est aux portes de la Russie.
On peut comprendre rétrospectivement l’empressement des pays d’Europe centrale à rejoindre l’alliance au sortir d’un XXe siècle qui avait vu leur aliénation complète à l’URSS. Il est en revanche plus difficile de défendre le choix fait par les États-Unis de cette expansion. Il constitue la faute originelle de la séquence historique qui se résout aujourd’hui dans la violence. À l’époque, il reflète d’abord la nécessité pour l’OTAN de s’assurer de son dynamisme et de se trouver une raison d’être dès lors que son ennemi historique a disparu. À défaut de réflexion, la fuite en avant dans l’élargissement constitue pour elle un gage de pérennité.
Pour les États-Unis, l’extension de l’Alliance qu’ils dominent, outre qu’elle constitue une excellente nouvelle pour leur complexe militaro-industriel, a pour intérêt de conforter leur domination géostratégique sur l’Europe, que la fin de la Guerre froide aurait dû ébranler. S’il faut pour cela humilier la Russie, cela n’a guère d’importance, tant ce pays semble à l’époque affaibli par l’effondrement de ses capacités industrielles, militaires et financières, et par l’enlisement de son armée dans les deux guerres en Tchétchénie.
Cette expansion, il faut le noter, se produit en l’absence de toute menace russe pour les pays concernés, alors que rien, dans les déclarations et les actes des dirigeants russes, ne laisse alors penser qu’ils seraient nostalgiques de l’URSS et souhaiteraient restaurer un glacis géostratégique en Europe médiane.
L’avenir montrera à quel point ce choix de l’élargissement à l’Est est désastreux, car il révèle à Moscou que Washington peut, tout en affirmant le contraire, piétiner les intérêts de la Russie lorsque celle-ci est faible. Le successeur de Boris Eltsine saura s’en souvenir.
La sagesse et le discernement auraient dû à l’inverse conduire à la dissolution pure et simple d’une OTAN sans objet, où, de manière plus réaliste, au refus prudent de l’élargissement, au nom du maintien d’une zone tampon, gage durable de sécurité pour les deux parties, en attendant que soit mise sur pieds, sur la base d’une confiance née de la mesure et de la prudence, une architecture de sécurité authentiquement paneuropéenne.
Serbie-Kosovo 1999 : le mensonge et la guerre hors du droit
Au printemps 1999, en réaction aux violences et aux combats qui opposent au Kosovo l’armée serbe et les forces séparatistes de l’UCK, l’OTAN décide une vaste campagne aérienne de bombardement de la Serbie, qui va durer du 23 mars au 19 juin. Pour justifier devant les opinions publiques occidentales la nécessité de cette guerre contre Belgrade, il faut trouver des arguments massue, quitte s’ils n’existent pas, à les inventer. C’est ce que font sans hésitation les autorités allemandes, dont les affirmations sont rapidement reprises en boucle par tous les médias occidentaux, à commencer en France par Le Monde.

Berlin affirme s’être procuré auprès des services d’un pays tiers (on apprendra plus tard qu’il s’agissait de la Bulgarie), les preuves d’une planification méthodique par Belgrade d’une épuration ethnique de grande ampleur destinée à mettre un terme à l’existence d’une majorité albanaise dans la région serbe du Kosovo. Le plan « fer à cheval » qu’affirment détenir les autorités allemandes est censé « démontrer » l’intention génocidaire des Serbes. « Ils ont […] déjà tué entre 100 000 et 500 000 personnes », affirme ainsi avec beaucoup d’assurance le ministre allemand de la Défense le 20 avril.
Il faut dire que le contexte se prêtait à ce genre d’affabulation : dès janvier, l’affaire du « massacre » de Raçak avait commencé à préparer les esprits à l’idée qu’une intervention s’imposait, même si la prudence restait de mise dans la relation des faits. Surtout, les massacres bel et bien commis par les forces serbes en Bosnie quatre ans plus tôt, à Srebrenica notamment, rendaient la perspective de nouveaux massacres tout à fait crédible.
Moins d’un an plus tard cependant, il apparaît que le plan « Fer à cheval » n’existait pas, que Berlin a vendu en connaissance de cause un faux à l’opinion publique. Entre-temps, les infrastructures civiles serbes ont été largement détruites et le Kosovo a été arraché à la Serbie pour former un proto-État dont l’indépendance sera proclamée en 2008, et qui reste aujourd’hui encore un foyer d’instabilité (mafias, trafic de drogues, d'organes et d'êtres humains).
Menée sans l’aval de l’ONU, reposant sur un mensonge et caractérisée par un emballement moral orchestré par les médias et par quelques chancelleries, la guerre de l’OTAN contre la Serbie fait perdre à ce pays son intégrité territoriale après avoir écrasé les moyens militaires de sa souveraineté.
2002 : les États-Unis sortent unilatéralement du traité ABM
Le traité ABM était partie intégrante des accords SALT I de 1972. Il réduisait à presque rien la possibilité pour les Américains et les Soviétiques de développer des missiles antimissiles balistiques, c’est-à-dire des armes susceptibles d’intercepter les missiles à têtes nucléaires multiples et de portée continentale, dont les dirigeants des deux superpuissances pouvaient ordonner le tir à tout moment. En s’offrant ainsi a priori aux coups de l’adversaire, sans possibilité autre que la riposte, Washington et Moscou confortaient le principe d’une dissuasion mutuelle assurée, frein indéniable au recours à l’arme nucléaire.
Or, en 2002, les États-Unis de George W. Bush décident unilatéralement de sortir du traité ABM. Cette décision ne repose pas sur un argumentaire détaillé. Tout au plus est-il question de protéger le territoire américain contre une frappe en provenance d’un « État voyou » ou de « l’axe du Mal » (Corée du Nord, Iran, Irak) pour reprendre les concepts douteux employés à l’époque par les responsables américains. Si l’ascension de la puissance chinoise commence à être observée avec inquiétude, personne ne la mentionne à ce stade, pas davantage que la Russie.
Au début des années 2000, les relations entre Washington et Moscou sont bonnes en effet. Vladimir Poutine, nouvellement élu, a exprimé sa solidarité avec les États-Unis au moment des attentats du 11-septembre. Il a par la suite soutenu l’intervention américaine en Afghanistan. La réaction du Kremlin à la décision américaine est toute de sobriété et de modération. Il en va tout autrement quelques années plus tard, lorsqu’il apparaît que le bouclier antimissile, loin de ne concerner que le territoire étatsunien, a vocation à protéger également les membres européens de l’OTAN, ainsi que l’annonce le sommet de Lisbonne en 2010.
Entreprise dès la fin des années 2000, la mise au point du bouclier dans sa version otanienne est un temps gelée par Barack Obama en 2009, au moment où celui-ci cherche le soutien de Moscou dans la négociation qu’il engage alors avec Téhéran sur le dossier nucléaire. Mais après le sommet de Lisbonne, le système se déploie méthodiquement tout au long des années 2010. Il repose aujourd’hui sur un centre de commandement basé en Allemagne, des navires de guerre lance-missiles américains opérant en Méditerranée, un centre radar d’alerte avancée en Turquie, un site de lancement de missiles en Roumanie et un autre en Pologne.
Si Washington a maintes fois répété que le système était purement défensif, si la Russie n’a jamais été désignée – dans le cas spécifique des missiles balistiques – comme une menace, si même l’OTAN en 2010 a proposé à Moscou de participer au bouclier, jamais le Kremlin n’a pu considérer le déploiement de ce dernier comme autre chose qu’une menace et une provocation à son égard, fragilisant la crédibilité de sa force de frappe nucléaire, et donc sa sécurité. À de nombreuses reprises, les dirigeants russes ont condamné fermement l’activisme otanien et étatsunien, dénonçant dans le bouclier une atteinte inutile au statu quo ante, facteur de déstabilisation rampante de l’ordre stratégique établi.
2003 et les prétendues « armes de destruction massive » de l’Irak
L’affaire est si connue qu’il n’est pas nécessaire de s’y attarder. Le 5 février 2003, à quelques semaines de l’intervention armée des États-Unis et de leurs alliés contre l’Irak, le Secrétaire d’État américain Colin Powell prononce un discours d’une heure destiné à prouver que l’Irak de Saddam Hussein constitue une menace pour le genre humain en raison des « Armes de destructions massives » qu’elle détient ou cherche à se procurer. Le chimique, le biologique, le nucléaire : tous les éléments de la terrifiante triade de la guerre non-conventionnelle sont tour à tour évoqués avec à l’appui moult assertions, photos satellites, extraits de rapports, jusqu’à une fiole d’anthrax brandie en pleine séance pour frapper l’auditoire.

Ce discours constitue le point d’orgue de la plus extravagante tentative de mystification du siècle écoulé, qui n’en a pourtant pas manqué : par son auteur (le gouvernement de la première puissance mondiale) ; par les principes dont celle-ci se revendique (incompatibles a priori avec l’idée même du mensonge) ; par son ampleur et sa visée (convaincre le monde entier de la légitimité de la guerre qui s’annonce contre un pays qui n’a manifesté aucune intention belliqueuse), et surtout, par sa très faible crédibilité. En dehors des États-Unis, en effet, rares sont les opinions publiques convaincues par la thèse des ADM irakiennes, même si personne n’éprouve de sympathie pour le tyran Hussein.
Rares sont les gouvernements convaincus également, bien qu’un nombre important d’entre eux décident de participer à la guerre par soumission zélée à l’impérialisme américain. Seuls les Américains semblent avoir été convaincus, tout comme ils se persuadent que Saddam Hussein aurait une responsabilité dans les attentats du 11 Septembre. Traumatisés par cette attaque infâme et meurtrière, ils sont acquis à l’idée qu’elle doit avoir pour réponse la mobilisation des tous les moyens militaires dont disposent leur pays, comme un gage de réassurance psychologique quant à sa puissance persistante. Aussi se laissent-ils aller, à propos de l’Irak, à une auto-intoxication collective qui emporte la quasi-totalité d’entre eux, intellectuels, journalistes et responsables politiques inclus.
Mais l’ampleur de la mystification est telle qu’elle atteint ses limites : l’Allemagne, la Russie et la France refusent explicitement d’y souscrire et, en conséquence, de participer à la guerre, tout en privant Washington d’une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU autorisant son intervention.
2011 : Libye, un changement de régime par mégarde ?
Au début de l’année 2011, le soulèvement d’une large part de la population libyenne contre le régime de Mouammar Kadhafi menace de tourner au fiasco compte tenu de la puissance de l’armée gouvernementale. Le sort des populations civiles menacées par la répression, à Benghazi notamment, inquiète légitimement l’opinion publique et les chancelleries de nombreux États. La France et la Grande-Bretagne prennent alors la tête d’une offensive diplomatique visant à obtenir l’aval du Conseil de Sécurité de l’ONU pour intervenir militairement en Libye. C’est chose faite le 17 mars 2011, avec le vote de la résolution 1973. Celle-ci autorise l’organisation d’une zone d’exclusion aérienne dans le ciel libyen pour interdire à l’armée de l’air de ce pays toute action de bombardement sur sa propre population. Surtout, elle autorise les États qui le souhaitent « à prendre toutes mesures nécessaires […] pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque ».
Dans les jours qui ont précédé le vote de cette résolution, les diplomates occidentaux, français notamment, ont intensément négocié avec leurs homologues russes dans le but d’obtenir de la Fédération de Russie qu’elle ne s’oppose pas au texte. S’ils parviennent à leur fin — Moscou se contentant de s’abstenir, aux côtés de Berlin et de Pékin —, l’ambassadeur russe au Conseil de Sécurité exprime néanmoins publiquement ses réserves à propos du texte, refusant toute idée d’intervention militaire d’envergure. Les puissances qui s’abstiennent craignent, entre autres, une dérive qui conduirait à faire de la Libye un nouvel Irak.
La suite des événements ne leur donnera pas tort. Alors que la colonne blindée-mécanisée lancée par Tripoli sur Benghazi est stoppée dès le 19 mars par les premières frappes aériennes françaises − sauvant la population de cette ville d’une répression qui promettait d’être sanglante −, l’opération − rapidement prise en charge par l’OTAN −, change insensiblement de nature au cours des jours et des semaines qui suivent. Par glissements successifs, l’objectif de protection des populations civiles finit par déboucher sur l’idée d’un changement de régime par l’action conjointe des forces armées étrangères depuis les airs et des différentes factions rebelles au sol.

Le caractère vague de la résolution en autorise une interprétation très élastique par les forces de l’OTAN, au grand mécontentement de Moscou, qui estime avoir été floué. Cela n’empêche pas le pouvoir russe de se rallier fin mai à l’idée d’un départ nécessaire de Mouammar Kadhafi et de proposer ses bons offices dans l’espoir de l’obtenir : « nous avons besoin de l’aide du président russe », dit alors le président Sarkozy.
Le 20 octobre 2011, le dirigeant libyen est tué par balles après le bombardement de son convoi par un mirage 2000. Pour la population libyenne, débarrassée du tyran qui l’opprimait, les réjouissances sont de courte durée, car elle sombre peu de temps après dans une guerre civile dont elle n’est toujours pas sortie.
Au primat de la stabilité géopolitique défendue par les Russes, Français, Anglais et, dans une moindre mesure, Américains ont préféré les sirènes d’un humanitarisme inconséquent. Si ce dernier a justifié alors leur duplicité diplomatique, il leur faut depuis gérer les conséquences géopolitiques fâcheuses de l’effondrement de l’État libyen, au Sahel comme en Méditerranée.
2015—2022 l’enfumage des Accords de Minsk II
Dernière contribution notable à la décrédibilisation des puissances occidentales, la récente sortie de l’ex-chancelière Angela Merkel à propos des Accords de Minsk II. Signés en 2015 par la Russie et l’Ukraine sous médiation franco-allemande, ces accords n’ont pas eu d’autres buts, affirme-t-elle rétrospectivement, que de donner du temps à l’Ukraine pour lui permettre de développer son armée. Il n’aurait donc jamais été question de les appliquer réellement, alors même qu’ils prévoyaient, en échange d’une large autonomie, le maintien au sein de l’État ukrainien des territoires sécessionnistes du Donbass.
François Hollande s’est empressé de confirmer les propos d’Angela Merkel quelques jours plus tard, s’autorisant même à en tirer une réelle satisfaction. Pour ces deux anciens dirigeants, il semble que la rouerie et la duplicité constituent le summum de l’habileté diplomatique. Soucieux de s’attribuer une part de la magnifique résistance que l’armée ukrainienne oppose à son ennemie, ils ajoutent cependant la bêtise à leur bassesse, puisque leur propos, qui n’est en rien utile à l’Ukraine, a immédiatement été exploité par le pouvoir russe dans sa communication politique, comme une énième illustration des turpitudes de « l’Occident collectif » et de « l’empire du mensonge ».

Volonté de puissance, inculture stratégique, ignorance historique, nullité prospective, indifférence à l’égard des réalités culturelles propres au théâtre d’intervention… À ces tares bien connues des décisions diplomatiques et des interventions militaires des États-Unis et de l’OTAN depuis trente ans, il faut donc ajouter, pour comprendre les conséquences catastrophiques qui en ont presque toujours résulté, un recours fréquent au mensonge, à la tromperie et à la dissimulation. Autant de pratiques condamnables qui, dans les pays concernés, passent pourtant à peu près inaperçues, car elles s’inscrivent dans la certitude ethnocentrique d’une excellence morale dont elle ne constitue qu’un à-côté fâcheux. Face à des adversaires souvent perçus, sur le mode binaire d’un manichéisme puéril, comme l’incarnation du Mal, il faut bien parfois recourir à la ruse pour parvenir à ses fins…
Si la Russie est sans aucun doute coupable de l'invasion brutale et sanglante de l'Ukraine, il faut cependant convenir que la responsabilité dans le déclenchement du conflit est partagée, et que l’OTAN, depuis la faute originelle de l’expansion à l’Est, y a toute sa part, comme l'avaient annoncé George Kennan – le plus grand diplomate américain du XXe siècle – dès 1997, et plus récemment Jack Matlock, tous deux anciens ambassadeurs américains à Moscou.
Photo d'ouverture : Vitalii Vodolazskyi - @Shutterstock
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


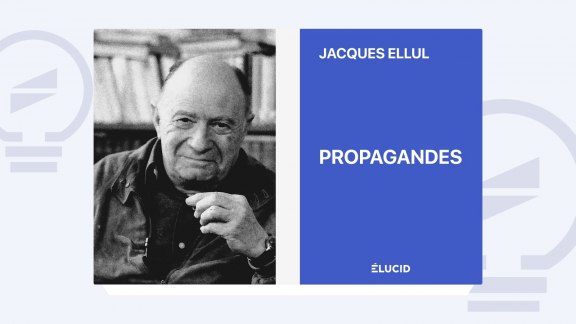





3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner