Les communautés humaines se fragmentent au moment même où la politique, telle qu’elle fut inventée par les Grecs sous l’Antiquité, semble être arrivée au bout d’un cycle. Dans Le Premier XXIe siècle (Flammarion), Jean-Marie Guéhenno, diplomate qui a passé huit ans à la direction des opérations de maintien de la paix de l’ONU, cherche à mesurer ces changements afin de comprendre comment refonder la politique et favoriser les meilleurs aspects de la nouvelle Renaissance en cours.



Abonnement Élucid
Laurent Ottavi (Élucid) : Dans La Fin de la Démocratie, en 1993, vous vous étiez concentré sur les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie. Dans votre nouveau livre, vous vous attardez sur les conditions indispensables aux communautés humaines en général. Pourquoi ce sujet en particulier ?
Jean-Marie Guéhenno : En 1993, la mondialisation commençait, menaçant la capacité des nations à maîtriser leur destin, mais je sous-estimais la menace existentielle qui pèse sur l’idée même de communauté humaine. On s’aperçoit aujourd’hui que les communautés territoriales perdent non seulement le contrôle de leur avenir, mais leur cohésion, concurrencées par les communautés virtuelles, et bousculées par le mouvement des personnes et des idées. Il n’y a pas de communauté humaine, démocratique ou pas, sans valeurs partagées.
Dès 1993, je me méfiais du triomphalisme occidental qui accompagna l’effondrement de l’URSS. Il nous a empêchés de regarder en nous-mêmes. Nous y avons vu la victoire définitive de l’idée démocratique, alors que nous aurions dû nous poser la question des valeurs qui devaient fonder notre société. Trente ans plus tard, nous payons le prix de notre suffisance.
Ayant réduit la démocratie à un processus, ayant négligé d’examiner les liens qui nous permettent de former des communautés humaines, nous nous retrouvons aujourd’hui dans des sociétés en miettes, alors même que nous prétendons à l’exemplarité. C’est cette lacune qu’il me semble urgent de combler et qui fait l’objet de mon livre.
Élucid : « La politique, écrivez-vous, a changé de monde, mais elle ne change plus le monde ». En quoi ce que vous appelez le culte de l’individu a-t-il modifié la politique ?
J-M Guéhenno : On a tout parié sur l’individu, sur sa capacité à changer le monde, et on croit de moins en moins à l’action collective. Les partis politiques, de gauche comme de droite, sont en crise, et l’idée d’un programme laisse la plupart sceptiques. Le résultat est que beaucoup de leaders politiques se contentent aujourd’hui de gérer des symboles et des images, parce qu’ils ont renoncé à peser sur la réalité, et ça leur réussit !
On ne s’identifie qu’à des individus, et plus à des programmes. La personnalisation du pouvoir n’est pas un phénomène nouveau, mais elle est aujourd’hui renforcée par la mort des idéologies qui structuraient le débat politique. La politique a du mal à vivre dans un monde sans utopie.
« L’universalisme désincarné du monde de la globalisation ne satisfait pas. Les individus ont besoin d’un horizon, d’une frontière qui les définisse et les rassure. »
Le triomphe de l’individu a pour conséquence un nihilisme. Génère-t-il un effet contradictoire consistant à se réfugier dans le groupe, pour le meilleur et pour le pire ?
Oui. L’individu est écrasé par son apparent triomphe, et le selfie en est le symbole. Entre le monde et lui, il n’y a plus rien, et il se retrouve seul, sans autre référence que lui-même. Il ne se reconnaît plus dans des valeurs collectives qui pourraient agrandir sa vie en lui donnant un sens qui aille au-delà de sa réussite personnelle. Il en est réduit à perpétuellement se comparer aux autres, parce que la réussite est devenue la mesure de toutes choses.
Cette course poursuite sans fin est épuisante, et devient vite intolérable pour ceux qui n’en sont pas les gagnants. Elle inflige aux perdants la double peine de l’échec et du mépris de soi-même.
La demande de collectif ne cesse de monter, en réaction contre ce nihilisme contemporain qui s’incarne aussi bien dans le consommateur qui affirme « j’achète donc je suis » que dans le terroriste qui lui réplique « je tue donc je suis ». En l’absence de programmes politiques crédibles, la fuite en avant identitaire, dans le nationalisme, dans la religion, peut alors devenir la réponse.
L’universalisme désincarné du monde de la globalisation ne satisfait pas. Les individus ont besoin d’un horizon, d’une frontière qui les définisse et les rassure. Ils rêvent de particulier, et pour cela, ils ont besoin de la chaleur d’un groupe.
Internet a-t-il aggravé les effets dont vous venez de parler ?
Certainement. L’Internet a un impact aussi important que l’invention du livre imprimé. Il bouscule les légitimités traditionnelles, parce qu’il aplatit les hiérarchies. À travers sa page Facebook, son compte Twitter ou Instagram, chacun devient émetteur de contenu, sinon de savoir. Et il a accès à tous les savoirs, tous les contenus du monde. Cela crée en chaque individu un sentiment enivrant et trompeur d’omniscience et d’omnipotence.
À quoi bon élire des représentants quand on s’en pense les égaux ? Chaque individu devient le roi du royaume qu’il se construit. L’Internet n’interdit pas le collectif, mais il en change la nature. À la différence des communautés territoriales, où la proximité impose des rencontres inopinées, et force ainsi le débat, les communautés virtuelles qu’il rend possibles sont des communautés de choix, et comme on aime mieux être avec ceux qui vous ressemblent qu’avec ceux qui vous défient, les communautés virtuelles sont beaucoup plus souvent des communautés d’identité plutôt que des communautés de projet : les opinions tranchées attirent davantage que les nuances du débat.
L’Internet ne favorise pas la création d’un espace partagé, mais fragmente la société en communautés repliées sur elles-mêmes, fermées au débat, et souvent haineuses. L’arrogance de l’individu qui se croit tout-puissant et la polarisation du débat public se renforcent mutuellement.
« Le monde virtuel est devenu suffisamment réel pour interdire que le monde puisse s’organiser sur une base uniquement territoriale. »
En quoi la refondation de la politique que vous appelez de vos vœux dans ce livre oblige-t-elle à se défaire d’habitudes de pensée ?
Il faut commencer par un constat lucide de la situation. Je ne crois pas que la politique telle qu’elle s’est organisée depuis deux siècles, entre gauche et droite, entre grands partis, va revenir. D’abord, parce que la globalisation économique est un phénomène irréversible, et que les nations ne peuvent pas reprendre complètement le contrôle, contrairement à ce que certains dirigeants promettent à leurs peuples.
Ensuite parce que le monde virtuel est devenu suffisamment réel pour interdire que le monde puisse s’organiser sur une base uniquement territoriale. Enfin, parce que la place du savoir dans le fonctionnement de nos sociétés ne cesse de grandir, et qu’elle doit être prise en compte dans le fonctionnement des institutions.
Pour autant, les rapports de pouvoir n’ont pas disparu, et l’image de l’individu-roi est un mensonge. Au contraire, le pouvoir et la richesse se concentrent, mais ils prennent des formes nouvelles. La révolution de l’Internet déplace la richesse et le pouvoir aussi profondément que l’avait fait la révolution industrielle. Les données sont la richesse nouvelle, et l’intelligence artificielle, les nouvelles machines. À qui appartiennent-elles, et qui va les contrôler ?
Comment répondre à cette nouvelle géographie de la puissance ?
Dans un monde où les individus ont besoin d’un ancrage territorial, les nations ne vont pas disparaître ; même en Europe, où la dévastation de deux guerres mondiales a poussé les Européens à aller beaucoup plus loin qu’aucune autre partie du monde dans la construction d’institutions postnationales, on ne croit plus à l’émergence d’une fédération européenne, ni même à une « fédération d’États-nations ».
L’avenir le plus probable est celui d’un enchevêtrement d’institutions à géométrie variable, dont les frontières seront déterminées par la nature de la question à traiter, du plus local au plus global.
Cette prise en compte de la globalité du monde répondrait à une des objections majeures faites à la politique contemporaine, celle de ne pas avoir prise sur des questions qui dépassent le cadre étroit dans lequel elle fonctionne. Mais elle ne suffit pas à refonder la politique, car le monde ne se reconnaît pas dans une communauté universelle, et ceux qui siégeront dans les conseils traitant de questions globales seront nécessairement assez éloignés des débats nationaux auxquels ils ne peuvent être liés que par le lien indirect de leur mode de désignation.
« Le déclin des partis politiques traditionnels, qui pensaient avoir réponse à tout sur un territoire donné, est irréversible. »
Que faut-il d’autre pour refonder la politique ?
Elle doit redonner une place centrale aux légitimités de proximité, mais elle doit bâtir des échelles qui conduisent du particulier à l’universel. Ces échelles ne ressembleront pas au fédéralisme classique, le monde est trop compliqué et trop divers - ce qu’il ne faut pas regretter- pour cela.
Le monde n’est pas une poupée russe dans laquelle des communautés territoriales s’emboîteraient dans des communautés de plus en plus vastes, dont une « fédération » mondiale serait la ligne d’horizon, et le monde virtuel n’obéit pas à une logique territoriale. Le déclin des partis politiques traditionnels, qui pensaient avoir réponse à tout sur un territoire donné, est donc irréversible.
Le décalage entre l’horizon de nos émotions, qui reste nécessairement limité, et l’horizon de nos intérêts, de plus en plus vaste dans un monde connecté, a besoin de l’aide du savoir pour être surmonté, et la refondation de la politique devra donc faire sa place à la légitimité du savoir, incarnée dans des autorités indépendantes. Mais celles-ci ne devraient pas se substituer à la politique, mais la compléter : au savoir d’évaluer le risque ; à l’autorité politique de déterminer le risque qu’une communauté particulière est prête à prendre.
À cet égard, l’écologie, parce qu’elle touche à toutes les dimensions de notre rapport au monde, pourrait contribuer à la refondation de la politique, à condition que les écologistes ne soient pas les apôtres du zéro-risque - ce qui est la négation de l’idée de société, mais fassent du degré de risque, et donc de solidarité, que les sociétés sont prêtes à accepter, le cœur du débat politique.
« La transition vers des institutions politiques encore à inventer est une période dangereuse, et j’ai peur que la capacité de contrôle soit un jour mise au service des passions collectives par des puissances qui y verraient la réponse à leur besoin de cohésion, et que cela débouche sur une violence sans précédent. »
Vous parlez dans votre livre de Seconde Renaissance pour souligner à la fois les aspects positifs et négatifs du moment actuel, sauf qu’il existe aujourd’hui des moyens de surveillance et des armes de destruction massive sans commune mesure avec le passé. Cela signifie-t-il que nous n’avons aucun droit à l’erreur ?
On se souvient de la première Renaissance pour ses artistes, pour son merveilleux bouillonnement intellectuel. Mais la Renaissance fut aussi l’époque des guerres de religion et de violences inouïes. L’humanité a tâtonné pendant quelques siècles pour reconstruire les fondations des institutions politiques dont l’invention du livre avait ébranlé la légitimité. Nous sommes dans une situation comparable, mais, comme vous le dites, avec des moyens de contrôle et de destruction qui n’ont pas de précédent dans l’histoire des sociétés humaines.
Les techno-optimistes font confiance aux algorithmes pour nous éviter les bêtises d’une intelligence humaine nécessairement limitée. Je suis moins confiant, la transition vers des institutions politiques encore à inventer est une période dangereuse, et j’ai peur que la capacité de contrôle soit un jour mise au service des passions collectives par des puissances qui y verraient la réponse à leur besoin de cohésion, et que cela débouche sur une violence sans précédent.
Pensez-vous ici à une confrontation entre la Chine et l’Occident ? Vous évoquez pourtant une « tentation chinoise » de ce dernier ?
Je parle de « tentation chinoise » parce que je crois que nos sociétés démocratiques en crise, fatiguées par un émiettement et une polarisation qui les rend de plus en plus dysfonctionnelles, rêvent d’une harmonie orientale, d’une tranquillité que rien ne viendrait déranger : la montée de ce qu’on appelle le « politiquement correct » en est un indice.
Il y a donc la possibilité d’une convergence paradoxale entre les GAFAM d’Occident et le Parti communiste chinois. Cette convergence éviterait les conflits, mais elle signifierait la mort de l’esprit de contestation qui a fait le dynamisme de la tradition occidentale depuis deux mille ans. En même temps, la pente naturelle de tout régime qui se sent fragile est d’attiser le nationalisme en se trouvant des ennemis. Là aussi il peut y avoir convergence entre la Chine et l’Occident, mais pour aller au conflit.
Vous insistez sur l’enjeu de l’éducation en conclusion de votre livre, mais pas au sens où on l’entend en général. Qu’entendez-vous exactement ?
L’extraordinaire expansion du savoir et des technologies nous révèle chaque jour davantage notre ignorance : la multiplication des savoirs spécialisés a pour conséquence que même les objets les plus familiers sont incompréhensibles à la majeure partie d’entre nous. L’éducation court derrière cette expansion pour nous préparer à des vies professionnelles qui nous enfermeront dans une spécialité.
L’humiliation quotidienne de ne pas comprendre et la prétention à tout maîtriser par la technique nous font osciller entre une révérence religieuse pour la technique et l’arrogance des demi-savants. Une autre éducation est possible, qui nous apprendrait à avoir une autre relation avec le savoir, celle des vrais savants. Au lieu de chercher dans le savoir des certitudes qui ferment le débat, nous devons y chercher de nouvelles questions. Le savoir est une sphère en expansion continue, ce qui signifie que plus il grandit, plus les frontières avec l’inconnu augmentent.
À l’école, à côté des disciplines scientifiques qui nous apportent des réponses provisoires, nous devons apprendre à poser des questions toujours nouvelles. L’école ne doit pas être seulement l’instrument de sélection d’une société méritocratique où les plus savants seront les plus puissants. Elle doit nous apprendre l’inachèvement de tout savoir, et donc aussi l’humilité. C’est ce caractère problématique de la connaissance qui fonde la liberté humaine, et rend possible une société pluraliste.
Propos recueillis par Laurent Ottavi
Photo d'ouverture : Affiches déchirées d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon, Paris, 26 mars 2017 - Laurentlesax - @Shutterstock
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

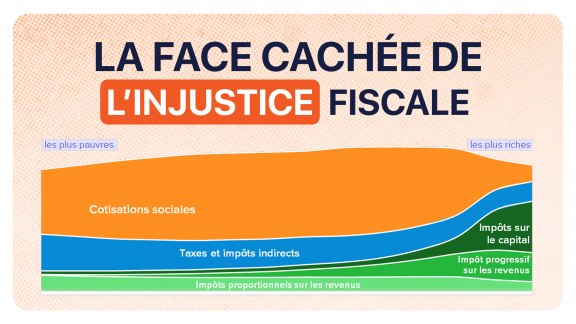






1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner