Pour l'ancien ambassadeur français, la disparition d'une réelle politique étrangère est l’un des grands drames de l’Histoire récente de notre pays. Dans cet entretien exclusif réalisé par Olivier Berruyer en 2015, Gabriel Robin analyse l'évolution de la politique extérieure française, dénonce l'absence totale de pensée stratégique et de politique d'indépendance, et revient sur les grandes erreurs de la construction européenne.

Né en 1929 et décédé en 2022, Gabriel Robin est un ancien ambassadeur français. Il étudie à l’ENA et à l’École normale supérieure avant d’entamer une remarquable carrière dans l’administration française, s’occupant principalement de politique étrangère. Il occupe les postes de Détaché à la représentation permanente auprès des Communautés européennes à Bruxelles (1961-1969), Conseiller diplomatique de Georges Pompidou (1973-1974) puis de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1979), ou encore Ambassadeur auprès de l’OTAN (1987-1993).
Olivier Berruyer : M. Robin, fort de votre expérience en matière diplomatique, comment jugez-vous l’évolution de la politique extérieure de la France depuis 1958 ?
Gabriel Robin : En matière de politique étrangère, nous sommes passés de tout... à rien. Sous Valéry Giscard d’Estaing, notre politique était ambiguë, mais avait le mérite d’exister. Aujourd’hui, elle est réduite à néant ; il n’en reste qu’une diplomatie de façade. Définir la politique étrangère de François Mitterrand ou de Jacques Chirac est impossible puisqu’il n’y a plus de pensée. L’obsession européenne qui caractérisait les deux mandats n’en a pas fait une politique ; ce n’est qu’un tropisme. Or, auparavant, il était possible de définir une politique globale, par laquelle la France existait sur la scène internationale.
Selon moi, l’effacement de la politique étrangère, alors qu’elle aurait tout pour se manifester, est l’un des drames de l’Histoire récente. Il a suffi que le monde devienne enfin comme l’aurait voulu le Général de Gaulle, pour que l’on cesse d’adhérer à ses principes à ses orientations. Le monde est désormais à la fois fait d’États-nations et globalisé. Autrement dit, nous pouvons être en même temps une nation, et universels. Mais, nous sommes effrayés par ce monde. Nous nous abritons ainsi derrière les parapets européens, atlantiques et occidentaux ; nous ne songeons qu’à nous mettre à l’abri ou à rêver de refaire le monde, en nous appuyant sur la force des Américains.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous






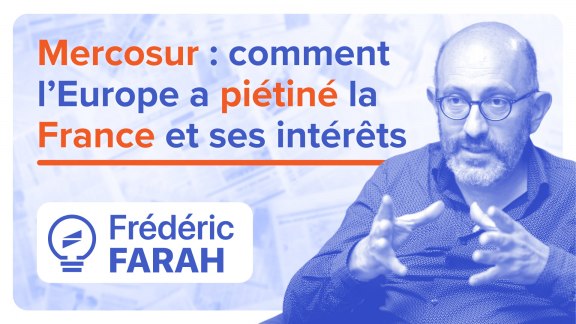

1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner