Tocqueville, dans des pages célèbres de La Démocratie en Amérique, caractérisait pareils régimes par la passion de l’égalité. La France, enfant des Lumières et de la Révolution, a inscrit dans sa devise cette valeur. Le modèle républicain élaboré sur plus d’un siècle et demi voulait faire du mérite et de l’effort, les voies de l’ascension sociale et rêvait d’une classe moyenne qui déjouerait aussi bien les conservatismes que le socialisme révolutionnaire. Pourtant, depuis la fin du XXe siècle et ce début de XXIe, c’est une tout autre société qui se dessine. En France, sous l’effet de choix fiscaux et de modifications de rapports de force entre le travail et le capital, ce sont à nouveau la rente et les héritages qui l’emportent. Voilà la mutation préoccupante à laquelle on assiste. La promesse républicaine de mérite et de mobilité est plus que jamais bafouée. Ce n’est rien de moins que l’idéal démocratique qui est en péril.

Dans la pièce célèbre de Shakespeare « Hamlet », un personnage, Marcellus, s’écrie « il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark ». Cette interpellation n’a pas perdu de son acuité à l’heure du capitalisme financiarisé et de la modernité tardive. Quelque chose se nécrose et affecte plus que jamais la cohésion sociale de notre pays.
Pour commencer, et comme le disait le regretté Michel Aglietta, le capitalisme est devenu rentier. C’est un oxymore en soi, car le capitalisme fondé sur la prise de risque, la recherche du profit se donne désormais comme objectif d’extraire de la rente. En somme le capitalisme s’est construit contre la rente. Dans des pages restées lumineuses, le plus important représentant et fondateur de l'école de la régulation indiquait une série de rentes à l’œuvre dans l’économie contemporaine : rente des GAFAM, rente des grandes métropoles, rente des marchés financiers.
Cette situation ne peut que jouer contre l’innovation et se traduit par la concentration de richesses qui résiste à la redistribution. Les géants de la Tech américains ont compris que le meilleur investissement possible à faire était dans le pouvoir politique, car lui seul pouvait garantir la rente dans le futur. L’État devenait plus que jamais le gardien de rentes acquises. C’est ce que le politiste et historien américain J. Winters nommait une « politique de défense de la richesse ». Pour lui, la mobilisation des institutions au service de la richesse assurait davantage la pérennité des positions dominantes qu’une répression par la force du plus grand nombre.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous





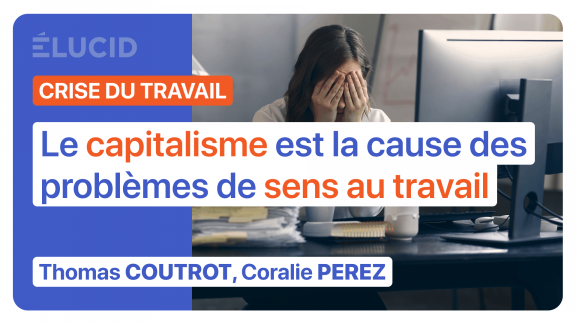

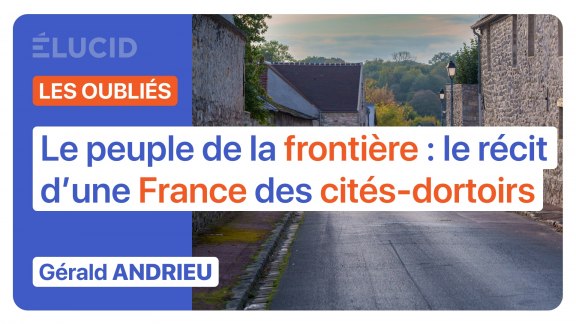
4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner