Le débat public est aujourd'hui pollué par un soi-disant doute sur le rapport des Français au travail. Nous serions atteints d'une « épidémie de flemme » pour certains, de « quiet quitting » pour d'autres (moins j'en fais, mieux je me porte), ou bien nous serions tout simplement paresseux et fainéants... Toutes ces affirmations péremptoires sont évidemment trop floues et trompeuses pour expliquer quoi que ce soit.

Pratiques pour culpabiliser les individus, les accusations de « fainéantise » font partie de l’arsenal idéologique servant à justifier des réformes socio-économiques brutales et dispensables ; celles des retraites ou de l’assurance chômage n’échappent pas à cette règle.
Dans les faits, les enquêtes se suivent, se ressemblent et sont formelles. Les Français restent très attachés au travail : 8 de nos compatriotes sur 10 déclarent ainsi que le travail occupe une place importante dans leur vie, et que le fait d'avoir une activité professionnelle est bon pour la santé mentale. Ces chiffres traduisent les attentes élevées des Français envers leur travail… en décalage profond avec la dégradation continue des conditions de son exercice.
Ce constat n’est pas nouveau, de nombreuses études menées depuis trente ans le confirment. Celles de la DARES, organisme public chargé « d’éclairer les politiques sur le travail auprès du Ministère », pointent régulièrement des conditions de travail particulièrement dégradées en France.
La comparaison avec nos voisins européens n’est pas à notre avantage ; l'hexagone est tout sauf un exemple sur la grande majorité des critères et se situe sous la moyenne européenne. La France est l'un des champions de la souffrance au travail.
Avec sa récente loi sur les retraites passée au forceps, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs en enjambant un débat préalable sur le travail. Il a brandi une fausse urgence en occultant celle, bien réelle, d'améliorer les conditions de travail des Français.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


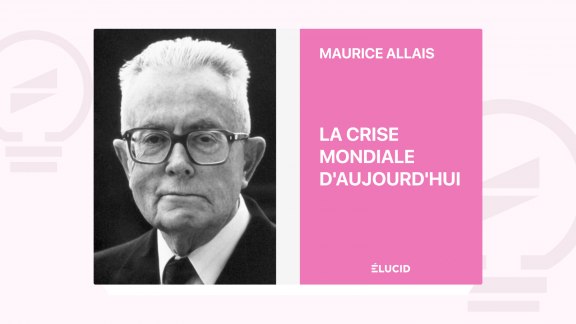
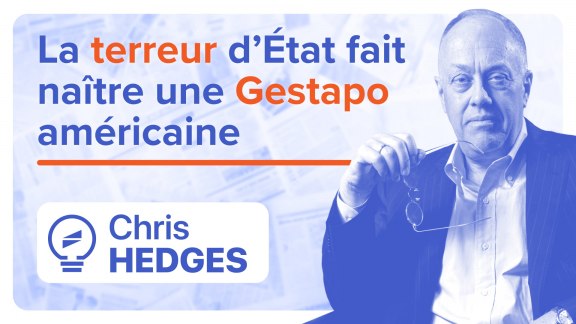




0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner