Rony Brauman et Eyal Sivan rédigent Éloge de la Désobéissance. À propos d’un « spécialiste » : Adolph Eichmann (1999) peu après avoir monté le film Le Spécialiste, premier film documentaire qui exploita les archives du procès du lieutenant-colonel Adolf Eichmann, jugé pour son rôle central dans l’organisation logistique des expulsions et des déportations de millions d’individus entre 1938 et 1944.

Podcast La synthèse audio
En s’inspirant de la réflexion d’Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem, ainsi que des archives vidéo du procès d’Eichmann, les auteurs proposent ici une analyse des différents comportements d’obéissance pendant la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration à la soumission. Ils portent leur attention aussi bien sur des fonctionnaires nazis que sur des victimes juives.
Cet ouvrage dresse ainsi le portrait-robot d’un comportement humain criant d’actualité qui ne peut qu’engager le lecteur à la prudence.
Ce qu’il faut retenir :
Le cas Eichmann pose un problème éthique important : quelle est la responsabilité de l’individu qui obéit aveuglément, mais sincèrement, aux ordres d’une autorité légitime ? Si la majorité reste passive face à l’autorité, l’individu qui agit de cette sorte n’est pas moins coupable de ne pas avoir réfléchi aux répercussions de son activité.
Le procès d’Eichmann met en outre en exergue un problème propre à la société israélienne : il a été instrumentalisé pour répondre à une fonction de consolidation d’une société divisée entre ashkénazes et séfarades grâce à l’élaboration d’une identité juive liant histoire glorieuse du peuple juif, et rhétorique du juif martyr.
Le crime administratif, ou crime « par excès de zèle » est l’un des plus dangereux. Il repose sur des « professionnels » qui ont à cœur de bien faire leur travail, mais ne perçoivent pas les répercussions et les enjeux de leur activité. Par l’exercice de leur emploi (souvent des administrateurs), ils coopèrent à l’application de mesures criminelles.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
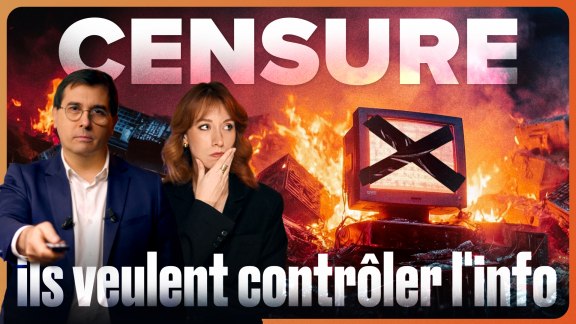



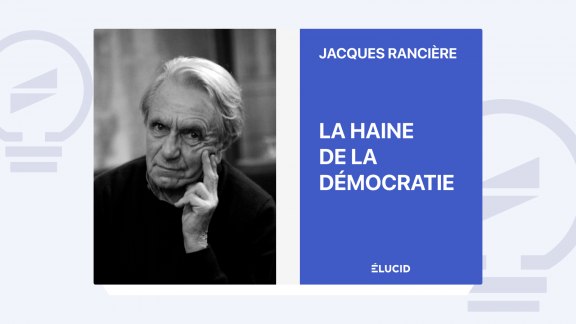
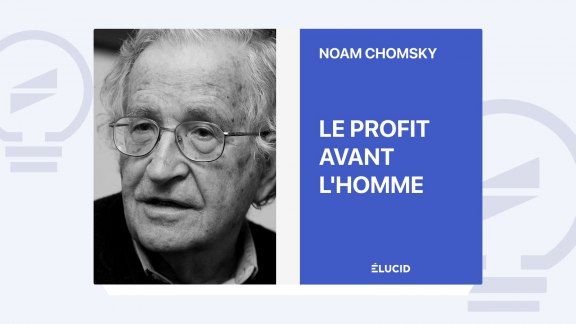
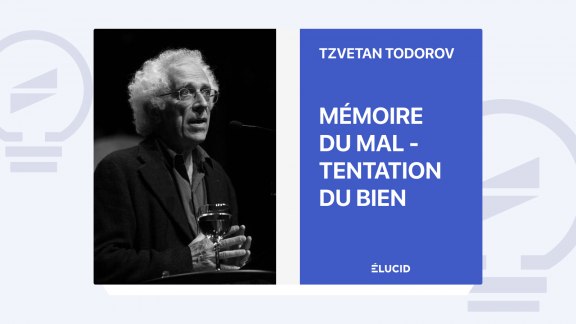
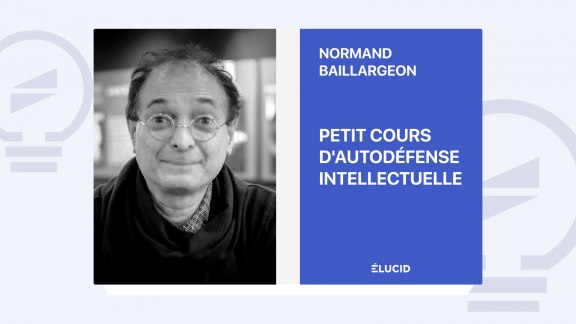
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner