Quel besoin impérieux pousse notre vieux continent à se saisir des mots anglais pour décrire une réalité ancienne parfaitement analysée par les plus prestigieux de ses historiens européens ? C’est comme s’il fallait que les recherches continentales du dernier siècle traversent l’Atlantique pour qu’à leur retour en Europe, « ripolinées » par le lexique américain, nous puissions nous y intéresser.



Abonnement Élucid
« La fausse nouvelle est le miroir où la “conscience collective” contemple ses propres traits. » (1)
Des Troubles de la personnalité multiple, décrits par Pierre Janet, par exemple, à l’analyse des micro-pouvoirs par Michel Foucault, en passant par les fake news, les faits sont têtus : bien des concepts importés de la culture états-unienne ont été made in Europe. C’est ainsi que les fake news ont éclipsé les « fausses nouvelles » (2) analysées par un des plus grands historiens français du XXe siècle, Marc Bloch.
Il faut dire qu’en matière de « faits alternatifs », les partisans de Donald Trump n’y sont pas allés de « main morte », c’est le mensonge et la fausse nouvelle au format industriel. Qu’on en juge sur pièces. La palme de cette capacité à redoubler la réalité des faits d’une construction factice, invitant les masses à adhérer à une « post-vérité », revient incontestablement à Kellyane Conway, la conseillère à la Maison-Blanche de Donald Trump. Interrogée sur la chaîne NBC sur la cérémonie d’investiture de Donald Trump comme président, elle avait tenté de justifier les propos de Sean Spicer, la porte-parole de Donald Trump, laquelle avait affirmé que cette « cérémonie d’investiture fut la plus grande en termes d’audience », alors que les photos de l’évènement montraient le contraire.
La veille, d’ailleurs, Trump avait lui aussi affirmé que la pluie avait cessé de tomber dès qu’il avait commencé son discours d’inauguration et que le soleil était apparu. Ce qui s’est avéré totalement faux selon les journalistes présents. C’est à ce propos que Sean Spicer, vent debout contre les médias, avait revendiqué le droit à des faits alternatifs. Tout en accusant les journalistes de faire partie des êtres humains les plus malhonnêtes de la planète. La même Kellyane Corway n’est-elle pas allée jusqu’à inventer de toutes pièces un massacre au Kentucky pour justifier l’interdiction faite aux ressortissants de sept pays musulmans d’entrer aux États-Unis ?
L’emprise sur les opinions publiques passe par le truchement de ces réalités alternatives dont le foisonnement semble n’avoir jamais été aussi grand qu’aujourd’hui. C’est précisément en ce point que les « réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre » se révèlent lumineuses. Ce serait une bien étrange erreur politique de ne considérer les fausses nouvelles que comme des erreurs ou des impostures liées à des personnes.
D’une part, les fausses nouvelles sont entendues d’une partie de la population, là où elles sont attendues. Ce sont des illusions fabriquées par des spécialistes des relations publiques en politique qui fournissent les « légendes » espérées par les auditeurs de leur camp. D’autre part, la valeur d’un message dépend, dans notre société, de l’effet qu’il produit, la logique d’audimat chère à Pierre Bourdieu, et de ce fait les fake news, ont plus d’impact que les informations vérifiées. L’information est un miroir des valeurs sociales. Pour accroître son taux d’audience, les fake news sont une valeur plus sûre que la vérité.
Marc Bloch nous montre que pour qu’une légende, une fausse nouvelle naisse, se propage et s’amplifie, il est nécessaire qu’une première condition soit remplie : « trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable. En elle, inconsciemment, les hommes expriment leurs préjugés, leurs haines, leurs craintes, toutes leurs émotions fortes. Seuls […] de grands états d’âme collectifs ont le pouvoir de transformer une mauvaise perception en une légende » (3). Il s’agit de « psychose collective » – le terme est employé par Marc Bloch – produisant des « légendes », comparables aux délires et hallucinations, dans lesquels des perceptions sont mal interprétées.
Marc Bloch donne l’exemple de cette perception juste, mais inexactement interprétée : celle des ouvertures étroites, fermées au moyen de plaques mobiles en métal qui se trouvent sur la façade de certaines maisons en Belgique. Ce sont des trous destinés à fixer les échafaudages des peintres de façade ou d’autres ouvriers. Cette habitude de construction est étrangère à l’Allemagne. Durant la guerre de 1914, le soldat allemand remarque ces ouvertures ; il n’en comprend pas la raison, il cherche une explication. Comme il est dans un état d’esprit où traînent chez lui de vieux souvenirs conscients ou inconscients de paroles et de lectures sur la méchanceté de l’ennemi, il est prompt à l’interpréter comme une préparation hostile à son égard, un geste de guérilla.
Il se souvient, se rappelle que les Belges sont prompts à la trahison, à l’empoisonnement des occupants, à la mutilation des blessés et s’empressent de haïr le peuple allemand. À partir de quoi, ces « yeux mystérieux » qui percent les façades et l’épient deviennent les signes d’un danger mortel. De ce fait, une innocente particularité architecturale devient un geste d’hostilité que le soldat punit en fusillant ses habitants, en les pillant et en les violant. De tels actes odieux donnent une consistance à son erreur d’interprétation, nourrissent une légende à partir de laquelle le soldat ne saurait renoncer qu’en s’avouant criminel.
Ce type de « fausses nouvelles », qui se propagent ensuite – les Belges ouvrent des meurtrières dans leurs maisons pour tuer les soldats allemands – deviennent indestructibles, car elles ont justifié des actions cruelles, atroces, irrationnelles. Ensuite, elles se sont propagées du front vers l’arrière, de l’armée vers l’opinion et ne peuvent plus être facilement démenties. Toutes les armées du monde procèdent malheureusement de la sorte, aujourd’hui comme hier. L’actualité en regorge.
Marc Bloch, avec cette finesse qui caractérise ses analyses, nous offre un exemple du rôle du langage dans la manière dont une croyance peut devenir un dogme. Pendant les mois d’août et septembre 1914, l’opinion publique cherchait des causes extraordinaires aux premières défaites de l’armée française. La voix populaire considérait que ces échecs militaires ne pouvaient être imputés qu’à des trahisons. C’est-à-dire que les gens guettaient les signes et les signaux susceptibles d’alimenter cette thèse de la présence parmi la population française de traitres allemands sournoisement installés parmi les citoyens.
Un élément fortuit fut à l’origine d’une fausse nouvelle. Les soldats français ayant reçu la mission de capturer un Allemand pour obtenir des renseignements s’emparèrent d’une sentinelle ennemie qu’ils ramenèrent dans leurs lignes pour l’interroger. Il s’avéra que cette sentinelle d’un âge déjà avancé, civil bourgeois installé dans la vieille ville de Brême, donna les renseignements souhaités et fût rapidement relâchée. Les choses auraient pu en rester là si les malices du langage ne s’en étaient mêlées et n’avaient amené certains auditeurs de l’interrogatoire à confondre Brême et Braisne, village situé à quelques kilomètres de là où ils se trouvaient.
Ces ignorants de la géographie, insensibles à l’exactitude des sons prononcés, ont favorisé, malgré eux, une légende. Le soldat capturé devint dans la légende, rapidement propagée, un marchand qui avait tenu boutique à Braisne, en France, et qui réapparaissait tout à coup sous les habits d’un troupier allemand. Preuve vivante que les Allemands avaient, depuis des années, essaimé des espions sur le territoire français pour préparer la guerre, qu’ils étaient capables de toutes les ruses. Et ainsi se vérifiait que les premières défaites n’étaient pas dues aux erreurs des militaires français, mais à l’espionnage allemand.
Je laisserai le dernier mot à Marc Bloch lorsqu’il écrit qu’une fausse nouvelle « nait toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance ; elle n’est fortuite qu’en apparence, ou, plus précisément, tout ce qu’il y a de fortuit en elle c’est l’incident initial, absolument quelconque, qui déclenche le travail des imaginations ; mais cette mise en branle n’a lieu que parce que les imaginations sont déjà préparées et fermentent sourdement » (4).
Les exagérations et les fake news du camp trumpiste ne sont pas une erreur de l’histoire, une grossière bavure de la civilisation américaine, un mensonge politique incarné par un répugnant affairiste, mais le symptôme des représentations collectives nourries à la sève des agitations fascistes du siècle dernier qui, aujourd’hui, font retour. Mais c’est une autre histoire...
Notes
(1) Marc Bloch, 1921, Réflexion d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, Paris, édition Allia, 2019, page 41.
(2) Marc Bloch, 1921, Réflexion d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, Paris, édition Allia, 2019.
(3) Marc Bloch, 1921, Réflexion d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, Paris, édition Allia, 2019, p 14.
(4) Marc Bloch, 1921, Réflexion de historien sur les fausses nouvelles de la guerre, Paris, édition Allia, 2019, p 40.
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


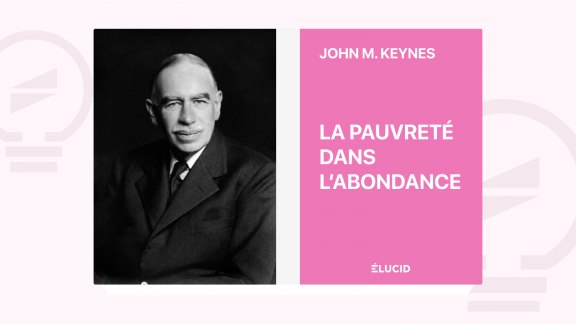





0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner