Les manifestations qui ont éclaté en Iran à la mi-septembre après la mort de Mahsa Amini à la suite de son arrestation par la « Brigade des mœurs » — parce que son voile ne couvrait pas suffisamment ses cheveux — ont pris une ampleur inédite dans le pays. L’analyse des foyers et des gestes de la révolte donne à voir une solidarité entre une partie des Iraniens et les minorités ethniques du pays pour revendiquer la liberté, les droits des femmes et le renversement du gouvernement, à rebours des clivages que le régime islamique cherche à instaurer.

Le 16 septembre, l’assassinat de Mahsa Amini a donné lieu à des manifestations de jeunes femmes, ôtant leur foulard en signe de protestation. Dans les jours qui ont suivi, le mouvement a été rejoint par des hommes, puis par les étudiants, notamment ceux de l’université Sharif de Téhéran, alors que le milieu universitaire s’était tenu à l’écart de toute contestation depuis plus de dix ans. Enfin, l’entrée en grève des ouvriers et salariés du secteur pétrolier, au début du mois d’octobre, a donné une nouvelle inflexion au mouvement. En effet, malgré plusieurs arrestations, les grévistes ont refusé toute négociation avec le gouvernement, signe d’un durcissement de leur position dans leur rapport de force contre Téhéran.
Des émeutes avaient déjà agité le pays, en 2017 ou en 2019 notamment. Si des slogans politiques trouvaient parfois un écho dans les cortèges, le fond de la contestation restait de nature économique. L’Iran se trouve en effet dans une situation de délitement social et de crise économique catastrophique, aggravée notamment par les sanctions occidentales à son encontre. L’inflation atteint près de 50 % dans le pays, et 75 % sur les produits alimentaires, poussant chaque mois les Iraniens à de nouveaux sacrifices. Mais en scandant le slogan « Femme, vie, liberté », les femmes protestant contre l’assassinat de Mahsa Amini ont su rapidement fédérer la mobilisation, non seulement en ralliant les hommes à leur cause, mais aussi en dépassant les clivages de la société iranienne, lesquelles résultent en réalité de la volonté d’agir en séparatistes des dirigeants de la République islamique.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


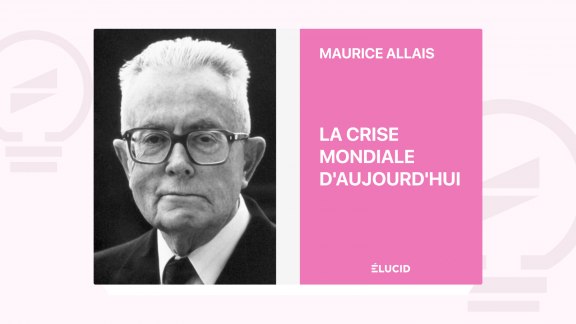

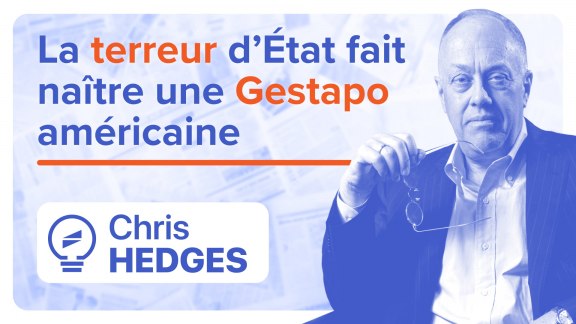
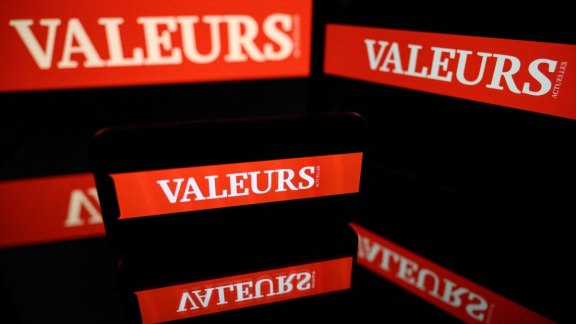
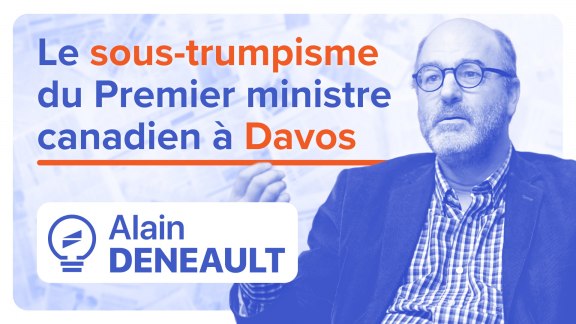
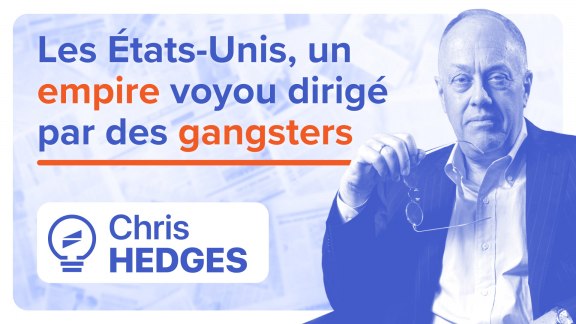
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner