Le choc pétrolier de 1973 est un exemple particulièrement frappant de l’influence des dynamiques géologiques sur les événements sociopolitiques. Souvent présenté à tort comme le résultat de l’activisme irraisonné des pays de l’OPEP, le choc pétrolier de 1973 est en fait la résultante du pic du pétrole conventionnel franchi en 1970 aux États-Unis. La soudaine hausse de demande sur le marché international dans un contexte de ralentissement de la hausse du rythme d’extraction aboutit, après un délai, à une déflagration sans précédent sur les prix et à un choc économique d’ampleur. Il est navrant de constater le storytelling qui a été rétrospectivement construit avec une opposition entre pays producteurs et pays consommateurs, gentils contre méchants, qui ne correspond à aucune réalité historique. D’une part, il n’y a pas de distinction d’intérêt aussi nette, car les compagnies occidentales contrôlaient de fait ou via leur expertise technique les gisements des pays producteurs et avaient intérêt à la hausse des cours du brut. D’autre part, les plus forts effets du choc n’ont pas pour origine les retenues de production de l’OPEP, mais bien la cannibalisation des flux d’approvisionnement entre gentils pays consommateurs. Analyse.

En 1973 s'est produit un événement qui a frappé les mémoires : le premier choc pétrolier. Face à la réduction brutale de l’offre pétrolière, de nombreux pays prennent soudainement conscience de leur dépendance à cette forme d’énergie.
La mécanique des chocs pétroliers
L’événement traditionnellement mis en avant pour expliquer cette crise est le déclenchement de la Guerre du Kippour en octobre 1973. L’État hébreu est en effet attaqué par une coalition de pays arabes menée par l’Égypte et la Syrie. Le soutien occidental à Israël notamment via des livraisons d’armes suscite la colère des pays producteurs de pétrole aux premiers rangs desquels l’Arabie Saoudite qui décide de brandir, en novembre de la même année, son « sabre pétrolier ». Les pays exportateurs choisissent de relever fortement les prix du pétrole vendu à l’Occident et de réduire leurs exportations.
Ce récit historique omet pourtant un aspect essentiel du déclenchement du premier choc pétrolier : celui de la contrainte physique, c’est-à-dire le manque de pétrole facilement accessible, qui a empêché de poursuivre la croissance de la consommation de pétrole au même rythme que par le passé.
En effet, en 1970, les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, passent leur pic pétrolier conformément aux projections de Marion King Hubbert réalisées en 1956 (1).
Le pic du pétrole conventionnel aux États-Unis se produit précisément en novembre 1970 à près de 10,044 millions de barils par jour (Mb/j). Le déclin qui s’ensuit est très rapide : la production atteint 9,1 Mb/j en décembre 1971 (-9,4 %). La production se reprend ensuite jusqu’en mai 1972 avant de décliner à nouveau et de revenir à 9,1 Mb/j en septembre 1973 à la veille du déclenchement de la Guerre du Kippour. La production chaotique des États-Unis est un signe qui ne trompe pas : l’Amérique commence à manquer de pétrole, sans qu’un événement géopolitique ou économique majeur soit en cause.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

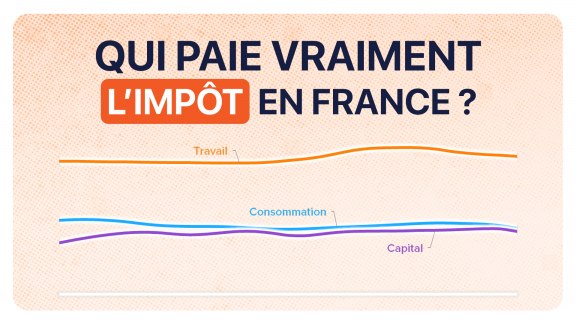
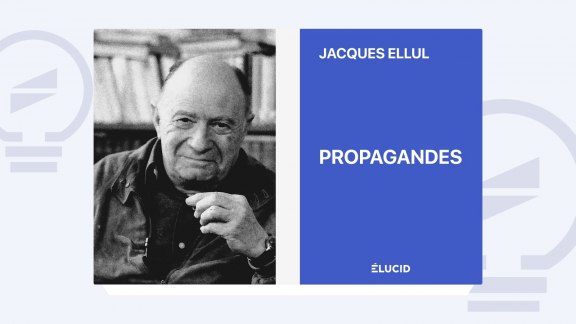





4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner