Alors que le journalisme de terrain est en crise, Jonathan Randal nous livre son analyse du paysage médiatique occidental. Fort d’une riche expérience de terrain, cet ancien Grand reporter revient sur l'âge d’or du journalisme dont il est un rescapé, donnant à voir un présent bien sombre en ce qui concerne les médias en Occident.



Abonnement Élucid
Jonathan Randal (1933 -), grand reporter américain, est un spécialiste du Moyen-Orient. Après avoir travaillé pour le Time Magazine et le New York Time pour lequel il fut correspondant en Pologne, il devient correspondant à Paris, puis correspondant de guerre pour le Washington Post pendant près de trente ans. Au cours de sa carrière, il a ainsi couvert de nombreux conflits, parmi lesquels la guerre du Vietnam et la guerre du Liban.
Édouard Vuiart (Élucid) : Votre carrière, pour la majeure partie, est celle d’un correspondant étranger. Or, aujourd’hui, le journalisme de terrain semble en voie de disparition. Les correspondants ne font plus que des allers-retours entre deux avions pour faire « acte de présence », là où les anciens correspondants, comme vous, ne restaient jamais moins d’une semaine. Comment expliquez-vous cette disparition progressive d’un journalisme soucieux des hommes et du terrain ?
Jonathan Randal : Depuis plus de cent ans, le meilleur moyen pour un jeune journaliste de lancer sa carrière était de couvrir une guerre. Or, depuis vingt ans, il y a de moins en moins de journaux occidentaux, de correspondants ou de bureaux à l’étranger. La raison ? Garder un correspondant en place, même pour une semaine, coûte cher.
Face au Huffington Post, à Amazon, Facebook et les autres qui ont les moyens de maintenir des bureaux à l’étranger, The Boston Globe, The Chicago SunTimes, The Baltimore Sun et les chaînes de télévision font des économies en fermant leur service étranger. Une triste illustration est le Paris Bureau. À Paris, NCB, CBS ou ABC ont fermé boutique depuis belle lurette. The Paris Bureau, une entreprise française fondée par des producteurs américains, fournit désormais les caméras, les équipes, des expertises et souvent suggère des sujets aux journalistes qui arrivent au dernier moment pour le reportage.
En quarante-cinq ans à l’étranger, j’ai vécu des périodes fastes, et d’autres beaucoup moins. J’ai pris des billets excursions, j’évitais les palaces pour préférer des hôtels plus petits et moins chers. Il y avait de moins en moins de moyens. Par exemple, lorsque j’ai rejoint TIME en 1961, il y avait neuf correspondants permanents à Paris. Depuis dix ans, TIME n’a même plus dix correspondants à l’étranger, dans le monde entier. Pendant la période faste de la télévision américaine, dans les années 1970 et 1980, les chaînes avaient souvent trois équipes pour suivre les évènements internationaux, la révolution iranienne par exemple. Cette période est révolue.
Élucid : En lien avec votre passé de correspondant de guerre, vous avez déclaré la chose suivante : « Avec les communications instantanées d’aujourd’hui et le contrôle concomitant, il est difficile de saisir le sentiment de liberté dont j’ai joui en travaillant à l’étranger, en particulier dans les pays alors éloignés, dont beaucoup n’ont pas été touchés par les générations précédentes de correspondants américains. » Ce sentiment de liberté qui a caractérisé votre travail de correspondant à l’étranger appartient-il également à une époque révolue ?
Jonathan Randal : À l’époque, j’avais le temps de lire, de visiter les grands et les petits pays, de rencontrer des gens simples comme des gens au pouvoir. Souvent, ces visites ne fournissaient pas de papier dans l’immédiat. Mais c’était une méthode payante !

Lors de l’élection de Mitterrand en 1981, Washington était persuadé que les quatre ministres communistes allaient renverser le gouvernement et faire de la France un État communiste. George Bush, alors vice-président de Reagan, a fait une visite éclair pour mettre Mitterrand en garde. Un an plus tard, ma rédaction voulait un papier sur le soi-disant travail de sape des ministres communistes.
J’ai parlé à une bonne centaine de conseillers anticommunistes de Mitterrand, j’ai enquêté sur le ministère du Transport dont le ministre était communiste. Je n’ai rien trouvé. Les socialistes, vieux ennemis du PC malgré le programme commun qui a permis la victoire de la gauche, avaient pris soin de surveiller le secteur de près. Par conséquent, le Washington Post n’a rien publié à ce sujet. Qui, en 2021, autoriserait un reporter à prendre tant de temps à travailler un sujet pour ne rien publier à l’issue ?
Les pressions politiques pour tenter de mettre à mal la protection des sources semblent augmenter. Les journalistes français sont désormais convoqués dans les bureaux de la DGSI. Le traitement réservé à certains journalistes comme Julian Assange est scandaleux. Diriez-vous que le travail de journalistes est en danger ? Ces menaces sur la profession sont-elles plus à même de favoriser l’autocensure des journalistes ?
Absolument. Et ce n’est cependant pas nouveau. Par exemple, quand je visitais un pays où je savais que j’étais pisté nuit et jour par les services secrets, je m’efforçais d’utiliser le téléphone le moins possible, de favoriser les visites à l’improviste, surtout des personnes que je savais détenir des informations importantes. Ces personnes me connaissaient et me faisaient confiance.
Évidemment, tout cela n'était possible qu'avant l’apparition des téléphones mobiles et satellites, qui désormais rendent la tâche aisée aux services secrets. Autrement dit, un peu plus de « shoe-leather journalism », ce journalisme consistant à marcher d’un endroit à l’autre, à observer les choses et à parler aux gens, compliquerait beaucoup les efforts pour traquer les journalistes. Les gens auraient moins de réticence à parler aux journalistes, si seulement ces derniers étaient moins paresseux.
Les Grands reporters ne pourraient pas couvrir les zones de guerre sans les fixeurs, ces hommes de l’ombre, à la fois interprètes, guides, chauffeurs ou journalistes eux-mêmes qui aident les reporters à se repérer sur le terrain. Quelle a été, au cours de votre carrière, votre relation avec ces personnes qui ont mis leur vie au service de l’information ?
J’ai passé la majorité de ma carrière sans connaître le mot « fixeur », du charabia selon moi. J’ai connu beaucoup de chauffeurs de taxi, de trafiquants, de diplomates, de gens très ordinaires et même quelques espions (ou des personnes qui aimaient se faire passer comme tels). Mais, en arrivant sur un terrain pour la première fois, je comptais surtout sur mes collègues. Et, en retour, j’ai toujours cherché à aider ceux qui pensaient que je pouvais leur être utile.
De plus, pour survivre en zone de guerre, ce ne sont pas seulement les personnes qui nous entourent, mais bien souvent des habitudes qui peuvent sembler anodines qui permettent de se repérer. À la guerre, il y a peu de vrais scoops, et encore moins qui durent plus de trente minutes. Mais, il y a maintes façons de se faire descendre bêtement.
La première règle de tout reporter est de se souvenir qu’il n’y a pas de questions bêtes, mais seulement des réponses susceptibles de l’être. Ma pauvre femme souffre toujours de ma manie de m’arrêter pour demander ma route. Évidemment, le GPS existe depuis des décennies, mais il ne trahit pas d’émotion, ne donne pas de petites indications de peur, etc. Si j’ai survécu à beaucoup de conflits, ce n’est pas seulement grâce à Lady Luck, mais également à ce genre de petites précautions, vieilles comme le monde.

En 2002, vous avez refusé de témoigner devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPY) au sujet d’un entretien que vous aviez mené avec l’ancien ministre bosno-serbe du Logement en 1993. Ce refus a débouché sur une affaire judiciaire que vous avez gagnée, créant ainsi un précédent de protection pour les correspondants de guerre, une victoire importante pour la liberté de la presse.
Votre ligne de défense était claire : si des instances pouvaient contraindre les correspondants à témoigner, cela « limiterait la couverture et mettrait des vies en danger ». Comment percevez-vous, à la lumière de cette affaire, l’évolution de la liberté de la presse aux États-Unis, en France et plus largement en Occident ?
Il est vrai que j’ai gagné puisque désormais, au même titre qu’un représentant d’ONG, un ou une correspondant(e) de guerre ne serait pas obligé de témoigner en dehors de ses écrits ou films. Cependant, ma prise de position initiale correspondait au point de vue du Washington Post et de la quasi-totalité des médias américains, qui voulaient à tout prix éviter que leurs journalistes soient témoins devant les tribunaux.
En vérité, le danger pour les journalistes reste encore très présent. Le temps où les conflits opposaient les armées régulières d’États rivaux est passé. Aujourd’hui, ce sont des groupuscules rivaux qui s’opposent ; et ces derniers ignorent les « règles de la guerre » codifiée par les États souverains. Les correspondants occidentaux qui couvraient la Syrie au temps de l’État islamique l’ont payé cher, souvent au prix de leur vie.
Par ailleurs, cette décision a en réalité servi d’autres fins. Pour revenir au cas que j’ai plaidé devant le TPY, l’avocat du Washington Post qui a contribué à ma « victoire » me disait, moins d’un an après, que partout le gouvernement américain accélérait la chasse aux fuites par les journalistes. Si les États-Unis ont inventé le libre accès aux documents, par le Freedom Information Act, ils ont fait machine arrière depuis belle lurette. Plus les années passent, plus forte est la volonté du gouvernement à réprimer toute fuite. Depuis la présidence de Donald Trump, nous sommes dans un monde nouveau. Avec l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche, nous avons découvert l’existence de « faits alternatifs ».
Autrement dit, la recherche de la vérité est devenue une valeur incertaine. Trump adorait se faire attaquer par le New York Times, car c’était la preuve qu’il était pris au sérieux par Manhattan. Il racontait n’importe quoi et les journalistes s’amusaient à compter les mensonges et les exagérations. Tout le monde était ravi. Le New York Times, le Washington Post ont compensé la perte de la publicité dans leurs éditions papier par l’explosion des abonnements payants en ligne : 7 millions pour le NYT et 3 millions pour le Post.
En 1929, dans son reportage Terre d’Ébène, le journaliste Albert Londres écrivait ces mots : « Je demeure convaincu qu’un journaliste n’est pas un enfant de chœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. » Pensez-vous qu’aujourd’hui, les médias occidentaux soient de plus en plus peuplés d’« enfants de chœur » ?
Quel journaliste n’aimerait pas mériter la belle définition d’Albert Londres ? Aujourd’hui, répondre aux avalanches de tweets mensongers et aux exagérations de Donald Trump a suffi aux médias « mainstream » pour avoir la sensation de ne pas être « enfants de chœur ». Mais, que dire de la chasse aux sorcières entamées par le New York Times ou le Washington Post dans la période qui a suivi le 11 septembre ? Toute personne portant un turban devenait un « danger ». La presse a ainsi soutenu la propagande visant à justifier l’invasion de l’Irak en 2003…
Évidemment, les néoconservateurs ont poussé de toute leur force pour déclencher cette guerre ; mais cela n’aurait pas été possible sans que les médias se couchent, terrassés par la peur née du 11 septembre. En France également, comment expliquer la docilité de la presse et des chaînes devant les imprécisions et incohérences du gouvernement Macron face à la crise du Covid ? On a vu de plus en plus de statistiques partielles et de moins en moins de médecins sur les écrans de télévisions.
Le 5 février 2003, le secrétaire d’État américain Colin Powell prononçait à l’ONU le fameux discours dans lequel il brandissait une soi-disant fiole d’anthrax, preuve que l’Irak de Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Comment expliquez-vous qu’aussitôt, l’ensemble des médias américains aient relayé ce mensonge visant à justifier l’invasion de l’Irak ?
C’est très simple. Dans le gouvernement Bush, le seul ministre qui inspirait confiance était l’ancien général Colin Powell. Pourquoi presque tous les médias américains l’ont-ils cru ? D’abord parce que c’était lui qui parlait. Ensuite, en raison de la peur et du choc du 11 septembre, première attaque sur le sol américain depuis que les Anglais ont brûlé la Maison-Blanche en 1814. Le 11 septembre avait profondément blessé le public américain et l’a par la suite aveuglé face aux effets désastreux de l’invasion de l’Irak en 2003.

Pourquoi nombre d’Américains ont-ils tenu responsables les journalistes de la « perte » du Vietnam ?
Les Américains sont patriotes et, comme beaucoup d’autres peuples, ignorent la géographie et l’histoire. Si les États-Unis dépensent quinze fois plus que le reste du monde pour leur armée, ils s’attendent ainsi à des victoires rapides et des guerres courtes. Quand les guerres s’éternisent, comme l’Afghanistan en 2001 ou l’Irak en 2003, à qui la faute ? Depuis le début du monde, c’est le messager des guerres qui doit être tenu responsable. C’était tellement plus simple lorsque la censure était respectée comme un devoir national.
Rendre la presse responsable des « pertes » n’est pas un phénomène nouveau. J’ai entendu cette douce musique pour la première fois au sujet de la victoire des communistes chinois en 1948. À l’époque, une chasse aux sorcières avait été lancée contre les quelques journalistes américains qui avaient couvert la débandade des Chinois dits nationalistes soutenus par Washington. Cela a recommencé avec la guerre de Corée en 1950.
En ce qui concerne la guerre du Vietnam, les journalistes sont devenus antiguerre, sauf exception notable, grâce à l’armée elle-même. Si vous alliez à Pleiku, à Da Nang ou à Ca Mau, les hélicoptères vous attendaient pour approcher des combats. Il ne faut pas s’étonner que les journalistes soient devenus antiguerre, lorsque l’armée les aidait à tout voir — une erreur qui a été corrigée pour les guerres qui ont suivi.
Aussi, en 1968, la couverture de LIFE montrait des photographies de 400 soldats américains tués au Vietnam la semaine précédant la publication. TIME, en revanche, a réécrit d’excellents reportages de ses correspondants au Vietnam pour faire croire que les Américains gagnaient la guerre. Comme je l’ai dit, il y avait des exceptions.
L’Occident sombre régulièrement dans des phases d’hystérie contre un ennemi désigné et régulièrement renouvelé. Quel est selon vous le principal moteur de la « fabrication de l’ennemi » ? Comment faire pour que la presse ne se fasse pas machinalement le relais de ces schizophrénies diplomatiques ?
Ce n’est pas tellement un phénomène de « fabrication de l’ennemi » auquel nous faisons face, mais plutôt l’effet de la « nécessité du diable », typique de la Guerre froide, qui fait son retour. C’est vieux comme le monde.
Le déclin de la presse « mainstream » a commencé depuis longtemps et s’est accéléré depuis le développement d’Internet une décennie plus tard qui sapait les « petites annonces » qui traditionnellement constituaient le bénéfice le plus important des journaux.
Aux yeux de beaucoup, cette presse « mainstream », surtout le NYT ou le Washington Post, ont perdu leur âme, victimes de la peur du 11 septembre, victimes des néoconservateurs saouls de « l’hyperpuissance » chère à Hubert Védrine. Cette hyperpuissance cependant, n’a duré que le temps de la courte « victoire » de la Guerre froide et s’éteint au fur et à mesure que se lève l’illusion de la capacité américaine à refaire le monde.
Orwell craignait ceux qui nous priveraient de l’information. Huxley redoutait qu’on ne nous en abreuve au point que nous soyons réduits à la passivité et à l’égoïsme. Orwell craignait qu’on nous cache la vérité, et Huxley que la vérité soit noyée dans un océan d’insignifiance. De quelle vision vous sentez-vous le plus proche quant à notre avenir ?
De celle d’Huxley. Les réseaux sociaux prêchent trop souvent leurs propres convertis. Les complotistes ne trouvent plus beaucoup de contradicteurs, hélas. Si vous ne consultez qu’un journal, qu’une revue ou qu’un réseau social qui confirme vos préjugés, il n’y a pas de discussion ou de débat. Ignorance is bliss, l’ignorance est une bénédiction.
Plus largement, on peut lire et écrire n’importe quoi. Les inventeurs d’Internet pensaient qu’ils avaient trouvé le moyen de rendre l’information accessible au public. En définitive, le résultat, pour le moment, est l’annihilation de tout forum de débats d’idées dans un flux démesuré d’informations. Les journaux ne touchent pas le grand public et les chaînes de télévision fournissent une information de qualité médiocre. À part l’élite éduquée, qui lit les journaux ? Les rédactions des chaînes de télévision sont-elles devenues trop paresseuses pour avoir leurs propres idées ?
Depuis maintenant plusieurs années, le Liban connaît une crise grave. Les Libanais, qui dans un premier temps avaient freiné leur colère de peur de retomber dans la guerre civile, semblent désormais déterminés à mettre un terme au système de clientélisme clanique qui régit leur quotidien. Comment expliquer cette crise et quelle issue y voyez-vous ?
Depuis le début de la Guerre du Liban en 1975, on pourrait à la fois dire que tout, ou presque rien, n’a changé, sauf l’augmentation de la corruption et l’importance croissante des influences étrangères. Pour comprendre les origines de cette crise, il faut remonter à la période du Mandat français (1923-1943). C’est à cette époque que les maronites, favorisés par les Français, n’ont pas cru bon de partager le pouvoir concentré entre leurs mains depuis 1920.
Après cela, ce sont les chiites qui, pour la première fois, cessent d’être les supplétifs des autres. Grâce à l’argent et l’armement iranien, et grâce à leur propre don inné d’organisation, ils deviennent la principale force du pays. Je vous renvoie pour plus de précisions, à mon vieux bouquin The tragedy of Lebanon (1983). Quant à l’avenir, des questions se posent. Spécialement, on peut se demander si Biden va réduire les prétentions d’Assad et des Ayatollahs grâce à un nouveau deal nucléaire.
Que dire du système bancaire du Liban, discrédité aux yeux des Arabes et des Libanais ? Fonctionnant selon la pyramide de Ponzi, montage financier frauduleux, ce système a permis de maintenir la valeur du livre libanais au-delà de toute analyse rationnelle. En outre, pendant les « petites guerres » du Liban qui minent le pays depuis 1975, les pays étrangers qui finançaient les milices ont participé à stabiliser la valeur de la monnaie.
Est-ce que le Grand reporter a souvent la nostalgie des terrains qu’il quitte, comme l’artiste ambulant lorsqu’il change de ville ?
Bien sûr, j’ai la nostalgie de Beyrouth, du Kurdistan, de l’Afrique noire, ou même de l’ex-Congo belge. Le cafard, je le connais et il revient chaque fois que j’écoute Édith Piaf. Je regrette que nos employeurs n’aient pas prêté attention au stress des correspondants de guerre. Je regrette les morts de trop de collègues, victimes au même titre que les soldats du stress post-traumatique.
Propos recueillis par Édouard Vuiart
Photo d'ouverture : Colin Powell, ONU, 2003 - Stephen Chernin - @AFP
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous


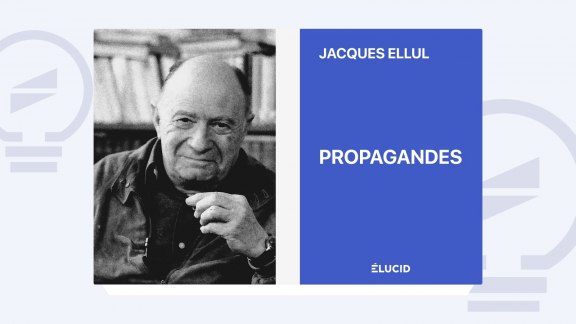





2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner