« Mussolini est l’un des rares à savoir que la réalité réside uniquement dans le pouvoir qu’a l’homme de la construire, et qu’on la crée seulement par l’activité de l’esprit » (1). Ils furent nombreux ceux qui, comme Luigi Pirandello, succombèrent à la séduction de la propagande fasciste et aux envoûtements d’un personnage aussi grotesque que Benito Mussolini. En mai 1924, deux Italiens sur trois ont voté pour la liste nationale du Faisceau de licteur. Tous les candidats fascistes ont été élus. Un mois plus tard, le député socialiste Giacomo Matteotti était enlevé et assassiné. Et pourtant il ne réclamait que des faits : « les faits, répète-t-il, obstiné. Juste les faits. Les faits sont vrais ou faux, ils ne devraient pas susciter de bruits » (2). Les faits qu’évoque Giacomo Matteotti sont les abus, les exactions et les crimes du mouvement fasciste qui venaient d’être plébiscités par le peuple italien. Mais que valent les faits face aux prophètes du mensonge ? Que valent les faits face aux « réalités alternatives » d’hier comme d’aujourd’hui ? Que valent les faits lorsque tout se vaut et que les pouvoirs politiques et économiques invitent les masses à choisir, à sélectionner ceux d’entre eux qui leur conviennent, celles des constructions de la réalité qui bercent leur misère par de vieilles chansons ou de nouveaux refrains ?



Abonnement Élucid
Hannah Arendt a placé au cœur des régimes autoritaires cette dégradation de la fonction de révélation du langage, de la dislocation de leur logique, du chaos monstrueux de leurs énoncés, de la fragilité extrême des boussoles et des repères de la langue reflétant la désagrégation sociale et la fragmentation politique, contribuant à son accélération vers l’abîme. Elle écrit : « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez » (3).
Les amants de la mort
Il convient de ne pas oublier avec Umberto Eco que « le terme fascisme s’adapte à tout parce que même si l’on élimine d’un régime fasciste un ou plusieurs aspects, il sera toujours possible de le reconnaître comme fasciste » (4). Il existerait ce qu’il nomme un Ur-fascisme, c’est-à-dire un fascisme primitif et éternel auquel chaque culture vient greffer, coaguler, son régime culturel spécifique. Pour ce fascisme originaire : « penser est une forme d’émasculation » et « la suspicion envers le monde intellectuel a toujours été un symptôme d’Ur-fascisme ». Le sens des paroles s’écrase sur les murs des gymnases où s’entrainent des militants à même de se convertir à tout moment en miliciens militarisés chargés de régler la vie civile. Dixit Mussolini.
À partir de ce moment-là, les faits ne dépendent plus d’un régime de vérité et d’exactitude, mais de l’autorité des chefs, auxquels les individus ont confié la tâche de les interpréter. C’est le préalable de toute soumission volontaire : « Avant que les chefs de masses prennent le pouvoir pour plier la réalité à leurs mensonges, leur propagande se distingue par un mépris radical pour les faits en tant que tels : c’est qu’à leur avis les faits dépendent entièrement du pouvoir de celui qui les fabrique » (5). Le mépris dans lequel une société tient la valeur intégrative de la parole, la fonction thérapeutique du dialogue et de la négociation pour réguler les divisions sociales, ouvre la voie aux solutions de force, agonistiques, meurtrières. C’est cette solution qu’offrait le fascisme, poursuivre en temps de paix les modalités d’existence de la guerre, sa fraternité « des tranchées », sa cruauté transformant les vivants en automates tueurs.
Inutile d’attendre les robots pour accomplir cet hymne à la mort qui est la signature même de tous les fascismes, les anciens comme les nouveaux, ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui, et davantage encore ceux de demain. Cette vampirisation des fonctions du langage par l’action violente et brutale est la condition de cet effacement de l’empathie dans lequel Hannah Arendt voyait un des premiers symptômes de l’émergence des totalitarismes. La conversion de l’industrie en industrie d’armement, en industrie de guerre, est la corrélation matérielle de cette révolution symbolique, au sens de Pierre Bourdieu, de la langue en vociférations. C’est précisément en ce point — comme j’ai essayé de le montrer dans mon dernier essai, Dé-civilisation —, que les individus et les peuples s’offrent aux « amants de la mort » (6).
La niche culturelle des fascismes
Quels sont « les facteurs favorisants » d’une civilisation qui conduisent les peuples et les individus à s’offrir à l’emprise des prophètes du mensonge et à participer de ce fait à une entreprise de dé-civilisation dont ils finissent par être les complices et parfois les victimes ?
Norbert Élias dans son œuvre germinale, Les Allemands (7), nous en a tracé l’heuristique : le relâchement des inhibitions sociales et des autocontrôles des comportements nazis surgirent en Allemagne dans un contexte historique et politique particulier. A contrario des autres États européens l’unification de l’Allemagne fut tardive et instable ; résultant de la victoire de 1870-1871 sur la France, elle y est parvenue à l’ombre des canons aristocratiques et guerriers de la civilisation de Cour. Les lueurs des Lumières de la culture bourgeoise, de son esprit critique et de ses valeurs de tolérance s’étaient obscurcies au profit des codes de l’honneur et du duel. Cette capacité à donner satisfaction a contribué à l’unité d’une société de privilégiés, le privilège de ceux qui avaient l’honneur d’exiger arme en main réparation d’une offense de n’importe quel autre membre de la caste à laquelle ils appartenaient.
Ce code de l’honneur bafouait les lois civiles et pénales au-dessus desquelles les héritiers des « sociétés guerrières » se situaient. L’emploi de la force entre les citoyens constituait un défi constant à l’autorité de l’État, et aboutissait à la création de règlements et de codes parallèles aux lois officielles, normes et codes sociaux garantis par la noblesse et la haute autorité militaire. A contrario de la France et de l’Angleterre où la « bonne société » bourgeoise des capitales définissait les nouveaux « canons de comportements », en Allemagne les fonctions sociales d’intégration et de régulation étaient assurées par des institutions plus anciennes et délocalisées, comme l’armée, les associations étudiantes combatives et les grandes familles aristocratiques qui monopolisaient les postes administratifs décisionnels.
Le codage des comportements sociaux s’inspirait des modèles aristocratiques et militaires. Norbert Élias analyse le « duel » comme la « stratégie sociale » privilégiée des classes dirigeantes. La victoire de 1871 sur la France affermit la conviction selon laquelle seuls les groupes les plus puissants – c’est-à-dire l’empereur, la société de cour et la noblesse, suivis par les piliers militaires et civils de l’État –, constituaient la véritable Allemagne : « la victoire de l’armée allemande sur la France fut en même temps la victoire de la noblesse sur la bourgeoisie en Allemagne » (8).
Croire retrouver sa dignité par l'exclusion de l’altérité
Theodor Adorno en a eu l’intuition : « Je ne voudrais pas m’attarder sur le problème des organisations néonazies. J’estime que la survie du nazisme dans la démocratie présente plus de dangers potentiels que la survie des tendances fascistes dirigées contre la démocratie » (9). Cette « survie du nazisme dans la démocratie » quelle est-elle ? En premier lieu un rassemblement des humains par la violence et l’exclusion de tous ceux qui incarnent l’altérité afin de maintenir à tout prix l’illusion d’une communauté sans divisions, ni factions, ni inégalités sociales. C’est toujours la vieille chanson qui berce la misère humaine : « sans eux, nous serions nous » (10). Mais, qui peut croire à de telles balivernes si ce n’est ceux qui ont besoin d’y croire et de croire ceux qui les invitent « à tuer ensemble » (11) ou à exclure ensemble ? Mais, pourquoi ? En un mot comme en cent, pour se sentir dignes d’être aimés, pour retrouver une dignité et un narcissisme en cours de naufrage. Cela peut paraître simple, trop simple, et pourtant toute mon expérience clinique l’atteste : le désir d’être reconnu et aimé est primordial, surtout lorsque sa satisfaction est menacée.
Ce désir est d’autant plus exigeant et puissant dans certaines périodes de notre histoire que les individus sont isolés, désolés, démunis, dénutris. Dans ces périodes de désolation et d’incertitude extrêmes, la tentation est grande de s’agripper à un leader, à son système et à ses mensonges, à son déni des réalités blessantes. Les foules fascistes scandant « Duce, Duce, Duce » vociféraient une soumission librement consentie et un appel à être reconnues, reconnues par le leader et par les camarades qui promettaient la terre promise de l’empire italien. Mais, malgré ses féroces menaces et son aspiration impérialiste, l’Italie n’était pas prête pour la guerre. Les vociférations, les menaces, les subterfuges n’y ont rien changé : c’est l’Allemagne nazie qui a dicté aux Italiens l’agenda des lois raciales et de l’entrée en guerre (12).
Tous ceux qui ont travaillé les documents historiques de ces périodes le savent : le désir d’être aimé, reconnu, identifié, joue à pleins tuyaux dans ces moments d’hypnose collective. Par exemple, Theodor Adorno démonte l’illusion selon laquelle le régime national-socialiste n’aurait signifié que craintes et souffrances pour des populations auxquelles il aurait été imposé. L’incitation à la violence permanente anticipe et exorcise les crises existentielles. Il écrit : « l’intégration si souvent mise en avant et l’organisation de plus en plus concentrée du réseau social qui englobait tout assuraient également une protection contre la crainte universelle de tomber à travers les mailles et de sombrer. Ils étaient innombrables ceux qui se croyaient débarrassés du froid de l’aliénation sociale grâce à la chaleur du côte à côte, même manipulée et suscitée artificiellement » (13). « Le froid de l’aliénation sociale » et la peur du déclassement de ces nouveaux ermites de masse que sont les individus modernes les précipitent dans les bras des dictateurs fascistes.
Car, c’est très précisément au moment où l’organisation sociale ne permet plus la reconnaissance symbolique des individus, les uns par les autres, où la multiplicité des points de vue n’apparait plus comme une richesse, mais comme une source de divisions, que la Cité se disloque et que la guerre devient inévitable. À ce titre la guerre est toujours, d’une certaine manière, une guerre civile étendue aux autres régions du monde.
Qu’est-ce qui conduit les humains à s’associer pour créer une cité, c’est-à-dire à construire une cohésion sociale afin de s’épanouir collectivement et singulièrement ? Cette question abordée par Aristote, dans son ouvrage majeur, Les politiques (14), révèle que les humains font « communauté » non seulement parce que cela leur permet en coopérant et en collaborant matériellement de parvenir à de meilleures productions, à de meilleurs services ou fabrications, à survivre, mais encore, – et surtout –, parce qu’ils ont besoin d’une reconnaissance des uns par les autres. Le sujet humain nait « inachevé » et c’est sa vie dans la Cité qui permet son épanouissement.
Un sujet n’est humain qu’à partir du moment où il est reconnu comme tel par ses semblables. Pour Aristote, la condition d’homme libre suppose trois traits : l’aptitude à délibérer, la prudence et la capacité de choisir. Or, c’est exactement ces trois conditions de la liberté – à commencer par la liberté de penser – qui se trouvent malmenées, altérées et parfois empêchées dans la réalité essentielle des sociétés modernes. Et, le drame précisément de l’émergence des fascismes résulte de leur capacité à prospérer sur les ruines des conditions sociales et civilisationnelles de la capacité de penser. D’où ce pessimisme des penseurs comme Theodor Adorno et Léo Löwenthal, mais aussi Norbert Élias, lorsqu’ils envisagent les résurgences possibles des fascismes dans une Europe moralement déprimée et socialement exposée à la désintégration culturelle : « On a souvent l’impression que l’abcès nazi n’est toujours pas résorbé ; le pus fermente, mais ne s’écoule pas » (15). Et il ajoute : « L’équilibre entre solidarité et concurrence au sein des relations des pays européens entre eux comme avec le reste des nations n’est pas du tout simple à réaliser. […] La question du passé est décisive. À maints égards, elle n’est pas du tout résolue ».
Elle se pose plus que jamais de nos jours dans un monde où le désir d’être aimé et reconnu est obturé par une civilisation des mœurs où prévalent la concurrence à mort, les rapports de force, la désolation sociale et l’extrême solitude d’humains exposés à leur vulnérabilité sans autre partage que les connexions algorithmiques dévitalisées et décharnées.
Les politiques du vide et du chaos
C’est du vide politique autant que du chaos social que naissent les emprises psychiques et sociales des nouveaux prédateurs de toutes sortes, sexuels, politiques, influenceurs publicitaires et mercantiles, gourous de sectes religieuses ou communautaires… Comme l’avaient analysé Léo Löwenthal et Norbert Guterman, ces « prophètes du mensonge » n’ont rien d’autre à partager qu’une absence de pensée dialectique, un prêt-à-penser simplifié et vociféré, des excitations émotionnelles violentes et irrationnelles, des slogans pour agitation stérile obturant les capacités d’analyse et de partage du sensible. Il convient d’analyser la stratégie des discours des agitateurs davantage comme celle des charlatans qui vantent les bienfaits d’un remède miracle que celle d’un chef politique faisant une analyse politique.
L’opinion publique est travaillée par des discours qui enflamment les pires de ses pulsions, mais en aucune manière elle n’est invitée à réfléchir, à analyser et à trouver des solutions au malaise social. Les agitateurs vitupèrent contre des ennemis aux traits indiscernables ou trop facilement définis par des préjugés de race, de genre ou de classe sociale, des caricatures offertes au saccage des foules. Léo Löwenthal et Norbert Guterman en font un portrait lumineux (16) :
« À la différence de l’habituel avocat du changement social, l’agitateur ne cherche pas à définir, au moyen de concepts rationnels, la nature du mécontentement qu’il exploite cependant. Il aggrave plutôt la désorientation de son public en détruisant tous les jalons rationnels et en proposant de leur préférer des comportements en apparence spontanés. L’adversaire qu’il désigne n’a pas de traits rationnellement discernables. Son mouvement est diffus et vague, il ne s’adresse pas à un groupe social clairement défini. Il en revendique le commandement, non parce qu’il comprend la situation mieux que les autres, mais parce qu’il en a plus souffert qu’eux. »
L’agitateur fasciste exploite la méfiance, la dépendance, l’exclusion, la précarité, la désillusion, l’angoisse et l’incertitude. Il « embobine » son public à partir de slogans simplistes invitant à l’action plus qu’à l’analyse, amplifiant les émotions de vengeance et de ressentiment, d’humiliation et de haine dérivées bien souvent sur des boucs émissaires.
Du noyau érotomaniaque de l'emprise
Si nous prenons en considération l’analyse que Gustave Le Bon propose dans sa Psychologie des foules, les auditeurs ne sont pas à proprement parler fascinés par les paroles des leaders qui les haranguent, mais plutôt par les images que ces paroles évoquent dans leur esprit. Psychologiquement parlant, il nous faut comprendre et admettre que les auditeurs et les émules ne deviennent prisonniers que de leurs propres images. Ils deviennent captifs des images qui ont su éveiller d’autres images auxquelles ils finissent par croire irrévocablement. C’est un des avantages, et non des moindres, des discours de l’Extrême Droite de se présenter comme irrationnels, vagues, confus, synthétisant des positions et des slogans contradictoires. Les auditeurs peuvent d’autant plus facilement y loger leurs propres attentes. Arrivés à ce point de mon analyse, il nous faut admettre que le désir d’être aimé et reconnu s’agrippe aux paroles des « prophètes du mensonge » qu’ils entendent là où ils les attendent. C’est exactement ce qui se produit dans la logique des passions où le sujet demeure appendu à une image qui a capturé l’image de l’objet de son désir.
Dans cet état de capture, les « prisonniers » sont prisonniers de leurs attentes et le charisme des leaders se réduit comme une peau de chagrin aux croyances de ceux qui leur délèguent ce pouvoir de les comprendre « vraiment ». Ce mirage d’être « vraiment » compris, c’est croire être vraiment reconnu, forme allégée d’être aimé. Ian Kershaw nous a légué une analyse indépassable de l’« autorité charismatique » d’Hitler, forme de domination politique qui repose non pas sur « la qualité inhérente à un individu, mais comme un attribut procédant de la façon dont il est subjectivement perçu par ses “adeptes”. En d’autres termes, si le porteur de “charisme” jouit effectivement d’un authentique pouvoir, ce pouvoir émane en réalité des attentes placées en lui par ceux qui l’entourent » (17).
Les adeptes de ce pouvoir charismatique des dictateurs fascistes et nazis furent recrutés parmi les humiliés ou les prisonniers du dénuement social et affectif, les angoissés des déclassements et des abandons sociaux errant dans une « nostalgie » d’autorités traditionnelles, voire religieuses. Ce sont ces circonstances qui ont constitué des facteurs favorisant le nazisme et permis à un personnage aussi médiocre qu’Hitler de s’emparer d’un État moderne et complexe. Il était devenu le « toxique » avec lequel les masses se shootaient pour dénier leur désespoir et rêver de revanche sur l’humiliant Traité de Versailles imposé par les vainqueurs en 1918.
J’ai, à plusieurs reprises, analysé ces relations d’emprise et de fascination qu’exercent les imposteurs, les séducteurs, les agitateurs et les dictateurs fascistes. Le point commun à toutes ces relations de domination repose sur le noyau érotomaniaque de la condition humaine : le besoin de se croire aimés et reconnus « vraiment » par ceux qui ont réussi à réveiller notre désir. Sans que cela puisse en aucune manière disculper les prédateurs, séducteurs et dictateurs de leur responsabilité dans les relations d’emprise, ils exploitent à leur insu ou sciemment ce profond désir de croire et d’être aimé qui n’est jamais aussi vif qu’en terre de désolation. Soumis et serviles, les émules parcourent en somnambules hypnotisés les chemins tracés par des prédateurs qui les conduisent vers l’abîme. C’est, sans nul doute, ce qui conduit aussi bien Theodor Adorno que Léo Löwenthal à faire de l’agitation fasciste « une anti-psychanalyse » : « Je qualifierais fondamentalement la technique de l’agitation comme une “psychanalyse à l’envers”. […] Cela rend les gens névrosés et psychotiques et, en fin de compte, complètement dépendants de soi-disant leaders » (18).
Cette proposition de considérer l’agitation fasciste qui utilise l’ambiguïté des discours comme dispositifs de capture et d’emprise des individus et des masses constitue, selon moi, une heuristique essentielle. Le fascisme originaire est une révolution culturelle fondamentalement désarrimée des faits et de la signification des paroles. C’est d’ailleurs de cette dénutrition du sens qu’il surgit et prospère. À la manière d’un test de Rorschach (19), chacun est invité à y mettre l’interprétation dont il a besoin pour rationaliser ses actions violentes et brutales. Là est le véritable danger du discours fasciste : discours attrape-tout et contradictoire offrant à chacun l’occasion d’y trouver les raisons d’adhérer à un mouvement révolutionnaire pour lequel la guerre et ses violences constituent une forme d’existence et l’industrie de guerre, la matrice du développement économique. Une telle civilisation des mœurs conduit à la destruction pure promue comme la forme ultime d’un désir qui œuvre paradoxalement à reconnaître la vie en la supprimant.
Une chose est sûre, une civilisation qui offrirait aux humains des occasions d’aimer, de fraterniser, de créer, de jouer ensemble, de prendre soin de nos vulnérabilités, nous éviterait de finir comme ces veaux, évoqués par Bertold Brecht, qui, « insatisfaits de ceux qui les tondent, les nourrissent et les gardent, résolurent en désespoir de cause d’essayer le boucher » (20).
*
Roland Gori, psychanalyste, membre d’Espace analytique, professeur honoraire des Universités. Derniers ouvrages parus : Dé-civilisation Les nouvelles logiques de l’emprise, Paris, LLL 2025 ; La fabrique de nos servitudes, Paris, LLL, 2022 ; Et si l’effondrement avait déjà eu lieu. L’étrange défaite de nos croyance, Paris, LLL, 2020 ; La nudité du pouvoir, Paris, LLL, 2018 ; Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes, Paris, LLL, 2017 ; L’individu ingouvernable, Paris, LLL, 2015 ; Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? Paris : LLL, 2014 ; La Fabrique des imposteurs, Paris : LLL, 2013 et La Dignité de penser, Paris : LLL, 2011.
Notes
(1) Luigi Pirandello, 1923, Interview à La tribuna di Roma, cité par Antonio Scurati, 2018, M L’enfant du siècle, Paris, Les Arènes/Collection Poche, 2023, p.899.
(2) Antonio Scurati, 2018, M L’enfant du siècle, Paris, Les Arènes/Collection Poche, 2023, p.962.
(3) H. Arendt, Entretien d’octobre 1973 avec Roger Errera. https://www.les-crises.fr/une-archive-exceptionnelle-un-certain-regard-entretien-avec-hannah-arendt-1973/
(4) Umberto Eco, 1995, Reconnaître le fascisme, Paris, Grasset, 2010, p.43.
(5) Hannah Arendt, 1951, Le système totalitaire, Paris, Seuil, 1972, p. 76
(6) Erich Fromm, 1964, Le cœur de l’homme, Paris, Payot, 2002.
(7) Norbert Élias, 1989, Les Allemands. Luttes de pouvoir et développement de l’habitus au XIXe et XXe siècles, Paris, Seuil, 2017.
(8) Norbert Élias, 1989, ibid., p.28.
(9) Theodor W. Adorno, 1963, Modèles critiques. Paris, Payot, 2003, p.112
(10) Thierry Fabre, Faut-il brûler Averroès ? Paris, Riveneuve, 2025.
(11) Antonio Scurati, 2018, op. cit.,, p.416.
(12) Antonio Scurati, 2022, M. Les derniers jours de l’Europe, Paris, 2023.
(13) Theodor W. Adorno, op. cit., p. 118-119.
(14) Aristote, Les politiques, Paris, Flammarion, 1990.
(15) Norbert Elias, 1989, op. cit., p. 34.
(16) Léo Löwenthal et Norbert Guterman, 1949-1950, Les prophètes du mensonge. Études sur l’agitation fasciste aux États-Unis, Paris, Éditions la découverte, p. 63
(17) Ian Kershaw, 1991, Hitler. Essai sur le charisme en politique, Paris, Gallimard, 1995, p. 15.
(18) Léo Löwenthal et Norbert Guterman, 1949, Les prophètes du mensonge. Étude sur l’agitation fasciste aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2019, p. 49.
(19) Technique inventée en 1921 par un psychiatre suisse, Herman Rorschach, invitant les patients à interpréter des taches d’encre aux formes ambiguës dans lesquelles ils projettent les aspects inconscients de leur personnalité.
(20) Bertold Brecht, 1967, Écrits sur la politique et la société, Paris, L’Arche, 1970, p. 141.
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

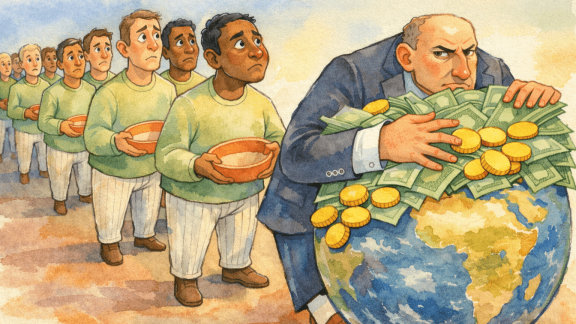
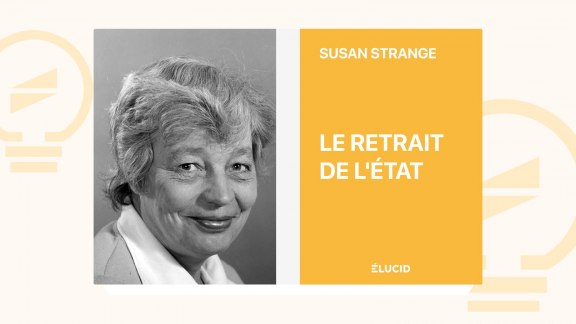


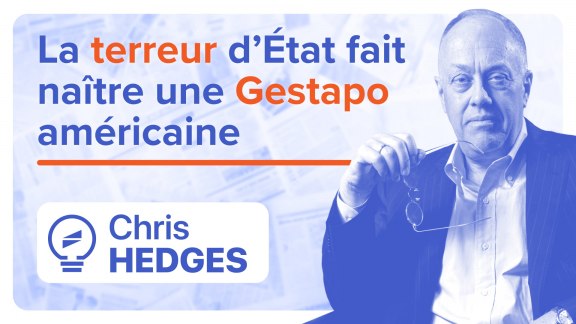
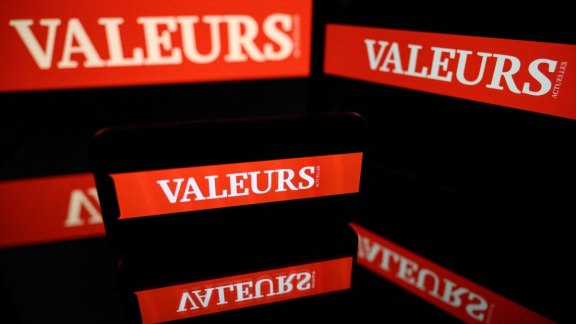
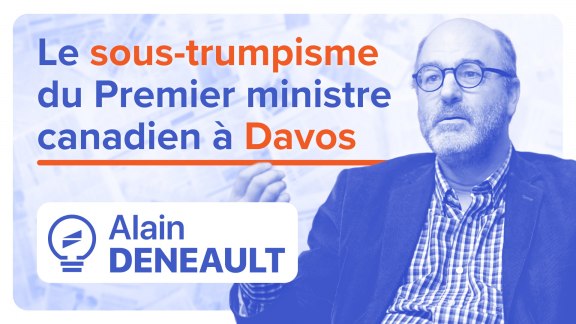
5 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner