S’il est un affect au croisement de la psychologie et de la politique, c’est bien celui de la peur. Thomas Hobbes, au XVIIe siècle, élève la peur, émotion morale et politique, à la dignité d’un affect majeur déterminant la vie sociale. La raison ne pouvant jamais triompher des passions, c’est à la peur que revient la fonction sociale de réguler les relations des individus entre eux. Passion utilitaire commune à tous les humains qui craignent la mort plus que tout, elle serait à l’origine de la religion comme de l’État.



Abonnement Élucid
L’État, tel le Léviathan de la Bible, serait cet animal monstrueux sorti des eaux, en charge pour Hobbes de confisquer la violence de chacun pour le bien de tous. La peur prend une valeur de discipline – inscrite dans les manières d’éduquer – en charge de protéger les individus d’une guerre de tous contre tous, état naturel de l’espèce humaine. Nous n'avons bien souvent retenu de l’enseignement de Hobbes que cette phrase à portée limitée. Le travail de Hobbes est plus subtil. Il entretenait avec la peur un lien étroit et familier.
« Moi et la peur nous sommes jumeaux. »
Carlo Ginzburg le rappelle : dans son autobiographie, Hobbes écrit : « Moi et la peur nous sommes jumeaux »(1). Cette crainte d’une guerre de tous contre tous rendrait souhaitable un pouvoir centralisé et absolu capable de maintenir la paix et d’empêcher un retour à l’état de nature. L’État, tel le Léviathan de la Bible, serait en charge pour Hobbes de confisquer la violence de chacun pour le bien de tous. La peur détiendrait de ce fait une valeur de discipline au cœur des manières d’éduquer et de transmettre la civilisation qui imposerait à chaque humain d’échanger sa liberté contre les garanties d’une sécurité imposée par l’État et justifiée par les religions.
Hobbes défend l’idée d’un pouvoir centralisé et absolu, capable de maintenir la paix et d’empêcher un retour à l’état de nature. Ce pouvoir pourrait être une monarchie ou une assemblée, mais il devrait détenir une autorité indiscutable et toute rébellion contre ce pouvoir s’avère injustifiable. Donc, de l’aveu même de Hobbes, la peur détient une valeur contre-révolutionnaire. Il convient de noter que l’ouvrage le Léviathan (1651) a été écrit par Hobbes au moment de la crise politique que traverse alors l’Angleterre avec l’ombre des guerres civiles. Le souverain absolu et centralisateur est celui qui garantit la paix civique, il est le protecteur qui, grâce à la peur, protège du chaos social.
Carlo Ginzburg résume parfaitement la thèse développée par Hobbes : « dans l’Europe lacérée par les guerres de religion, dans l’Angleterre déchirée par les affrontements entre le roi et le parlement, la paix apparaissait à Hobbes comme ce bien suprême qui méritait tout sacrifice » (2). Le mot de « bien suprême » est essentiel : la peur de mourir, la peur de perdre la vie serait l’essence même qui conduirait tout citoyen à devoir se soumettre à un État tout-puissant incarné par un souverain au pouvoir absolu et centralisé.
Bref, l’affect de peur nous conduit à devoir abandonner toute raison ou toute autre émotion à son profit. C’est le modèle à jamais indispensable au pouvoir « sécuritaire », et récurrent à toutes les autorités qui réclament une soumission aveugle, mais librement consentie : « confiez-moi votre force et votre agressivité, et je vous garantirais la sécurité ». La résurgence de ce paradigme sécuritaire tout au long de l’histoire des sociétés humaines est une évidence qu’il convient de ne pas négliger. C'est plus particulièrement dans les périodes de transition sociale et culturelle, de menaces de chaos, que s’impose un pouvoir qui réclame, au nom de la peur, la soumission en échange de la sécurité.
Mais savons-nous de quoi nous avons peur ?
Mais sommes-nous vraiment en capacité de connaître les causes réelles de la peur pour savoir si elles sont légitimes, et si elles justifient notre soumission, même temporaire, à un pouvoir qui, au nom de la sécurité, impose l’ordre qui lui convient ? C’est précisément, en ce point que la politique et la psychologie, plus précisément la psychanalyse, se rencontrent pour écarter les bords d’une faille évidente dans la théorie de Hobbes. Hobbes, lui-même, avait pressenti cette faille au sein de sa théorie, faille qu’il a tenté de consolider, à juste titre d'ailleurs, avec la notion de fiction.
Hobbes est un matérialiste, il sait parfaitement que c’est l’ignorance des causes naturelles de la peur qui conduit à la fabrique des religions. C’est-à-dire que ce qui nous fait peur n’est pas aussi évident, aussi réel, que pourrait le laisser croire le pouvoir absolutiste qui exige, en son nom, la soumission. Et c’est précisément en ce point qu’Hobbes se montre rigoureux et inventif. Le Léviathan tout seul ne saurait obtenir l’adhésion des citoyens, pour que ça marche encore faut-il que les citoyens fictionnent, qu’ils fictionnent non seulement la force du pouvoir auquel ils consentent de se soumettre, mais aussi qu’ils fictionnent les sources de ce qui leur fait peur.
La religion dépose le voile de ses fictions sur ces ignorances qui creusaient la faille de la théorie de Hobbes ; il écrit que l’ignorance des causes réelles de la peur conduit les humains à « fictionner pour eux-mêmes toutes sortes de forces occultes ; ils restent effrayés par leurs propres imaginations ; ils les invoquent dans les périodes de désespoir et aussi les remercient au moment d’un succès inespéré, faisant des créatures de leur propre fantaisie, leurs dieux » (3).
Ils fictionnaient et ils avaient peur de leurs fictions qu’ils prenaient pour des réalités. Voilà qui invalide quelque peu les exigences de se soumettre à un pouvoir absolu puisqu’ils ne craignaient que l'ombre de leurs fantasmes. Le pouvoir de l’État repose, en partie du moins, sur les fictions que les individus créent pour donner un motif à leur peur. La force ne suffit pas pour se soumettre à un pouvoir qu’elle légitime ; la peur, elle, provient des spectres de nos fictions.
La sécularisation ne change rien à l’affaire : les tabous que fictionnaient les religions sont aujourd’hui siphonnés par les idéologies, voire des pratiques cultuelles sans dogme comme celles de « la religion du capitalisme » (Walter Benjamin). Ce n’est donc pas sur le sécuritaire qu’un pouvoir peut légitimement fonder son autorité et exiger l’adhésion du citoyen. La chose est évidente, mais dans les périodes troubles l’image est rémanente, en particulier chez les ministres de l’Intérieur… et, leurs « doubles » des régimes tyranniques : les opposants à un pouvoir qui n’ont plus rien d’autre à dire que le langage de la violence et des attentats. Mais c’est un autre problème que j’ai essayé de traiter par ailleurs (4).
Pour l’heure, contentons-nous de nous demander pour quelles raisons les individus ont besoin de fictionner pour donner une forme à leur peur, alors même qu’ils entérinent ainsi leur perte de liberté ? Ne dit-on pas pourtant qu’a contrario de l’angoisse, la peur a un objet et que c’est la juste perception de cet objet qui, en la déclenchant, met le sujet en mouvement et en action ? C’est en ce point que la psychanalyse peut rejoindre – et peut-être aider – le traitement politique de la question des soumissions au pouvoir.
Les frayeurs d'Anton Tchékhov
Dans la tradition psychopathologique classique, on oppose la peur à l’angoisse, la peur aurait un objet qui conduit à le fuir, l’angoisse serait sans objet. Lacan bouscule cette distinction traditionnelle. Dans le Séminaire L’angoisse (5), il critique cette tendance de la tradition psychopathologique « à accentuer l’opposition de la peur et de l’angoisse en fonction de la position de chacune par rapport à l’objet », et « l’erreur ainsi commise qu’on est amené à accentuer que la peur, elle, a un objet ». Loin de se révéler « objectif », bien identifié, le motif de la peur pourrait bien procéder de son caractère inconnu, étrange, mal identifié.
Un récit de Tchékhov, intitulé Frayeurs, est particulièrement instructif pour rendre compte du phénomène de la peur. Il s’agit de trois souvenirs de scènes rapportées par Tchékhov au cours desquelles il a éprouvé de la peur sans que pour autant aucun objet ne le menace.
Dans le premier récit, Tchékhov rapporte l’impression étrange et effrayante qui l’a saisi un jour, alors que conduisant son traineau dans une plaine, au coucher du soleil, il aperçoit au loin un clocher de la fenêtre duquel il voit vaciller une flamme, une lueur inexplicable. Il connaît cet endroit, il sait qu’on ne peut y accéder d’aucune façon, et il ne comprend pas le phénomène. Il est, écrit Lacan : « saisi tout d’un coup de quelque chose qui, à lire le texte, ne peut aucunement s’appeler angoisse, et que l’on a traduit par le terme de frayeur. Ce dont il s’agit est de l’ordre, non de l’angoisse, mais de la peur. Ce dont il a peur n’est pas quoi que ce soit qui le menace, mais quelque chose qui a le caractère de se référer à l’inconnu de ce qui se manifeste » (6). L'inconnu de ce qui se manifeste, voilà donc la source de la peur à laquelle le psychanalyste comme le politique, mais différemment, se trouvent convoqués.
Ce phénomène de frayeur est indissociable du sentiment de solitude et de tristesse qui accompagne la terreur et ne se voit tranquillisé « un peu », dit Tchékhov, que par la voix humaine et la courte conversation qu’il a avec le petit garçon qui l’accompagne. Il écrit (7) :
« Il devint clair que l’épouvante s’était emparée de moi… Une impression de solitude, de tristesse, de terreur m’avait saisi, comme si j’avais été jeté contre ma volonté dans ce grand trou plein de ténèbres où je me trouvais seul à seul avec le clocher qui me regardait de son œil rouge. »
Dans un autre récit, c’est la rencontre avec un chien, fort sympathique mais imprévue et énigmatique, qui produit la frayeur. Ce chien égaré auquel Tchékhov attribue par association la métamorphose du Diable dans le Faust de Goethe. Là encore, ce n’est pas du chien dont Tchékhov a peur, mais de l’incongruité étrange, de l'inconnu de le rencontrer là où il ne l'attendait pas. Là encore, c'est la voix et le sens apporté par l’ami auquel il rendait visite, lequel avait perdu ce chien, qui calme la peur ressentie par Tchékhov.
Il en va de même dans le troisième récit : dans le calme et la solitude du soir, Tchékhov rencontre un wagon solitaire, étrangement détaché de toute locomotive, qui roule à vive allure sur une voie ferrée. La peur qui le saisit, c’est tout simplement ce silence du monde, ce caractère incompréhensible d’événements qui rongent inexorablement l’ordre des choses à leur place. Dans ce paysage d’une condition humaine prise dans l’ennui et la lassitude d’une succession d’instants arrachés à la mort, un humain éprouve de l’épouvante dans un univers où rien ne le menace.
Dans toutes ces expériences rapportées par Tchékhov, on retrouve le même élément déterminant, l’émotion générée par l’énigmatique présence de l'étrangeté, quelque chose qui se trouve « en arrière de l’objet ». C’est cela qui « jette le sujet dans le désarroi le moins adapté à la réponse ». La thèse permet à Lacan d’énoncer, qu’a contrario de l’opinion largement répandue, ce n’est pas d’un objet que provient la peur, mais de ce que l’on place derrière lui : « Ce n’est pas d’un objet, ce n’est pas du chien qui est là qu’il a peur, c’est d’autre chose, quelque chose en arrière du chien » (8).
Ce quelque chose qui se trouve en arrière de la peur, c’est l’angoisse. La peur masque l’angoisse. Tel est l’enseignement que nous procure mieux que toute autre la clinique de la phobie. Tout clinicien qui reçoit des patients phobiques connaît la sécurité que procurent les phobies : l’angoisse a été enfermée dans un objet (les couteaux, les araignées…) ou une situation (les ascenseurs, le vide…) dont le patient a peur. La source du danger est magiquement localisée et localisable. À la condition d’éviter cette rencontre avec les objets phobogènes, le patient peut vivre en paix, ou à peu près.
Cet arrière-monde qui se tient en arrière de nos peurs, est le fond de l’angoisse que la peur encadre, tout comme l’objet phobique vient structurer, localiser cette angoisse pour éprouver la sécurité. Ce dont on a peur ce n’est pas d’un objet déterminé de la réalité sensible, mais bien plutôt de ce qui se tient « en arrière » de cet objet. Et ce qui se tient « en arrière » de l’objet se situe dans le registre de l’étrange, de l’inconnu, de l’inhabituel. D’où ce paradoxe : c'est la guérison de sa phobie qui rend, chez le phobique, l'existence… angoissante ! Lacan écrit (9) :
« La liaison étroite de la peur avec la sécurité devrait vous être rendue manifeste par la phénoménologie de la phobie. Vous vous apercevriez que, chez le phobique, ses moments d’angoisse se produisent quand il s’aperçoit qu’il a perdu sa peur, lorsque vous commencez à lui lever un peu sa phobie. C’est à ce moment-là qu’il se dit – Oh là là ! Ça ne va pas. Je ne sais plus les endroits où il faut que je m’arrête. En perdant ma peur, j’ai perdu ma sécurité. »
Tout pouvoir contient en germe l'idée de dictature
Telle est l’expérience que nous rencontrons dans les situations d’angoisse et de peur sociales : nous avons peur, non à proprement parler des événements, mais de ce qui se situe en arrière de leur présence. Nous connaissons les événements qui nous font peur, mais non ce qui nous fait peur dans ces événements. Tel est ce à quoi à en faire le politique : offrir un cadre où enfermer l’angoisse, cette peur de la peur, pour que les citoyens sachent de quoi ils doivent avoir peur, quelles fictions fabriquer pour accepter de se soumettre au pouvoir. Les gouvernants ne cessent de faire peur aux citoyens, non pour les angoisser, mais bien plutôt pour leur offrir les étagères où déposer l'angoisse de leur existence.
Les autoroutes de l’information sont des « autoroutes de servitudes » dans nos sociétés de contrôle (10). Je n'ai eu de cesse de le rappeler, à la suite de Gilles Deleuze, mais tout pouvoir offre à ceux qu’il veut soumettre les fictions justifiant l'ordre qu’il impose. Tout pouvoir détient en lui les germes d'une dictature – Paul Valéry l'a écrit avant moi. Tout simplement parce qu'il dicte les objets dont nous devons avoir peur pour localiser, cadrer, contenir l’angoisse : Dieu, le migrant, le Juif, l’arabe, le communisme, le fascisme, les extrêmes, l’insécurité, les épidémies, la dette… en arrière-desquels se situe l’angoisse du silence du monde, un silence assourdissant dans l’extrême solitude des masses.
L'institution gouvernementale chargée d'établir et de maintenir l’ordre sécuritaire à l’intérieur d’un pays se nomme « ministère de l’Intérieur » depuis la Révolution française. Ce ministère se révèle le plus prompt à siphonner à son profit la crainte de Dieu. La laïcisation des fictions à même de faire peur aux individus afin de les soumettre, ne modifie pas pour autant la vocation des imprécateurs. Savonarole a plus d’un habit dans sa garde-robe pour haranguer et soumettre les foules à l’aide de ses fictions. Il sait mieux que tout autre qu’une foule, en perdant ses peurs, perd son sentiment de sécurité. À moins qu’elle ne s’élève à la dignité d’un peuple, fier de ses émancipations.
Qu’est-ce qui peut nous permettre de sortir de la fatalité infernale de la soumission ? La voix humaine, le dialogue, le sens partagé, cette lumière que l'on appelle parfois la raison, d’autre fois l'imagination créatrice, et qu'en politique nous nommons « l’invention de la démocratie » (11). Montesquieu invoquait le libéralisme comme antidote de Hobbes. Ce fut le rêve du XIXe siècle qui se transforma en cauchemar. Mais, cela est une autre histoire, je la raconterai une autre fois.
*
Roland Gori, psychanalyste, membre d’Espace analytique, professeur honoraire des Universités. Derniers ouvrages parus : La fabrique de nos servitudes, Paris, LLL, 2022 ; Et si l’effondrement avait déjà eu lieu. L’étrange défaite de nos croyance, Paris, LLL, 2020 ; La nudité du pouvoir, Paris, LLL, 2018 ; Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes, Paris, LLL, 2017 ; L’individu ingouvernable, Paris, LLL, 2015 ; Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? Paris : LLL, 2014 ; La Fabrique des imposteurs, Paris : LLL, 2013 et La Dignité de penser, Paris : LLL, 2011.
Notes
(1) Carlo Ginzburg, Peur Révérence terreur. Quatre essais d’iconographie politique, Paris, Les Presses du Réel, 2013, p.15.
(3) Cité par Carlo Ginzburg, Peur Révérence terreur. Quatre essais d’iconographie politique, Paris, Les Presses du Réel, 2013, p.25.
(4) Roland Gori, Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes, Arles, Babel Actes Sud, 2017.
(5) Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre X. L’angoisse (1963), Paris, Seuil, 2004.
(6) Jacques Lacan, 1963, ibid., p. 187.
(7) Anton Tchékhov, Œuvres I Théâtre complet Récits 1882 1886, Paris, La Pléiade, Gallimard, 1967, p. 1212.
(8) Jacques Lacan, 1963, op. cit., p. 187.
(9) Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre V. Les formations de l’inconscient (1958), Paris, Le Seuil, 1998, p. 177.
(10) Roland Gori, 2022, La fabrique de nos servitudes, Paris, LLL poche, 2023.
(11) Claude Lefort, 1981, L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1984.
Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :
S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

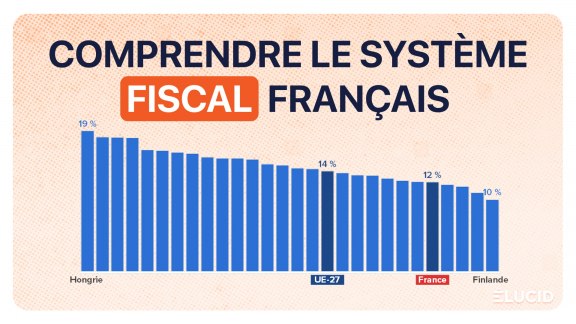






3 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner