Il existe une version plus récente de cet article sur Le bilan de la Réserve fédérale américaine (Fed)
Nous vous recommandons de lire notre article actualisé sur daté du
La Réserve fédérale américaine va-t-elle enfin défendre l'intérêt général et l'économie productive ou bien les intérêts des 1 % les plus riches et de la finance casino ? Depuis vingt ans, la banque centrale des États-Unis a endossé un nouveau rôle dans l’économie américaine : celui de prêteuse en dernier ressort afin de différer les conséquences des politiques néolibérales irresponsables. Malgré tout, il semble qu'il n'y ait plus aucun moyen de les empêcher à l'avenir. En attendant, les « politiques non-conventionnelles » ont de graves effets sur les bulles financières, les prix stratosphériques de l’immobilier, l’inflation, l’activité économique et donc le pouvoir d’achat.

1- Une explosion du bilan de la Fed depuis 2008
2- La Fed, palliatif du marché interbancaire moribond
3- La Fed bien plus sérieuse que la BCE
4- Sauver le système financier et l’État
5- Le changement de rôle de la Fed
Ce qu'il faut retenir
Créée en 1913, la Réserve fédérale américaine – souvent appelée « Fed » – est une banque centrale qui assure le rôle fondamental de contrôle du dollar, monnaie centrale des échanges internationaux. Contrairement à la BCE, dont le mandat consiste uniquement à maîtriser l’inflation, la Fed dispose d'un double mandat : la recherche du plein emploi et de la stabilité des prix (auxquels s’ajoute en théorie, mais marginalement, la recherche de taux d'intérêt à long terme modérés).
Une explosion du bilan de la Fed depuis 2008
Le bilan de la Fed est resté relativement stable en dollars réels (c’est-à-dire corrigés de l’inflation) entre 1945 et 1985, oscillant entre 600 et 800 Md$, avant de lentement progresser jusqu’à 1 500 Md$ en 2008. La crise financière a alors fait exploser ce bilan, qui a quadruplé en 6 ans, avant que la crise Covid l’augmente encore de 50 %, pour atteindre près de 10 000 Md$ en 2021 et 8 500 Md$ fin 2023. La Fed a alors décidé de baisser la taille de son bilan pour tenter de revenir au niveau d’avant la crise Covid.


En ramenant la taille du bilan au PIB, on remarque tout de suite que la crise de 2008 a été d'une ampleur historique. En l'espace de seulement trois ans, elle a propulsé le bilan de la Fed au niveau de celui qui avait résulté de la crise de 1929 puis de la Seconde Guerre mondiale. Et la crise du Covid a encore presque doublé ce niveau.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité
S’abonnerAccès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous

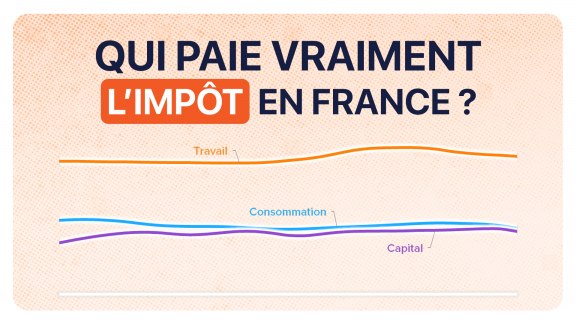



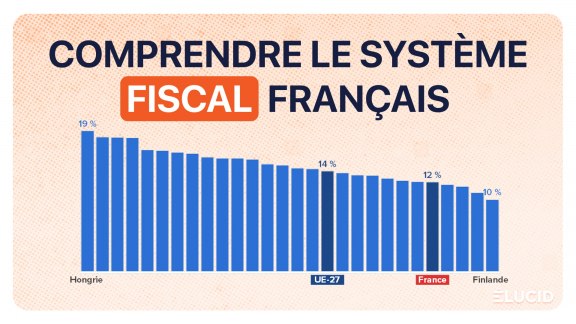


2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.
S'abonner